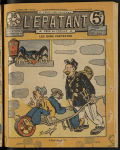Download L`homme de la pampa
Transcript
Jules Supervielle L’HOMME DE LA PAMPA (1923) Table des matières I DÉSERT À CORNES .............................................................. 4 II LA MONTAGNE ARDENTE .............................................. 13 III DICTIONNAIRE ...............................................................24 IV LES CERISES MARINES .................................................. 33 V PLAN DE PARIS .................................................................49 VI AFFAIRES DE FAMILLE OU L’ENVERS D’UNE OMBRE ...................................................................................62 VII LIBERTÉ .......................................................................... 73 VIII AGRANDISSEMENTS. NOUVEAUX AGRANDISSEMENTS. ........................................................... 78 À propos de cette édition électronique .................................. 90 Rêves et vérité, farce, angoisse, j’ai écrit ce petit roman pour l’enfant que je fus et qui me demande des histoires. Elles ne sont pas toujours de son âge ni du mien, ce qui nous est l’occasion de voyager l’un vers l’autre et parfois de nous joindre à l’ombre de l’humain plaisir. –3– I DÉSERT À CORNES Dans le wagon qui l’emportait vers le Nord, tête nue à la portière, il laissait le vent champêtre jouer sur son crâne où des cheveux en étroites averses et une calvitie ensoleillée faisaient le beau temps et la pluie. Des impressions d’enfance lui parvenaient, par fraîches bouffées, en pleine figure. Ses premières années ne reposaientelles pas aux vivaces frontières de sa mémoire dans un berceau gardé la nuit par la lune bleue des pampas et le jour par un couple de vanneaux aux cris si aigus qu’il les entendait encore ? Follement, son âme de cinquante ans plus agile que ses jambes s’ébattait au grand air. Fernandez y Guanamiru la poussait devant lui au fil humide et emperlé de la campagne matinale. Parfois durant la marche du train, un mugissement pénétrait dans le wagon : ainsi s’exprimait la pampa dans son fruste parler, comme fait celui qui ne disposant que de certains mots d’une langue étrangère, voudrait leur confier toutes les nuances de sa pensée et même davantage, dans une ambition désorbitée. Cette campagne ignorante des lignes brisées, l’horizon l’attend sans surprise, sachant bien que d’un élan sous le ciel immense elle ira jusqu’à lui. Seuls dans la plaine les oiseaux sont chargés de tracer dans les airs de fuyants paysages que de leurs chants ils prolongent. À eux de porter le poids et la responsabilité des quatre saisons, d’offrir le mystère et les lointains de la forêt absente. Et –4– au printemps quel travail ! Comment, si l’on n’a que deux ailes, suggérer les carrés de labours, l’exaltation des branches, les milliers de boutons d’une roseraie, et toutes les interrogations de l’air et ses exclamations ? Passe dans le cadre de la portière une oasis véritable : petit bois, galops de chevaux, une paillote et deux métisses étendant du linge blanc-de-pauvre et rose-fané. Il y a dans l’esprit de Guanamiru des échanges, des départs, des images qui viennent du dehors et s’installent, prenant leurs aises en vue d’un long séjour. Voici un eucalyptus qui occupe et parfume la place d’une mauvaise pensée ; un agneau ayant vainement cherché sa mère morte dans la prairie la retrouve broutant tout le long d’une idée générale du voyageur. « Heureux agneau, soupira Guanamiru, ah ! plus heureux que mes trente bâtards qui rôdent humblement dans la plaine à la recherche d’un père. » Il les aimait avec des distractions et des repos de gros propriétaire : sa bonté se disséminait dans toutes les directions où il possédait des terres. Mais jamais il n’oubliait de leur envoyer, le jour de leur majorité, un frein et des éperons en argent massif « pour qu’ils apprennent à être des hommes comme il faut. » Désirant leur venir en aide en cas de malheur, Guanamiru pointait leurs déplacements sur une carte murale de son pays au moyen d’épingles à oriflammes de soie rouge. Dans sa paternité superstitieuse, il aurait redouté quelque chose comme une hémorragie si un peu de sa chair lointaine avait passé de sa propriété de Yacari dans celle de Tibijo, à vingt lieues à l’est, sans que le siège principal de sa personne en eût été immédiatement informé et que la carte eût enregistré et approuvé en quelque sorte ce déplacement. Guanamiru descendit du train à la gare de Palito, la plus proche de sa grande ferme de San Jacinto. –5– Avant de se rendre chez lui, le voyageur visitait toujours le commissaire qui habitait en face de la gare. Plus brun et humide qu’une motte de terre après l’orage, celui-ci se chargeait, moyennant le don discret de quelques bœufs gris, de prévenir l’estanciero 1 du mariage de ses anciennes maîtresses et de signaler au mari le danger qu’il courrait à molester un homme possédant plus de taureaux pur sang qu’il n’en faut pour combler soixante mille vaches. Un bureau rouge et azur comme un ventre frais-ouvert servait de cadre à ces visites. On s’entretenait de l’état du bétail et des pistes et on se quittait difficilement au bout d’une demiheure de visqueuses courtoisies. Cependant, le contremaître de Guanamiru, Innombrable (ainsi nommé parce qu’il était né le jour des innombrables martyrs de Saragosse) l’attendait à la porte du Commissariat, tenant à la main la bride de deux chevaux que les saisons couvraient tour à tour de boue ou de poussière. La préoccupation de travaux très différents (comme la castration des vieux taureaux et la réparation de la lampe du rancho) requérant dans un même temps son attention, Innombrable, consciencieux à l’extrême, en était devenu louchon, ce qui ne déplaisait pas à son maître ; il savait l’origine de cette infirmité et y voyait la preuve d’un zèle sauvage. Le lendemain, dimanche de Carnaval, vit Guanamiru en selle dès que l’aube eût montré le bout de son oreille diaphane. Il allait faire le tour de ses vaches et buvait avec délices l’air frais du matin à même sa source campagnarde. Son regard se fixa sur la large culotte décolorée et mal rapiécée de son contremaître 1 Propriétaire d’un grand domaine. –6– qui l’accompagnait toujours dans ses sorties. Oui, c’était là un de ses trente enfants, et peut-être celui qu’il préférait. Le sang guanamirien coulait incognito dans ces maigres cuisses et ce cœur certainement fatigué par l’abus du maté. Parfois l’estanciero avait envie de reconnaître son fils en hâte derrière un cactus, sans même descendre de cheval. Il en était empêché par sa conception distributive de la justice qui n’eût admis ce geste que suivi de vingt-neuf autres de même nature. Et c’était trop lui demander. Une parcelle d’horizon se détacha confusément pour se mêler à un peu de terre et s’avancer à quatre pattes. Des cornes lui naquirent et cela se répéta en mille endroits dans la plaine. Elles s’en venaient, les bêtes de tous poils, lentement, entraînées par le poids logique de leurs têtes. Des vaches osseuses accroupies se levaient, déplaçant leurs angles, et se mêlaient dans un profil obstiné au mouvement des compagnies bovines en marche. Des veaux isolés flairaient en tous sens l’air maternel et regagnaient enfin des mamelles agitées comme des cloches, à de grandes distances. Au brusque galop de son cheval, un gaucho s’élançait de dos pour revenir de face dans une violente poussière hantée de mufles et de souffle. Guanamiru songeait : « Frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, nièces, toutes ces bêtes sans distinction de poil, ni d’âge, ni de sexe, sans le moindre protocole, des veaux de trois mois passant parfois avant de vieux taureaux enfin impotents, tous ces bovins, têtes nues parmi les cornes, cachent soigneusement leurs tripes dans leur ventre circonspect et feignent d’ignorer, comme leurs pères ont fait déjà, que leur chair est bonne à devenir un jour de la viande de boucherie. » –7– Tous ces museaux luisants, ces cous balancés, ces pattes remuées, ces beuglements semblaient obéir à une force mécanique dissimulée sous la terre et qui drainait le bétail de la plaine avec l’aide de six gauchos loqueteux, drus et droits sur leurs montures. L’estanciero se surprit à calculer les possibilités de bœufs comprises dans les vides des divers groupes en marche ; ces bêtes, qui ne connaissaient même pas son nom, pensait-il, lui appartenaient entièrement depuis le poil extrême de leurs queues jusqu’à la note la plus haute de leurs mugissements. S’il le désirait, il pouvait les soumettre à l’action de tous les climats, les polaires du frigorifique, les équatoriaux des cuisines. Pour s’en persuader et donner à son sentiment l’appui d’un geste, il s’approcha d’une vachette noire et en tapota les flancs de son poing orné de rubis cruels. L’après-midi, l’estanciero décida d’accompagner dans sa tournée son contremaître qui depuis quinze ans, le Dimanche de Carnaval, après s’être vidé un flacon d’eau de rose sur la tête, se rendait travesti dans toutes les cases du domaine. Au fond de l’écurie il trouva Innombrable qui s’excusa de sa tenue. Ne portait-il pas un bonnet de papier, vert jusqu’à son extrême pointe, lequel lui venait de sa fiancée, un corsage de sa mère en percale blanche à pois noirs, et, par-dessus ses bottes dont le dessin transparaissait, des bas grenat issus de sa sœur ? Après quelques secondes de pénible hésitation, il offrit à son maître un des masques qu’il tenait dans les mains : « Si le patron désire, c’est le plus beau des deux », dit-il avec humilité. C’était un visage rouge, horrible et noir, aggravé de virgules, un enfer de catéchisme. Guanamiru s’empressa de l’attacher. Déjà il souriait bonnement derrière le carton. Avait-il ainsi l’illusion de remédier à la mauvaise impression qu’allait produire sur ses gens sa trogne de passage, ou s’enorgueillissait–8– il de sourire, à l’abri même de tout miroir, pour lui seul, pour son for intérieur ou, plus secrètement encore, pour l’idée qu’il voulait donner de lui ? Les voici à cheval. Les péones 2 accroupis à l’ombre grêle de la case les regardent avidement. Tant de curiosité ébranle l’assurance de Guanamiru. Estimant qu’un patron doit donner l’exemple du sérieux même en temps de carnaval, il attache le masque à la selle et décide même de précéder son contremaître dans les ranchos où il l’attendra parmi ses fermiers. À cinq lieues à la ronde chacun savait quel serait ce jour-là le costume d’Innombrable et qu’il recevrait sa visite. De loin, les chiens l’apercevaient et s’épuisaient en protestations calomnieuses. – Fuera, Cimarron !3 Fuera, Canela ! criaient le gaucho ou sa femme ou ses filles, ou parfois tous à la fois. Que ce fût dans la case n° 1 du second lot ou dans le n° 3 du ou même dans celle de l’aimée – une métisse aux yeux bleus venus de quelle Angleterre dans ce désert lointain ? – le dialogue ne variait pas. 4e – Quel est ce masque bien planté ? Ne serait-ce pas don Innombrable ? – Ah ! je ne sais pas, je ne sais pas, disait Innombrable avec de frustes coquetteries. – Et moi, je crois bien que c’est lui. Comment allez-vous ? – En promenade, vous le voyez. 2 Ouvriers des champs. 3 Allez coucher, Cimarron. –9– – Les enfants ! attachez vite le cheval. Et vous, don Innombrable, passez donc, venez au frais. – Comme vous voudrez. On entrait dans le rancho d’un noir souterrain, sous la tenace fumée des grillades. On prenait place autour de la table avec soin, comme pour toute la vie. – Vous allez prendre un amer4. Et on allait chercher la bouilloire sur le feu. La bouilloire, noire sur fond noir, culottée de partout jusqu’au bout de son bec, condamnée à brûler sans relâche, montrait sans honte son ventre encroûté de plusieurs couches de suie superposées. Et pourtant l’eau limpide sortait de là, au premier appel du gaucho, l’eau obéissante et radieuse comme une fiancée. Mélangée au maté, elle vous donnait jusque dans vos ancêtres couchés dans la mort, une intense sensation de bien-être. Il faisait une chaleur sans issue. La sueur coulait sur les joues. Parfois, on voyait une des jeunes filles disparaître pour revenir quelques instants après, remise à neuf par une couche épaisse de blanc. Des silences appuyés lézardaient les murs, cherchant à joindre le silence infini du dehors. – J’étais venu intriguer ces demoiselles, disait de temps en temps Innombrable. – Comme l’année dernière, vous vous rappelez ? On riait un peu. On se taisait avec voracité. Tout ce mutisme restait en tas sur l’estomac. Pour le faire passer on servait sans relâche du maté bouillant. 4 Maté sans sucre. – 10 – De temps à autre on se souriait à travers le bloc transparent du silence. On buvait un peu d’eau-de-vie de maïs. – Vous ne voulez pas enlever votre masque ? – Non merci. Il faut encore que j’aille intriguer les jeunes filles du rancho voisin (lequel se trouvait à deux lieues de là). – À l’année prochaine, si Dieu veut. – Si Dieu veut. Et le gaucho repartait en corvée de plaisanteries, sous la chaleur du jour qui l’attendait à la sortie et, de vive force, l’enveloppait dans une camisole de feu. Guanamiru et son contremaître errèrent jusqu’au soir dans la poussière enflammée. Les chevaux, des confettis dans les crins et sur leur col en sueur, s’étonnaient de cette sortie dont ils ne comprenaient pas le but et avançaient accablés, l’oreille indifférente. Toute la nuit, dans un mauvais rêve, l’estanciero prolongea ce pauvre Dimanche. Il se vit arrivant dans un village en pleine pampa et se dirigeant vers le Cercle du Commerce et de l’Industrie : un mauvais café. Un groupe d’hommes montés sur de rapides chevaux jouaient sur un billard infiniment long où les billes mettaient parfois huit jours à s’atteindre. Il leur fallait faire jusqu’à cinquante lieues. Parfois les joueurs s’arrêtaient de galoper pour faire boire leurs chevaux. On servait de l’eau-devie aux spectateurs de cette étonnante partie. Des matelas aux couleurs nationales étaient disposés par terre pour la nuit. Ce lieu étrange, Guanamiru le quitta pour se retrouver, toujours en rêve, dans une case de grand luxe où les bêtes de la prairie, les bovines comme les équines et les ovines, toutes boueuses et crottées, mais masquées avec soin, s’en venaient lui rendre visite et lui jurer fidélité. S’étant livrées à de grotesques salutations, elles pénétraient chez Guanamiru qui les attendait – 11 – avec des rafraîchissements de toute sorte et un petit discours visible sur le bout de la langue. Elles ne consentaient pas à l’écouter, refusaient d’enlever leurs masques et de boire « par crainte de se salir », disaient-elles. Le lendemain, Guanamiru, à qui Innombrable venait d’apporter le maté à cinq heures dans son lit, cria très fort pour être entendu des plus éloignées régions de son âme : « Ah çà ! vais-je donc me laisser enterrer vivant ? Même durant mon sommeil, ces sauvages déserts me tiennent garrotté. Et il me faut avaler dès le matin ce breuvage de gaucho, si amer et que je prends sans sucre pour montrer que je suis bien de mon pays. Et pourquoi à midi et le soir ne me serton que de la viande de vache ? Que deviennent cependant le caviar de Russie, le cœur de palmier du Chili et le maïs doux de la Désirade ? Que me fait tout ce Carnaval à ras de terre, dans un pays de plaine ? Et ce bétail qui attend sans espoir de grandes vacances ? Et ces gauchos qui ne sortent qu’à cheval, même en rêve, même pour se rendre d’une pièce à l’autre dans le rancho ou pour monter au ciel après leur mort ? Ces longues plaines ne me sont indispensables que si j’en suis à plus de 300 kilomètres ! J’ai passé l’âge où de bêlants crépuscules comblent l’âme de leur tremblement élégiaque et celui où dans un mouvement circulaire on reconnaît tous ses bâtards. Il est temps de regagner la capitale où m’attendent déjà sur le quai de la gare des amis inconnus qui regardent leur montre. » – 12 – II LA MONTAGNE ARDENTE Ce court voyage n’avait fait que raviver en Guanamiru le mal du désert dont il avait eu longtemps à souffrir alors qu’il vivait à l’estancia. L’affection, provoquée par une immense oisiveté dans la campagne sans limites, troublait l’esprit de l’estanciero même durant les galopades désordonnées où il se fuyait éperdûment. Quand le temps était à l’orage Guanamiru allait jusqu’à éprouver que le cercle rétréci de l’horizon lui serrait le crâne aussi exactement que le conformateur de son chapelier. Et pourtant il avait voulu gérer lui-même jusqu’à la quarantième année les terres qu’il tenait de son père : le serment en avait été fait dans un banquet d’éleveurs présidé, à la demande de Guanamiru, et dans un box fleuri, par son taureau Occiput IV, grande médaille d’or du salon des Durham. En fait, il ne gérait pas plus ses domaines qu’il n’administrait la couleur du ciel ou l’humidité de l’air ; mais ses voisins, à qui en imposait la fixité de son regard, le considéraient comme un des sauveurs de la Pampa ; cela lui suffisait. Dès son retour définitif à Las Delicias il s’était fait construire « pour passer le temps » un énorme « palais » coiffé de trois tours carrées, dont on pouvait se demander pourquoi elles ne mesuraient pas quatre mètres de plus ou de moins et s’il n’aurait pas mieux valu qu’elles fussent couronnées d’un dôme ou simplement supprimées, tout au moins par la pensée. Le matin, souvent prise de vertige, la demeure semblait s’excuser d’être construite en matériaux durables alors qu’elle n’était que la résultante cimentée des rêvasseries du propriétaire. N’ajoutait-il pas tous les ans à la confusion de – 13 – l’édifice en l’augmentant d’un bow-window ou d’un mirador, en ébauchant une aile, en risquant – externe ou interne – un escalier énergique en marbre de Carrare, dont nul, même Guanamiru, ne savait exactement où il allait, ni s’il y arriverait jamais. Quand on pénétrait dans le parc entourant largement le palais, c’était souvent un ibis de Macé, un lophophorus refulgens, une Pénélope à sourcils crayeux qui vous souhaitait une bienvenue de profil. La tête plate en arrière, l’œil fixe, les pattes sévères, une autruche s’en venait sottement attester l’authenticité de ses plumes et s’éloignait aussitôt en passant sous l’arche attendrie d’une girafe. Dans le bassin, des canards carolins fuyaient poursuivis par leurs pattes légères, grenouilles entre deux eaux, et on parvenait rarement au seuil du palais sans croiser un libre hérisson, tous piquants dehors, que deux cents protège-pointes rendaient inoffensif. Çà et là rampaient, se lovaient ou laissaient pendre leur tête d’une branche d’arbre, des serpents dits mussuranas que Guanamiru élevait, tant pour effrayer les visiteurs étrangers (qu’il avait ainsi le plaisir de rassurer et d’inviter à sa table) que pour se débarrasser des serpents venimeux dont les mussuranas se nourrissaient par esprit de mortification. Toute la journée, entre deux bosquets d’eucalyptus, le continuel passage des perroquets mêlant leurs vols, étayait un dôme de cris entrelacés qui s’effondrait à la nuit tombante dans un vertige de silence. C’était l’heure où, sur un banc du jardin, deux indigènes des sources supérieures de l’Orénoque s’entretenaient d’une augmentation de salaire avec un homme des bois uniquement vêtu de branches très sèches et à qui il était défendu de fumer. Près d’eux, un insulaire Ombaï, offrait aux regards le bouquet de ses cheveux émergeant d’un tuyau de nickel bien astiqué. Et – 14 – parfois, un Papou que l’on avait dégoûté de l’anthropophagie en l’employant au four crématoire municipal, se mêlait à leur conversation ou plutôt à leurs gestes : ils ne se comprenaient qu’à coups de grimaces, de couteau, de sourires et aussi de timbres-poste qu’ils échangeaient avec rapidité. Ces hommes que Guanamiru avait fait venir à grands frais des quatre pointes de la terre étaient chargés d’effrayer les enfants échappés sur le gazon et de composer des cocktails avec les eaux de tous les grands fleuves du monde mises en barrique à la source. Ils y versaient quelques gouttes de pluie glacée au moment de servir et, pour colorer le tout sans que l’estomac en souffrît, donnaient aux consommateurs des lunettes à verres de couleurs cherry, champagne, absinthe, curaçao, black and white, rainbow. Leur maître sorti, on voyait souvent les sauvages sur l’herbe aux vaguelettes frisées où ils formaient un archipel battu par les nostalgies, à la merci d’un coup de sifflet du gardien-chef ou de la trompe de l’auto guanamirienne. Ce jardin d’acclimatation fut célèbre dans toute l’Amérique du Sud par le tour de poitrine de ses éléphants et les dépenses de son propriétaire, qui y faisait vivre sans joies des bêtes très cruelles dans des cages dont on changeait le bariolage tous les quinze jours pour donner aux fauves l’illusion des lointains, et de la liberté. Guanamiru s’était bientôt lassé de nourrir tant de férocité prisonnière dans un parc qu’ennoblissaient pourtant de superbes individus et le souvenir gravé sur granit de deux gardiens dont il ne restait plus que, dans une urne d’or, les restes digérés par des tigres. « La famille du kangourou recéleur, disait-il, et les indélicatesses des singes ne parviennent plus à me distraire. J’ai le sentiment de me réveiller d’un impardonnable sommeil de plusieurs années, moi qui ai fait afficher dans les salles de bain – 15 – du Jockey Club : Défense de dormir plus d’une heure dans les baignoires. » Un jour, comme il cherchait un livre dans sa bibliothèque, Les Volcans de Fuchs attirèrent ses deux mains tourmentées d’inconnu. « La tension des gaz et des vapeurs, commença-t-il à la page 14, ne suffit pas toujours pour qu’ils se frayent une voie libre à travers les roches tendres de la montagne. » Longuement, cette phrase fit rêver le lecteur. Puis ce fut : « Les bergers de Pantelaria, île très pauvre en sources, ont l’habitude de mettre des fagots de broussailles devant les fumeroles pour que les vapeurs qui les traversent lentement, s’y rafraîchissent et s’y condensent en eau. Ils obtiennent ainsi la quantité de liquide nécessaire pour abreuver leurs troupeaux. » Le surlendemain, Guanamiru qui considérait volontiers ses cheveux comme le prolongement lisible et périssable de ses idées, disait à son coiffeur en train de le peigner (il eût trouvé puéril de lui cacher sa pensée, du moins sa pensée présente) : « Je vais construire un volcan, mon ami, un volcan qui honorera le pays. » Ce projet lui était arrivé la veille par la fenêtre qu’il avait eu la précaution de laisser grande ouverte ; il attendait un événement considérable. L’idée encore extérieure mais déjà bourdonnante fit plusieurs fois le tour de sa tête, traversa soudain le crâne et pénétra avec délices à la bonne place. « J’ai besoin d’un volcan pour être heureux et je veux pouvoir en jouir sans quitter ma propriété. J’en établirai moimême les plans dans ce pays privé de relief et si éloigné de tout que des curieux à jamais égarés à sa recherche sur des cartes pourtant bien faites y sont morts de faim et de géographie. » – 16 – Quel modèle choisir ? se disait l’estanciero en feuilletant ses albums où défilaient des volcans apprivoisés, sous leur fumée rose-facile. Pourquoi celui-ci et non cet autre ? San Miguel du San Salvador toujours enveloppé d’un nuage très sec, Momobacho du Nicaragua couvert de bois jusqu’à son panache, aérienne forêt, Tschy-Hang de Formose avec ses baignoires de basalte et son lac d’eau chaude, Cotopaxi dont toute la neige fondit en une seule nuit de 1803 et qui tire depuis une langue brûlante de vipère traquée ? Pour mieux choisir, il ferma le livre et les yeux, puis, au bout d’un instant, les rouvrit tous les trois et se reprit à feuilleter. Un volcan du Japon au sommet verni de neige, gardien de l’horizon des estampes auxquelles il donne du recul et un accoudoir pour les souvenirs ? Le Stromboli avec ses cinq mille mètres, étrange malade toujours fumant et crachant le sang, la tête enveloppée de glace, les pieds sous d’excellentes couvertures de géraniums ? Ou vous, au pays du printemps, volcans paresseux de Madère au cratère planté d’orangers autour desquels toujours vire l’anneau criant de milliers d’hirondelles noires, blanches, noires, blanches, pointues ? Il se déciderait pour un volcan jeune encore, au cratère bien conservé et qui les résumerait tous. Un an après, au pied du volcan enfin construit, Guanamiru se demandait si les éruptions se produiraient à jours fixes ou inopinément pour laisser au mont un caractère scientifique en même temps que romanesque. Pourquoi ne préparait-il pas aussi, alternant avec les autres, des éruptions de charité où les secours aux pauvres auraient passé par le cratère ? – 17 – « Ne suis-je pas un philanthrope ? Voilà que je l’oubliais. » Mais était-il raisonnable de diriger ainsi la charité vers un cône éruptif ? Que ne proposait-il la même voie à d’autres vertus dont le choix restait à faire (la tempérance, l’énergie, le civisme) ? Cet itinéraire n’était-il pas un peu farce ? N’eût-il pas mieux valu aider les pauvres avec moins de tapage et laisser les vertus à leur place habituelle, légèrement à gauche, dans le cœur des hommes ? Il verrait… En attendant il donna au volcan le nom de Futur, qui permettait tous les espoirs. L’équipage volcanique se composait de quarante hommes en tenue de cratère, je veux dire entièrement nus. En raison de l’intense chaleur et d’un naturel souci de décence, on s’était contenté de leur tatouer des vêtements, ou plutôt les revers du veston, les boutons du gilet et la raie du pantalon. Un contremaître également nu les commandait : il portait deux traits de plus que ses hommes. Obliques, ils figuraient les pans d’une inexistante jaquette. Guanamiru faisait part à ses intimes de son grand désir de bien faire. Il les interrogeait sur l’impression qu’ils avaient gardée des derniers essais. – Que dites-vous de ma colonne de fumée, demandait-il un jour au Ministre de l’Instruction Publique ? Préfériez-vous celle de la dernière éruption qui tirait sur le rouge ? Dites-moi votre sentiment en toute sincérité… J’attends ces jours-ci de la paille très fumeuse qui doit m’arriver de Hongrie et dont on m’a dit le plus grand bien. Je la comparerai avec des échantillons d’Australie et des Indes. Je ne veux rien laisser au hasard. Mais vous ne me dites rien, Monsieur le Ministre… – Et ne pensez-vous pas, mon cher ami, dit le Ministre rougissant, qu’il faudrait peut-être encourager l’agriculture du pays ? – 18 – – Je n’exclurai pas de mes expériences la paille de la Nation. Libre à elle de me prouver sa supériorité. Si je n’agis pas en toute impartialité, je supplie mes amis de me dire : « Mais, mon cher Guanamiru, faites attention. Ne croyez-vous pas… » etc., n’est-ce pas Monsieur le Ministre ? » Il ne pensait plus qu’à tout ce qui fumait. Dès qu’un incendie éclatait en ville, il allait s’assurer que les différentes matières inflammables faisaient bien leur devoir. Des pompiers le surprirent un jour prenant ouvertement parti pour l’incendie qu’il applaudissait avec violence, tout en insultant les lances et l’eau courante. – Bravo, fuego, bravo, criait-il. Il avait jeté sa canne et son chapeau dans le brasier en signe de joie et se disposait à y précipiter des cigares de la Havane, lorsque le bras étoilé du chef des pompiers arrêta vivement ce geste. On le menaça de porter plainte s’il ne retirait pas immédiatement du bûcher ses paroles séditieuses et sa canne à moitié brûlée. – « Je suis un artiste ! hurla Guanamiru ; vous ne comprendrez jamais ce que c’est. » Et il tourna le dos à l’ignorance et à l’incendie pour s’engouffrer dans sa limousine, dont il abaissa les rideaux de fer qui l’isolaient de la bêtise ambiante. Le jour de l’inauguration, on vit apparaître Guanamiru au sommet du volcan comme à un balcon : il venait de prendre le monte-lave. Mais tout de suite, il ressentit une grande gêne : à quelle partie du public convenait-il de s’adresser ? « Mes amis, quoi de plus beau qu’un volcan, cette réaction de la matière fluide et ignée contre la croûte terrestre consolidée ? » – 19 – Guanamiru se mit alors à pivoter peu à peu sur ses talons si bien que chaque spectateur n’était touché que par de faibles parties de son discours. Le reste s’en allait avec le profil de plus en plus perdu de l’orateur, qui s’arrêtait parfois un instant de parler pour faire signe à ceux qu’il quittait de bien vouloir patienter : il leur reviendrait sous peu. Comme il évoquait l’immensité de son effort, l’estanciero, mû tout d’un coup par une émotion giratoire, fit un tour complet sur lui-même et revint exactement à son point de départ dans une pétarade d’applaudissements. « Qu’on ne vienne pas m’objecter, poursuivit-il, qu’un volcan qui n’existait pas il y a deux ans, même dans mon esprit, soit un monstre sans valeur scientifique. La rapidité de sa création ne diminue en rien son coefficient de sérieux, ni sa portée géologique et révélatrice. Pour vous le mieux prouver, j’eusse voulu pouvoir toujours effectuer l’éruption complète ; mais le prix de revient de la lave à la température voulue est actuellement considérable (plus de 300 piastres la tonne) et je ne pourrai malgré toute ma bonne volonté vous donner des éruptions de ce genre qu’à l’occasion des fêtes nationales ou olympiques à moins que le Gouvernement ne veuille bien m’aider dans ma tâche. Je me hâte d’ajouter que la lave ne fait pas le volcan, qu’il y a notamment à Java, des volcans à éruptions sans lave et que les Javanais n’y ont jamais rien trouvé à redire. Le jeudi, jour réservé aux élèves des écoles, ce Vésuve des temps nouveaux vomira gratuitement des recettes utiles, des petits pains de savon et de pierre ponce, des jeux de patience incassables aux peintures nourrissantes ou rafraîchissantes selon le désir exprimé par les parents. Il y aura aussi, à des dates indéterminées, des éruptionssurprise qui, s’inspirant des besoins du moment, répandront des médicaments enveloppés, des livres de morale cartonnés avec soin, des instruments aratoires à l’état de neuf, des – 20 – tondeuses mécaniques, ou bien, dans un vivant ordre d’idées, des agneaux Rambouillet et des porcelets Blackhead. Et ainsi, Messieurs, je serai parvenu à troquer ce qui, s’il avait existé, eût été un effroyable fléau pour le pays, en un phénomène indispensable et vraiment moderne, en un distributeur pratique, qui en quelques jours fera davantage pour l’humanité que tous les autres volcans de la terre durant des milliers de siècles. » Les applaudissements n’avaient pas encore cessé que les lèvres de Guanamiru livrèrent passage à de nouvelles paroles : « Si une de ces dames pour éprouver le bon fonctionnement du volcan, daigne me confier un objet quelconque, elle ne sera pas longue à se le voir retourner intact au moyen de mes lanceurs de divers modèles. » Quelques instants après, en reprenant possession du mouchoir qu’elle venait de prêter aux lance-scories, une dame disait : « Il est encore tout chaud. » D’émotion, Guanamiru pleurait des larmes brûlantes qui venaient directement du centre de la terre. Le discours ne fut que très difficilement reconstitué grâce à l’interrogatoire de plus de cinq cents personnes assises autour du volcan et qui n’avaient perçu que quelques mots de l’orateur rotatif. La presse ne sachant trop qu’en dire opta pour l’enthousiasme. Mais un journal hebdomadaire El Porvenir de la Raza, qui prenait le temps de la réflexion, se fit remarquer par ses critiques, et alla même jusqu’à prétendre que « le volcan pourrait bien à la longue prendre racine et souffrir, à force de les simuler, de véritables coliques éruptives. C’était là, ajoutait– 21 – il, un cas bien connu des hommes de science, notamment en psychiatrie, et il ne convenait pas de narguer ainsi la nature ou la divinité qui avait eu de bonnes raisons de ne pas ériger un volcan en ce lieu précis, non plus qu’en tout autre point du pays. Ne devait-on pas se juger heureux d’être à l’abri de ces énormes montagnes encore mal connues et pleines de dangers ? Et on objectait pêle-mêle les raz de marée, les volcans du Chili, des villes anéanties, l’arrêt du commerce et du trafic sous une pluie de cendres. » « Hypothèse grossière ! » riposta Guanamiru dans le journal officieux. La psychiatrie n’avait rien à voir là-dedans et il était ridicule « dans l’état actuel de la science » d’assimiler le volcan à l’homme. La population pouvait être rassurée. La trajectoire des cendres, sables, scories et corps divers avait fait l’objet d’études de toute sorte menées à bien par des spécialistes scrupuleux. Plusieurs d’entre eux désirant montrer leur confiance dans les lanceurs n’avaient-ils pas offert de s’y livrer pour être précipités dans le vide, un vide de dix mètres, mais si étudié, si apprivoisé par les calculs et les sondages qu’il ne présentait plus aucun danger ? La semaine suivante les attaques de l’Avenir de la Race reprirent avec une perfidie accrue. Ce journal prétendit d’abord ironiquement que les éloges décernés jusque-là à Guanamiru n’étaient « nullement en rapport avec sa situation de fortune, ni avec sa rayonnante prestance, ni avec le parfait ovale de son visage réfléchi. » « En présence de cette injustice, ajoutait-il, le constructeur du volcan incompris a décidé d’émigrer ; il s’est mis en rapport avec une compagnie américaine pour l’achat d’un volcan sousmarin en plein Atlantique. L’affaire ne tardera pas à se conclure mais les intéressés n’ont pu se mettre d’accord jusqu’ici sur la date de livraison de cette montagne. » – 22 – Pour donner un fondement à ce bruit, le journal affirmait que l’estanciero « apprenait à nager, à plonger, et passait une partie de la journée à boire avec des scaphandriers. » La fourberie de ces attaques, la molle défense des autres journaux n’étaient pas faites pour rendre à Guanamiru la sérénité qu’il avait perdue. Dans sa dépression n’avait-il pas remarqué jusque dans son palais une véritable hostilité à son endroit ? Ses portraits de famille s’étaient mis à le regarder de travers. Ses cigares tiraient mal et en maugréant, son stylo fuyait dans la campagne, les robinets de la salle de bain et du cabinet de toilette, animés d’un fort mauvais esprit, persécutaient goutte à goutte ses insomnies. S’il ouvrait ses armoires, elles vagissaient, si son coffre-fort, il avait changé de chiffre au milieu de la nuit. Quand sa montre retardait, la pendule de sa chambre avançait d’autant, ce qui, tout en permettant des calculs, supposait une angoissante complicité. Un tableau se retourna en plein jour dans son cabinet de travail ; deux autres échangèrent leurs signatures, puis leurs cadres. Un quatrième qui représentait une femme se rendant au marché pour y vendre des oies devint une paysanne de retour du marché avec des cochons. – Hum, conclut Guanamiru, il est temps de changer d’air. – 23 – III DICTIONNAIRE Qu’allait-il faire de son volcan durant le grand voyage qu’il projetait ? Toute la journée il fourgonnait en vain dans sa cervelle à la recherche d’une solution. Une nuit, avant de se coucher, il pressentit qu’il lui fallait immédiatement se rendre dans la salle à manger. Guanamiru ne s’était pas trompé. Le conseil attendu depuis plusieurs jours se trouvait sur un grand plat d’argent au milieu de la table. Sitôt la porte ouverte, l’homme de la prairie y lut en capitales d’or rehaussées de faveurs saphir : EMPORTER LE VOLCAN EN EUROPE Il se dirigea vers le plat, se pencha dessus, vit qu’il avait bien lu et aussitôt la vision disparut. « Emporter le volcan », mais oui, puisqu’on était indigne de le comprendre dans ce pays. « Emporter le volcan ! » Ces trois mots accompagnaient maintenant Guanamiru même dans les lieux où il s’était toujours aventuré seul jusquelà. Que signifiait d’abord le mot emporter ? S’il en découvrait le sens exact… – 24 – S’il en découvrait le sens exact, sa tâche en serait singulièrement facilitée. Il ouvrit le Larousse ou ce qui en tenait lieu dans son pays et lut à peu près ce qui suit : « Emporter (em de en, et porter) v. a. enlever, porter ailleurs, porter avec soi. Les commerçants chinois emportent en Chine tout ce qu’ils gagnent dans les colonies. – Emporter une position : la prendre de vive force. » Il chercha aux synonymes et lut : enlever, emmener, ôter, charrier, entraîner, exporter. Guanamiru se dit que s’il ne pouvait emporter Futur, il lui serait peut-être plus facile de l’emmener, l’ôter, le charrier, l’entraîner, l’exporter. Avec un peu de patience, il trouverait peut-être le mot qui secrète la chose. N’y parvenant pas, il pensa que le plus simple était de convoquer les quatorze emballeurs de la ville desquels c’était là l’affaire, après tout. Mais auparavant, il divisa le volcan en quatorze secteurs avec des raies à la chaux. Quand les emballeurs furent arrivés à pied d’œuvre, il leur fit valoir qu’il s’était donné infiniment de mal jusqu’alors. « Toute cette peine serait stérile, vains mes jours de travail et mes nuits canonnées en tous sens par l’insomnie, si je ne pouvais quitter mon pays avec mon cher ouvrage. » Il comptait sur eux pour faire connaître à Paris son volcan en même temps que son pays dont il démontrerait l’existence, la noblesse et les besoins. Le mont serait emporté de l’autre côté des mers en tranches bien découpées et numérotées afin d’éviter tout désordre et des chevauchements. L’emballage de Futur, de sa base au sommet de la fumée, demandait huit jours. Guanamiru en accorda douze, qu’il alla passer dans une de ses estancias. L’homme de la Pampa fut de retour à Las Delicias dès l’aube du douzième jour. – 25 – Alors que sa voiture s’engageait dans le quartier du port, elle dut s’arrêter net devant une triple et longue file de tombereaux aboutissant à deux cargos en partance. Tout le volcan était là au hasard affreux des pelletées, en méconnaissables fragments. Les quatre-vingt-dix machines de tout modèle servant aux éruptions avaient vieilli si vite en quelques jours qu’elles portaient une interminable barbe de rouille et semblaient attendre leur tour à la porte des Enfers. Des sacs de scories se plaignaient encore faiblement, çà et là, tandis que les charretiers jouaient aux palets avec des manettes arrachées, ou se taillaient des ceintures dans les courroies de transmission. Trois d’entre eux, accroupis autour d’une caisse de fumée condensée qui devait servir à Paris le jour de la première, l’avaient entr’ouverte avec une barre de fer, « pour voir », et aux dernières convulsions de son contenu mêlaient doucement la fumée de leurs pipes napolitaines. Il fallait un symbole à tout ce désarroi : les colonnes des ascenseurs funèbrement tronquées en fournirent plusieurs de divers modèles. Guanamiru, livide dans un petit jour de condamné à mort avançait hors de souffle, criant aux charretiers : « Mais qu’ont-ils fait ? Qu’avez-vous fait ? Qu’ai-je donc fait pour qu’on me traite de la sorte ? » Il allait de tombereau en tombereau, risquant à chaque pas de se faire écraser par les chevaux énervés de mouches. « Arrêtez ! cria-t-il. Ne déchargez pas ! C’est moi qui commande, vous entendez ? Il y a déjà deux tombereaux de déchargés ? Qu’on les recharge immédiatement ! » Enfin il aperçut le chef des charretiers au regard dressé comme un poignard, portrait rouge et en pied, peint avec une incroyable vulgarité dans son cadre de crime. – 26 – – « Ah ! c’est vous ? » fit Guanamiru qui ne put ajouter un seul mot durant les huit jours qui suivirent. La douleur de l’estanciero de voir son volcan anéanti ne cessait de creuser dans son esprit des tunnels mal éclairés. De sa montagne ardente il ne restait plus, intacte, que la housse imperméable dont on la recouvrait les jours de pluie. Il n’osait plus regarder devant lui, ni alentour, tout pouvant lui devenir un sujet de souffrance. Obsession volcanique ! Le moindre monticule destiné à la réparation des routes lui donnait des sueurs froides ainsi que la fumée la plus ténue. Il se promenait longuement le long de la mer, comptant sur la patience des vagues pour effacer d’atroces souvenirs. Or, un jour, huit marins noirs de l’État emportèrent au large ce qui restait de sa raison, à toutes rames. Les hommes ne tournèrent même pas la tête malgré les appels poussés par Guanamiru jusqu’à ce que le canot ne fût plus qu’un petit cachet avalé par l’horizon. Cette nuit-là l’odeur d’une rose inclinée sur sa face devait le haler doucement du sommeil. Puis ce fut un parfum composé, comme si on avait ouvert une fenêtre donnant sur du linge fin et vingt plantes aromatiques. L’air s’emplissait d’exquises incertitudes, se creusait de voluptés, comme une hanche de femme. Des silences se mettaient en route sur d’invisibles radeaux, puis chaviraient multicolores. D’autres les remplaçaient aussitôt. La mer et les jardins se joignirent dans les airs et fraternisèrent longuement. Une immense caravane, allant de la terre au ciel entraîna si bien Guanamiru qu’il respira de tout près un bouquet d’étoiles sous l’éventail incliné de la pleine lune. – 27 – Il semblait à l’estanciero que le monde las de ses formes et de ses volumes avait opté pour l’impalpable et ne se révélait plus que par des senteurs chargées d’intentions et de subtils sous-entendus. Les choses livraient leur mémoire, leurs préférences et leurs scrupules. Le secret de leur mélancolie ? Que penser de ces sensations qui prenaient pour Guanamiru autant de portée qu’une seconde naissance ? Et pour le monde aussi peut-être, c’était comme une remise en question dans les spasmes panthéistes d’un homme qui se noie. Les cheveux et le pyjama imprégnés d’infini, Guanamiru se leva. De la main il cherchait le commutateur électrique. Il alluma. Les odeurs se simplifièrent, se rangèrent, assagies, les unes à côté des autres comme les couleurs sur une palette. Prenaient-elles des habitudes d’ordre au voisinage de l’homme ? Guanamiru regarda autour de lui et ne vit rien que d’ordinaire. L’armoire fermée était à sa place, les flacons de parfums, bouchés, les tableaux, bien sagement accrochés aux murs, le bureau se dressait sur ses quatre pieds, le pot de colle retenait son oblique pinceau, les murs et le plafond s’acquittaient paisiblement de leurs fonctions habituelles. Nulle chaise n’avait bronché. Sur un guéridon se trouvait une valise vide qui ne quittait jamais la chambre de Guanamiru, les voyages faisant partie de ses prévisions quotidiennes. Pourquoi ses mains tremblaientelles ainsi quand il la toucha ? Et que pressentait-il ? À peine l’eut-il ouverte que les miraculeuses senteurs redoublèrent de vaillance. Qu’y avait-il donc là-dedans ? Un brûle-parfums, peut-être ? Guanamiru se pencha. Tout d’abord il crut avoir mal vu. Il approcha la lampe ! Mais oui, c’était bien un petit volcan. Du type brun, il ressemblait absolument à Futur. Dans un ordre parfait, Guanamiru reconnut le cratère, le monte-lave, la chambre de chauffe. Il soupesa la valise, légère comme si elle n’eût enfermé qu’un désir. « Le poids lui viendra peu à peu par la suite », pensa Guanamiru. – 28 – Le lendemain dès son réveil, l’homme de la Pampa, nupieds, s’en fut voir son secret ; le petit mont était toujours là. La valise lui paraissait déjà un peu plus lourde. Guanamiru se coucha et se rendormit environné de bruissantes félicités. Comme on lui apportait son courrier, il pensa peut-être y trouver un éclaircissement. Celui qui avait mis Futur dans la valise allait-il lui écrire ? Lentement il déchira une enveloppe contenant une note de son chemisier. Il se disposait à lui envoyer un chèque, quand il s’avisa d’examiner si ce papier d’apparence insignifiante ne cachait aucune écriture à l’encre sympathique. Un à un, il essaya en vain tous ses révélateurs. Il paya, reçut le lendemain une facture acquittée, décolla le timbre pour voir s’il ne recélait pas quelque message. Mais rien, rien n’apparaissait là-dessous. Les jours suivants il s’attendit à une mystérieuse communication téléphonique qui eût permis à l’auteur du miracle de lui donner des indications sur l’usage qu’on pouvait faire de ce volcan, sur son mode d’emploi. Il craignait de s’éloigner de son appareil croyant à tout moment qu’il allait entendre une voix : – Allo, Allo. Je suis la très Sainte-Vierge. Avez-vous un petit renseignement à me demander ? La nuit, Futur, ou plutôt son modèle réduit, continuait de répandre dans les airs ses fluides merveilleux, assez forts pour affirmer leur présence même à travers le bois de l’armoire où la valise était enfermée. De durée à peu près égale, les odeurs se succédaient maintenant avec rapidité, l’une effaçant totalement la précédente. L’héliotrope revenait souvent, « comme le stop dans les télégrammes ! » se dit soudain l’estanciero qui venait enfin de comprendre. Une voix lui parlait là-dedans émanant d’un monde ignoré et qui l’avait choisi comme confident, une voix qui savait sans doute pourquoi l’homme s’obstine à demeurer sur cette terre avec ses yeux vifs et son âme maladroite. – 29 – Il s’agissait maintenant de déchiffrer les messages. Guanamiru alla droit chez le libraire acheter un carnet où il fit la liste de tous les parfums qui se manifestaient à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. En regard il nota le sens qu’il croyait pouvoir leur attribuer. Au début, ces communications relevaient surtout de la métaphysique. Elles dominaient l’homme de si haut qu’il ne les affrontait qu’avec terreur, le menton sur la poitrine, et en touchant du bois de fer. L’ambre s’était rapidement spécialisé dans les questions de l’au-delà. Il signifiait suivant sa force ou ses nuances : « Dieu n’est pas loin. – Vade retro Satanas ! – Et pourquoi donc ? » L’œillet s’exerçait à la politesse la plus exquise, commençait ses phrases par : « J’ai l’honneur » et finissait toujours aux pieds de Guanamiru. Il disait aussi : « À vos souhaits », « Je n’en ferai rien », « Guanamiru d’abord ! » Il ne reculait pas non plus devant des formules surannées telles que « Mille grâces », et semblait toujours disposé à offrir sa place aux dames dans les tramways. D’autres senteurs invitaient à la plus grande prudence : « Attention, disait le pétrole, ne lisez pas votre journal dans la rue. Il y passe des autos et même des camions mangeurs de chair crue. » Certaines odeurs équivalaient à de simples constatations : « Il pleut », « Vous avez du génie » ; des acquiescements : « Entendu, à demain » ; des réserves : « Pas tout de suite, nous en reparlerons » ; des promesses : « Soyez tranquille je m’engage à vous donner une magnifique éruption. » Les communications manquaient parfois de clarté, ou se faisaient si fragmentaires que Guanamiru ne les pouvait traduire en concepts ou en simples vocables ; c’était comme une brume de pensée, des larves d’idées, ou même des lettres isolées, des signes de ponctuation, et c’est ainsi que dans la même matinée il n’y eut qu’une suite remarquée de points virgules, des trémas sans voyelles, des cédilles toutes seules, des – 30 – barres de la lettre t, une assonance, deux rimes féminines, un point à la ligne, un fa dièze. « Que m’arrive-t-il ? songeait Guanamiru ; voilà que je suis muni d’un volcan qui cause et me donne des conseils. » Quand il s’adressait à ses semblables, il ne leur montrait plus comme autrefois le visage d’un homme parmi les hommes ; ses traits vernis de mystère s’enflammaient sous un soleil nouveau qui l’avait choisi parmi tous les hommes pour éprouver ses rayons. Il allait sans se gêner, jusqu’au fond de l’âme de ses interlocuteurs où il pénétrait la canne haute, le chapeau sur la tête et un œillet safran à la boutonnière. Que diraient-elles, si elles savaient, toutes ces petites gens qui rôdaient dans les rues ? Il ne leur en parlerait même pas. Il partirait pour Paris, et là-bas, après une éruption de premier ordre, peut-être révélerait-il son secret. Il quitterait ce pays, n’emmenant ou n’emportant avec lui que son contremaître Innombrable, un tatou vivant, et, pour parer au mauvais sort, un autre empaillé, puis, dans vingt-deux boîtes numérotées, un peu de terre de ses estancias. Il n’oublierait pas non plus sa collection de vieux matés incrustés d’argent qu’il envelopperait dans de délicats sourires d’enfance. Ni un coffret d’ébène fermé à clé et qu’un esprit mal informé aurait pu croire entièrement vide, alors qu’il contenait toute la douceur et le ciel du pays natal. L’estanciero se munirait aussi d’un lasso ; en voyage, le superflu lui était aussi indispensable que son système artériel et les battements de son cœur. Huit jours avant son départ, il demanda à visiter sa cabine. L’estanciero s’y lava longuement les mains, demanda des serviettes, s’informa si elles étaient vraiment pareilles à celles qu’on lui donnerait pendant son voyage en Europe, s’essuya avec soin, s’allongea dans le lit de cuivre, regarda sous l’oreiller, – 31 – le tâta, en extirpa une plume qu’il inséra à nouveau après l’avoir examinée et humée. Il sonna pour voir le garçon, se nomma, lui donna cinq piastres et le congédia avec un sourire qui en promettait cinquante. Il compta de haut en bas et de bas en haut les carrés noirs de sa descente de lit jusqu’à la petite table nocturne, d’un jet dora le vase pour se rendre compte, et ne sortit qu’après avoir ramassé quelques fleurs du tapis, desquelles il fit un petit bouquet. Avant de quitter le navire, Guanamiru demanda à voir le Commandant, se nomma, lui annonça qu’il partait pour l’Europe en voyage scientifique, s’excusa de ne pouvoir lui en dire plus long, lui fit compliment sur la tenue de son bateau et brusquement prit congé, lui tendant une main carrée qu’il avait cachée jusque-là et où hennissait, sans discontinuer, sur un camée rouge, un cheval marin. – 32 – IV LES CERISES MARINES La ville de Las Delicias venait d’être étouffée à l’horizon entre le lit de la mer et l’édredon d’un nuage d’où s’échappaient des mouettes. Longtemps, Guanamiru demeura accoudé au bastingage, les yeux fixés sur l’immense plaine maritime. À mesure qu’elles se déroulaient, il pensait créer toutes ces vagues tant elles prolongeaient exactement autour de lui l’inépuisable houle de son âme. De retour dans sa cabine, ses yeux allèrent de la blancheur de son lit à la glace de l’armoire, en passant par le rectangle du sabord coupé d’azur, roulant à chaque déhanchement du paquebot. Comme la mélancolie du départ affleurait sous son front couronné par les bluets en papier du souvenir, il entr’ouvrit la valise hantée, en huma l’intérieur, soupira de satisfaction et la referma. Il avait confiance. L’avenir était là sous ses mains et il en avait la clef dans sa poche. Il installerait Futur en plein Paris dans le 1er arrondissement. À la réflexion, il trouva très naturel que nul Européen n’eut songé à construire un volcan et qu’ils se fussent contentés, jusque-là, d’églises, palais, immeubles, hôpitaux, ponts, becs de gaz et montagnes russes. Il ne méconnaissait pas l’intelligence ni même les talents de ces gens-là, mais vraiment ils étaient trop prisonniers de leurs études classiques pour concevoir des projets nouveaux. – 33 – Tout à coup la crainte d’être devancé paralysa sa joie sonnante. Allait-il lire dans un journal, à la première escale, qu’on avait commencé de construire à Paris un grand volcan comme celui qu’il méditait ? Non, il serait le premier ! Le premier ! Le mot rayonnant qui habite les hommes depuis les bancs du lycée jusqu’à une toujours possible guillotine, que chacun voudrait éviter avant tout autre, le mot tumultueux courait en tous sens sous la peau de Guanamiru. Le premier ! répétait-il en descendant les six marches qui menaient au bar où il cria : « Garçon, un whisky ! Et qu’il soit mâle ! » Mais le garçon fort occupé ne venait pas et Guanamiru dut attendre sa boisson dans la honte d’avoir prononcé une expression imagée qui avait pris corps dans le silence du bar où elle se balançait au plafonnier. Il monta sur le pont, s’installa sur sa chaise-longue, la plus opulente, la plus prévoyante du bord avec ses plaids, ses fourrures, son pupitre et son écran qui, du côté brodé, cachait la mer et de l’autre, la grossissait dix fois. Au bout de quelques instants, étrange fut sa surprise de voir Futur près de lui sur le pont. – Comment, c’est toi ? Mais n’as-tu pas peur de te montrer ainsi ? – Sois tranquille, nul ne me voit. – En es-tu sûr ? dit Guanamiru qui comprenait maintenant tout de suite le sens des fluides volcaniques sans avoir recours au petit lexique qu’il s’était préparé. – Aussi sûr que tu m’appelles Futur, respectable Juan Fernandez y Guanamiru. – 34 – – Tu m’as fait peur. La moindre imprudence gâterait le fruit de cent semaines de patience. Pourrait-on savoir ce qui t’a poussé à quitter notre cabine de luxe ? – Je suis venu prendre un peu l’air. J’en ai bien le droit, j’imagine. – Il est évident que rien ne t’empêche d’aller et venir comme tu l’entends, puisque je suis seul à te voir. Mais, par pitié, sois prudent ! – On pourrait me marcher dessus qu’on ne s’apercevrait de rien. Moi non plus. – Et quoi de nouveau de ton côté ? Penses-tu vraiment pouvoir reprendre à Paris l’importance que tu avais à Las Delicias avant cette fatale journée des deux cents tombereaux ? – Je ferai beaucoup mieux ; jamais je ne me suis senti plus alerte. Cette cure d’inexistence me fait le plus grand bien, nul corps ne m’embarrasse maintenant. Je me sens plus de finesse et de ruse que le vent d’avril et prêt à susciter toutes les merveilles. Ma logique est fluide, aérienne et non plus à doses massives comme celle des hommes. – Je voudrais te demander quelque chose encore. Excusemoi si je n’en ai pas le droit. C’est difficile à dire. As-tu quelque accointance avec les morts, avec tous ces blancs Messieurs de dessous la terre ? Ne m’entraîneras-tu pas avant mon heure au royaume sérénissime ? – Allons donc ! dit Futur et il disparut dans une bouffée de menthe et de glycines d’autant plus agréable que l’on se trouvait à plus de 800 milles marins de tout jardin, même modeste. Le lendemain, Guanamiru savourant au sortir de la sieste un humide réveil des tropiques, se disait que les passagères étaient belles et que les hommes ne savaient vraiment pas se – 35 – tenir à bord. Il ajoutait à la cantonade qu’il lui aurait été fort agréable de voyager seul avec elles. Alors, sans qu’il ait eu à faire le plus petit geste, son esprit, toujours très correctement à son service, se saisit d’un passager et le jeta à la mer où celui-ci s’engloutit dans le plus grand silence. Puis à l’extrémité opposée du navire, ce fut le tour d’un second voyageur d’être lancé par-dessus bord, sans la plus légère difficulté, comme s’il s’était agi d’un journal de l’année précédente. D’autres les suivirent dans les flots : un commisvoyageur et ses échantillons, un industriel avec son usine en poche, un célibataire et ses amours contrariées, un maître d’armes et son plastron. Les membres de l’équipage et les officiers du bord furent, par prudence, maintenus à leur poste. Mais Guanamiru se débarrassa d’un second lieutenant aux longs yeux bleus énigmatiques, que les femmes du sud regardaient fixement comme si elles en attendaient un miracle. La plupart des hommes n’opposaient que des sourires aux gestes de l’estanciero. Certains le questionnaient du regard comme pour connaître les vraies raisons de son attitude. « Allons mon ami, quand il faut, il faut », répondait simplement Guanamiru. Parfois il ajoutait : « Voulez-vous une bouée de sauvetage ? C’est tout ce que je puis faire pour vous, mais je vous préviens que le navire ne s’arrêtera pas. Les ordres reçus sont formels. » Plusieurs passagers allèrent jusqu’à remercier l’homme au volcan de les libérer ainsi du fardeau vital et se retournèrent vers lui, dorés de courtoisie, alors qu’ils avaient déjà, à cheval sur la lisse, toute une longue jambe dans la mort. Mais l’un d’eux, Smith, dont la barbe cubique taillée comme un if avait particulièrement retenu l’attention de Guanamiru, se défendit si grossièrement que celui-ci se vit – 36 – obligé de lâcher prise, sous les coups de pied et les coups de poing. L’Américain remplaça les passagers sacrifiés par trois biches, une vache normande avec sa clarine, deux palmistes et un champ de trèfle à quatre feuilles. Il y avait aussi une source à cause des biches. Il fit jaillir le tout sous ses yeux sur le pont ; l’herbe était si drue, si vivante, qu’il fallait la tondre toutes les deux heures. Une paysanne s’en chargeait sans fatigue, qui était blanche et tiède comme un verre de lait frais-tiré. La cloche sonna pour le dîner abattant les images que sa cervelle avait proposées à Guanamiru et ressuscitant tous les passagers. Ceux-ci se promenaient ostensiblement, en smoking, plus décidés que jamais à vivre, boire des cocktails, poivrer leur viande, regarder les femmes et s’en servir sans s’inquiéter de l’heure. Leur bonne mine feignait-elle d’ignorer ce qui venait de se passer derrière les beaux yeux noirs de l’estanciero ? Morne et sans appétit, l’homme s’allongea sur sa chaise-longue et s’endormit pour échapper à tout ce monde dont la vitalité effroyable lui donnait le mal de mer. Deux jours passèrent. Guanamiru en profita pour découvrir que, en plein océan, si le ciel continue à se trouver audessus des hommes, c’est qu’il vaut mieux pour tout le monde qu’il en soit ainsi. Dans le cas inverse comment aurait-on pu résoudre les difficultés de la navigation, du moins avec les moyens dont on dispose actuellement ? Un matin, sur le pont, l’estanciero adossé au bastingage se demandait depuis un bon moment s’il tournerait la tête à droite. Il se sentait regardé. Comment résister à cet aimant ? C’était l’homme à la barbe d’if qui, envisagé par Guanamiru, s’intéressa brusquement à la forme de ses ongles, puis s’éloigna. Ainsi – 37 – Smith évitait-il avec soin toute fréquentation. Ses pieds décrivant un fuyant arc de cercle, il ne répondait que de très loin et obliquement aux questions qu’on lui posait. Tout chez lui paraissait suspect, jusqu’au journal qu’il tenait toujours à la main comme s’il devait être reconnu à ce signe. Par qui ? Avec ses pupilles rayées comme des carabines, l’homme de la Pampa s’approcha de Smith et vit qu’en tirant deux traits imaginaires, des yeux de l’homme à son journal, ils aboutissaient exactement au titre d’un article : « O crimen da Avenida dos Patos. » Guanamiru se laissa glisser jusqu’au fond d’une rêverie dont il ne sortit qu’au bout de deux heures, durant lesquelles il garda une absolue immobilité pour ne pas contrarier les moindres ondulations de sa pensée. Tout d’un coup, il monta sur la passerelle et confia au Commandant dans le creux velu de son oreille au pavillon hissé très haut : – Il y a un criminel à bord. Le Commandant se refusant à faire arrêter le passager, Guanamiru se livra à une enquête personnelle touchant de possibles complicités de Smith parmi les passagers d’entrepont. Rien n’en sortit, que de la cale un couple d’émigrants mal peignés dont le seul crime était d’exercer leur libertinage sur des sacs de café, et d’en avoir crevé un sous le poids d’une volupté double. Guanamiru prit alors sur soi de pénétrer à l’improviste dans la cabine de Smith avec le maître d’hôtel et deux garçons armés de serviettes. On le trouva qui se lavait naïvement les dents comme s’il comptait vivre encore de longs jours. Sur un signe de Guanamiru, les garçons s’emparèrent de lui alors qu’il tenait encore sa brosse de la main droite et laissait échapper de sa gauche un verre contenant une eau rose qu’on reconnut à l’odeur être de l’eau dentifrice. – 38 – Il fut aisé au chef de l’expédition de démontrer à ses aides que l’homme à la brosse possédait sous un faux nom une fausse barbe, et, sous cette fausse barbe, un véritable menton de criminel, menton qui cherchait à prendre la fuite dans l’échancrure d’un faux-col trop évasif pour être celui d’un honnête homme. Une main encore ornée de bagues fut trouvée dans la malle de cabine. Smith prétendit qu’il s’agissait d’une main de rechange. Craignant un accident toujours possible, il ne voyageait jamais sans elle. Comme on lui objectait que c’était là une main de femme et dans un état si délicat de putréfaction qu’elle n’aurait pu lui être d’aucune utilité, le suspect déclara l’avoir trouvée sur un banc de l’Avenida dos Patos à Rio Grande et l’avoir charitablement, recueillie dans l’espérance de pouvoir un jour la rendre à sa véritable propriétaire. Quant aux bagues qui l’ornaient, il fallait y voir des bijoux de famille, de sa famille à lui. Il les tenait de sa mère ou de sa sœur. Il ne se rappelait plus très bien. Ces explications ayant paru contradictoires, sinon embarrassées, Smith fut conduit chez le Commandant où il finit par avouer qu’il avait bien assassiné cette femme parce qu’elle n’avait pas voulu lui accorder sa main. Deux matelots conduisirent Smith au cachot. Guanamiru suivait. Le prisonnier, autorisé à dire un mot à l’estanciero, lui souffla : « Prenez garde au volcan ! » Et il tomba raide mort. Grandement ému par ces événements, Guanamiru rentra dans sa cabine où il se proposait de réfléchir dans la fraîche solitude des draps. Comment Smith avait-il connu l’existence du volcan ? D’où venait cette fuite ? Futur se doutait-il que Smith savait et que Guanamiru savait que l’assassin s’en doutait ? Il avait déjà commencé à se déshabiller, quand : – 39 – – Et tu te disposes à te coucher, ricana le volcan. Mais la journée n’est pas finie, paresseux ! « À l’avant clame : « Qui vive ? » Trouveras de la chair vive. » Sans même prendre garde que, pour la première fois, cette communication du volcan était rédigée, si l’on peut dire, en vers, Guanamiru, revêtu d’un pyjama mouron où picoraient des canaris, à la main un gilet de soie prairie avec des marguerites sauvages, se précipita dans la nuit et traversa sans se faire de mal la musique et les conversations qui se disputaient la maîtrise aérienne du pont. Suivi d’un médecin du bord, lequel, on ne sait trop pourquoi, pensa qu’on aurait peut-être besoin de lui, il descendit vers l’avant du paquebot où quelques émigrants qui n’avaient dîné que de pois chiches jouaient petitement de l’accordéon. À peine arrivé sur la proue, Guanamiru cria : « Qui vive ? » Une voix de femme gémissante, venue de l’étrave, semblait-il, demandait secours, dans un anglais fort correct. Guanamiru penché sur la lisse distingua un être qui paraissait absolument noir dans la nuit et qui monté à califourchon sur l’arête de la proue avait, d’un surnaturel coup de reins, tenté de changer la direction du paquebot pour le faire échouer sur l’écueil 327 k, connu de tous les marins naviguant dans ces parages. Le doute n’était plus possible. Il s’agissait d’une sirène noire comme on en voit encore sur les côtes d’Afrique du côté de l’équateur. Déjà le Commandant avait dirigé sur l’avant les feux d’un projecteur et on put voir que la sirène avait le type nocturne plutôt que noir. Pour n’être pas blanche, elle n’en attirait que – 40 – davantage le désir des hommes. Elle opposait aux regards des paupières abaissées et le glissement des eaux profondes. Son seul vêtement consistait en un collier de petites huîtres closes d’où gouttait encore un peu d’eau marine et désolée. Ayant embouché un porte-voix, Guanamiru annonçait déjà par trois fois : « Nous l’avons échappé belle. La femme que vous voyez devant vous est une sirène. » Il prit le temps de respirer, puis cria dans le tuyau de métal : « Mais c’est toute la question de la mythologie qui se pose. » L’émotion coupait ses paroles en parties inégales, tandis que la sirène demandait un peignoir. Le commissaire et le maître d’hôtel furent chargés de l’envelopper encore ruisselante dans un linge velu comme un zouave. En hâte, la jeune fille fut amenée sur la passerelle. Il fallut traverser le pont d’où toutes les femmes, même les plus laides, avaient disparu, comme si elles avaient craint pour le siège même – et le piège – de leur féminité. Mais on pouvait les voir qui regardaient curieusement par la vitre des sabords. Guanamiru fut autorisé à assister à l’interrogatoire. – Il y a donc encore des sirènes ? dit l’homme au volcan dont l’étonnement croissait, tandis que le Commandant regardait sa pendule pour savoir quand mourrait la femme marine qui ne pouvait vivre que deux heures loin de l’eau salée. – Mais la mer entière en est adorablement infestée, dit le Commandant par galanterie. Ne le saviez-vous pas ? C’est sans doute votre premier voyage. Tous les navigateurs en ont vu, mais on n’en parle point par crainte superstitieuse, ou bien on leur donne des noms cachant leur personnalité. Et c’est ainsi que durant la guerre, on les appelait mines sous-marines, torpilles, atrocités, déflagrations spontanées. Que devient la Marino-Marine, la sirène qui nous fit tant de mal en 1914-1918 ? – Mais elle va bien, je pense, dit la jeune fille de l’océan. Il y a longtemps que je ne l’ai vue. – 41 – Et la sirène devint céruléenne, de nocturne qu’elle était. Le Commandant et Guanamiru feignirent de ne pas s’en apercevoir, mais on les vit se raidir un peu sous l’émotion. – Savez-vous, dit le Commandant à Guanamiru, dans une parfaite affectation d’indifférence, pourquoi on avait donné ce nom à cette sirène ? Je voudrais l’entendre dire à Mademoiselle, pour voir si sa version confirme la mienne. – Ce nom est formé par les initiales des navires que la Marino-Marine a coulés. Il n’était à l’origine qu’un artifice mnémotechnique de nos services de renseignements. L’usage s’est peu à peu établi de nous appeler de cette façon ; plusieurs ont réussi à porter de très jolis noms. C’est ainsi que nous avons les sirènes Azurine, Colonel, Garce, Place de l’Opéra… Mais toutes n’ont pas pu choisir si heureusement : une sirène qui voulait s’appeler Nouvelle Julie, dut prendre le nom de Nouvelle Julip, le dernier bateau qu’elle coula ayant été, par suite d’une erreur d’information, le cargo grec Patris, quand elle croyait avoir pris soin du charbonnier anglais Eagle. – C’est exact, dit le Commandant ; et vous, quel est votre nom ? – Je suis la sirène 825, de la flottille petit g. – C’est gentil, mais vous méritez mieux. – C’est que je n’ai pas encore coulé de navires. – Vous le dites… – Je le jure. Et la sirène devint safran, de céruléenne qu’elle était. – Commandant, dit Guanamiru, je vous demande pardon, mais ma remarque me paraît présenter de l’intérêt. On m’avait appris autrefois que le corps des sirènes se terminait par une – 42 – queue de poisson vivace. Il n’en est pas question, je crois, chez Mademoiselle. – Oui, on dit ça, interrompit la sirène. Mais de quoi aurions-nous l’air maintenant avec une queue squameuse ? Il n’y a plus pour la porter que quelques vieillardes au fond de nos plus lointains villages. – Vous avez raison, dit Guanamiru, c’est le devoir de chacun d’évoluer dans la mesure de ses moyens. – À condition que ce soit dans les limites permises par le Code Maritime, dit le Commandant d’une voix qui voulait être sèche, mais que la présence de la femme amollissait singulièrement. – Alors vous avez de vraies jambes, Mademoiselle… reprit Guanamiru la voix un peu voilée. – Nous avons ce que nous avons, dit la sirène avec une discrétion sous-marine, tout en serrant le peignoir sur son corps. – Mais permettez-moi de vous poser une autre question : Comment se fait-il qu’au sortir de la mer vos cheveux ne soient même pas mouillés ? – Nos cheveux ont le don de sécheresse, nos pieds aussi, même quand nous avons plongé à plusieurs milliers de mètres. C’est une affaire d’habitude. Songez donc aux ennuis que nous éprouverions s’il en était autrement. Mais nous passerions le meilleur de notre vie à nous débattre parmi des rhumes et de vains essais d’une coiffure convenable, tandis qu’avec les pieds et les cheveux secs, on peut aller loin ! » Le Commandant pensa que le moment était venu des cocktails, puis du genièvre et du whisky. La jeune fille buvait bien et demanda la permission d’ajouter une pincée de sel dans les boissons servies. Elle semblait attacher à ce geste une – 43 – extrême importance. Tous ses mouvements, riches en noblesses des grandes profondeurs, laissaient un murmure de coquillage dans l’oreille aventureuse des deux hommes. Ses silences étaient d’une qualité si précieuse que de rares et fugitives pierreries les marquaient sur la table et les murs de la cabine. Le Commandant prit la parole qui était disponible depuis quelques délicieux instants : – Qu’avez-vous à dire pour votre défense, Mademoiselle, vous savez que vous risquez gros. La jeune fille sourit et aussitôt l’âme des deux hommes prit visiblement la forme et la couleur de ses lèvres humides si bien qu’ils en furent gênés tous les trois. – Vous semblez oublier que vous avez été surprise en flagrant délit, reprit le Commandant après un extraordinaire effort qui le fit devenir cramoisi. (Dans la zone amoureuse dont la sirène était le centre, il était en effet presque impossible à un être humain de faire un reproche à une femme). Je suis bien persuadé que votre chevelure, comme celle de vos camarades, est bourrée d’ampoules de coule-navire, que vous auriez pu nous injecter à la proue si on ne vous avait pas surprise en mauvaise posture, une jambe entre la coque et la chaîne de l’ancre. La sirène avait décroché une bouée de sauvetage et l’appuyant sur la table faisait mine de s’en servir comme d’un gouvernail de fortune. – C’est charmant, dit Guanamiru, voilà que maintenant vous dirigez le bateau. – Oui, n’est-ce pas ? fit le Commandant, vaincu et ravi. Je trouve cela simplement exquis et dans ma longue vie de marin je n’ai jamais rien vu de pareil. Quand un paquebot est conduit – 44 – par une sirène, c’est à bord une félicité désordonnée. Les nuages se réfugient au fumoir où ils font des ravages très appréciés dans le cerveau des buveurs. Toute la journée le cadran du bonheur sonne midi à quatorze heures. On trouve, sur le pont et dans le salon de musique, des fleurs de cerisiers marins et des broches de corail. Des messieurs en pantalon blanc les ramassent avec soin pour les offrir aux jeunes femmes qui toutes se déshabillent sur le pont avec des gestes naturels et leurs sourires, d’étape en étape, gagnent peu à peu tout leur corps. Cependant la sirène mûrissait un silence qui brillait sur ses dents et ses lèvres, comme l’écume maritime au passage du navire. Les hommes n’osant la toucher surveillaient leurs mains. Ils craignaient, au moindre contact, de perdre pied et l’âme, et de ne les retrouver qu’au fond de l’océan entre une algue et un poulpe. Alors, de safran qu’elle était, la sirène devint orangée de Valence, émeraude du Cap Vert, opale pure. Chaque fois qu’elle changeait de couleur, le Commandant et Guanamiru la suppliaient : – Je vous en prie, Mademoiselle, restez donc ainsi, vous êtes si bien ! Vous ne sauriez être plus belle. – C’est la perfection même, celle où la part de l’ange et celle du diable ne sont séparées que par un pointillé. Mais la sirène devint peu à peu si blanche, si merveilleusement, si naturellement blanche qu’elle semblait l’avoir toujours été. Guanamiru et le Commandant durent longuement se retenir au bois de la table pour ne pas tomber sur le flanc comme colombes foudroyées. – 45 – Sitôt la bouteille de genièvre vidée, la femme sous-marine prit une feuille de papier dans un classeur et se hâta d’y dessiner avec le stylo du Commandant une sole qu’escortaient des poissons volants. Elle enroula le papier, le glissa dans une bouteille vide et demanda la permission de la jeter à la mer par le sabord… – Oh ! tout ce que vous voudrez, dit le Commandant. Vous êtes chez vous. … pour que sa mère qui suivait le navire et devait déjà fort s’inquiéter sût bien qu’elle était en bonne santé et ne rentrerait pas dîner ce soir-là. Après le repas, comme on servait dans de légers verres des liqueurs si fortes qu’elles semblaient devoir les faire effondrer, Guanamiru s’aperçut que le visage du Commandant exprimait une gêne de plus en plus marquée. Ses rides s’étaient approfondies du double et ses yeux noirs d’ordinaire, semblaient deux taches rondes d’encre violette récemment séchées. Il savait que la jeune fille n’avait plus que cinq minutes à vivre et qu’en la gardant ainsi devant lui, il la condamnait à mort. Ce que n’ignorait pas non plus la sirène. Mais elle ne s’en émouvait pas, une de ses amies lui ayant dit qu’il suffisait d’avaler quelques pincées de sel pour éviter l’asphyxie. Elle aimait mieux puiser dans la salière que s’échapper par le sabord ouvert. N’ayant jusque-là fréquenté que des noyés, ces deux hommes aux yeux ouverts et dont les vêtements n’étaient même pas humides la charmaient étrangement. Elle se réjouissait dans l’obscur maritime de son âme de partager avec eux la joie qu’ils lui devaient. Soudain, elle chancela, étouffée, et tomba, un peu de sel au coin des lèvres, sans que l’horreur de la mort parût sur son visage. Comme son peignoir s’était entr’ouvert dans la chute, Guanamiru et le Commandant l’en recouvrirent avec soin. – 46 – – Oh ! elle est bien morte, dit le Commandant, l’oreille sur le cœur de la jeune fille lequel n’était plus maintenant qu’une rose désertée par son abeille. – Et pourquoi pas ? s’écria Guanamiru éclatant en sanglots et ne sachant plus très bien ce qu’il disait. – Nous ne pouvons plus garder ici ce corps admirable. Les règlements du bord sont formels. Il faut le jeter à la mer. – Dépêchons-nous, dit Guanamiru, qui n’osait s’avouer un grand espoir. – Prenez-la par les pieds, je tiendrai la tête. Qu’elle garde le peignoir (qui porte mes initiales, songeait le Commandant). Chastement, ils la lancèrent par-dessus bord avec toutes sortes de rugueuses précautions de quinquagénaires. Le Commandant, tête nue, observait un silence de marin en uniforme et Guanamiru à demi-agenouillé récitait, ce qu’il n’avait pas fait depuis vingt-cinq ans un « Padre Nuestro que estas en los Cielos ». À peine l’eurent-ils confiée aux vagues que la sirène, sous la caresse marine, ressuscitait, et un bras couleur de perle fantaisie, un peu plus grand que nature, se dressa dans un signe d’adieu. Sur la vague éclairée par le dessous, le Commandant et Guanamiru lurent le mot « Merci » en lettres phosphorescentes. C’était d’un très joli effet. – Elle vit ! Elle vit ! cria Guanamiru. – Nous sommes des criminels. Grâce à nous cette femme pourra faire encore le mal. Rentrons dans ma cabine. Je crois qu’il reste du gin. – 47 – De toute la nuit, Guanamiru ne put s’endormir. Il revoyait l’assassin Smith et ses trois mains, la sirène, le Commandant, les bouteilles et le peignoir, hélas ! entr’ouvert. Une allusion du volcan aux événements de la journée lui paraissait imminente. Mais celui-ci garda une indifférence absolue durant les jours qui suivirent et c’est à peine si, quand on cria : « Terre » au large des Canaries, il se mit à sentir finement les fruits des îles. Le temps se couvrit à l’approche des côtes de l’Europe. Futur proposa à Guanamiru de faire une partie de dames au moyen des nuages blancs et noirs que le ciel mettait à leur disposition. Mais aussitôt que Guanamiru ou son adversaire avançait un pion, c’étaient de fortes averses, ce qui indisposait les autres passagers, surtout les dames, et faisait pousser aux enfants des éclats de rire que l’on entendait jusqu’au ciel. L’homme du sud ne pouvait oublier la sirène. Tout de suite après le mot : « Merci », il avait cru lire sur les flots : « À bientôt ». Le Commandant prétendait que c’était impossible et ils en disputèrent longuement, le soir, en fumant des cigares devant les cinq verres où elle avait bu. Guanamiru pensait avoir bien lu. Pourtant le phare de Cordouan brillait déjà et la jeune fille de l’océan n’était pas revenue. « Après tout, c’est peut-être une façon de parler chez les sirènes, pensait l’homme au volcan. Elles disent à bientôt (comme d’autres, adieu) alors qu’elles ne comptent plus jamais, jamais, vous revoir dans ce monde ni dans l’autre ». – 48 – V PLAN DE PARIS Joie d’être enfin en France où il allait pouvoir donner sa mesure devant quatre-vingt millions d’yeux ! Durant son voyage en chemin de fer, de Bordeaux à Paris, l’homme de la Pampa qu’entouraient trois zones étanches d’orgueil cria à diverses reprises, par la portière de son compartiment, aux villageois rassemblés autour des clochers : « À droite par quatre, marche ! Guanamiru est arrivé. Suivez-le, vous n’avez qu’à longer la voie ferrée ; c’est toujours tout droit jusqu’à Paris. » À peine arrivé au …’s Hôtel, il le quitta pour faire à pied une promenade dans la capitale. Il s’imaginait avancer sous les regards tranchants des Parisiens, et que même les yeux des chevaux derrière les œillères, les yeux des caissières derrière leur comptoir, ceux des patrons derrière les caissières et l’œil unique de Dieu derrière les patrons, le considéraient avec curiosité et faisaient le tour de sa silhouette pour s’assurer de sa présence. Les maisons l’examinaient de toutes leurs fenêtres, les becs de gaz, ces spectres de fer, de toute leur rigidité et les arbres d’un regard répandu pour ainsi dire et délayé sur tout leur feuillage. « Arbres de la forêt parisienne, toujours au garde-à-vous et qui m’attendiez, leur dit-il dans une espèce d’ordre du jour, voici enfin Juan Fernandez y Guanamiru, de Las Delicias (Amérique du Sud). Si je suis à Paris, sachez dès maintenant que c’est pour des raisons importantes intéressant le sous-sol, la – 49 – surface et le ciel. Arbres ! je voudrais pouvoir vous commander repos ! et vous permettre une détente que vous n’avez que trop méritée. Dès que j’aurai réussi dans mon entreprise, il vous sera loisible, je vous le jure, de regagner les forêts voisines et de vous y retirer à jamais si les circonstances le permettent. » Si les arbres semblaient s’animer au passage de l’estanciero, les passants, comme il arrive souvent quand on voit une ville pour la première fois, lui laissaient l’impression de simples mannequins articulés, fort adroits sur leurs jambes : il s’imaginait pouvoir leur donner, sans qu’ils bronchassent, des coups de canne ou de parapluie. Et s’exercer au revolver sur ces cibles. Les monuments tels que l’Opéra, l’Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel, il les considérait beaucoup plus comme des reproductions assez fidèles que comme des originaux : des presse-papier monstrueux ou de géantes cartes postales. C’est seulement par la suite qu’ils devaient prendre leurs véritables proportions et de la profondeur, quand il eut monté au 3e étage de la tour Eiffel, vu la scène de l’Opéra sondée en tous sens par les Walkyries et passé, derrière un guide, sous l’Arc de Triomphe. Dans chacune des devantures de magasin, il reconnaissait, avec tous leurs détails, diverses succursales de son âme. La vitrine du fleuriste : voici des fragments tout frais de la sensibilité guanamirienne. Une inépuisable virginité. Penchant sur les fleurs un arrosoir de cristal, une main de femme va et vient toute seule, libre de bras et de corps, compréhensive, suave et polie d’habiter chez les fleurs. Si quelqu’un entre dans la boutique, il lui tombe dessus, au moment même qu’il ouvre la porte, des primes légères : pétales de roses si c’est une dame, d’œillets si c’est un monsieur et de violettes confites si c’est une petite fille. – 50 – L’étalage de cartes postales ; les grandes actrices sont là qui vous reçoivent chez elles. Et pourtant cela se passe au milieu du trottoir. Où est-on au juste ? Incertitude de l’amour. Ici, un coutelier : aciers au regard froid, rasoirs sérieux prêts à servir : hommes, ils fronceraient les sourcils. Comment fait cette blonde jeune fille pour garder ce sourire champêtre parmi toutes ces possibilités d’attentats et de crimes ? Il y a aussi dans un coin des revolvers et des cartouches au destinataire encore inconnu. Ivresse de l’anonymat ! Nous y voilà enfin : une boucherie. C’est une véritable boucherie. Les couteaux ont fini par servir. Le crime est perpétré, Guanamiru reconnaît sa complicité. On peut tourner autour de la victime décapitée. Pour donner le change, on a piqué dans la chair une plaque de cuivre : « Bœuf 1re qualité ». Les garçons bouchers sont debout comme le remords. Ils ne peuvent plus supporter la vue de leur victime et la débitent avec hâte, pour qu’il n’en soit plus question, à des passants affamés. Voici l’absolution : on la donne à l’estanciero dans cette boutique de coiffeur en lui vaporisant la face très longuement. On fait disparaître ensuite dans le lavabo toutes traces du crime, même mentales ; de celles-ci le shampoing se charge. On le renvoie ensuite chez lui, absolument pur avec de la poudre sur les joues et sur la nuque. Guanamiru se mit en quête d’un logement, l’hôtel avec son va-et-vient ne lui paraissant pas convenir à la profondeur de ses investigations. Il craignait aussi de se faire voler Futur. L’étranger ne trouva pas d’abord d’appartements entièrement libres et c’est tout au plus si on lui proposa deux maisons hantées dont il ne voulut point, trouvant suffisante la part qu’il faisait dans sa vie aux questions de l’au-delà. – 51 – Son désir de n’habiter que certaines rues ajoutait aux difficultés qu’il éprouvait à se loger. Peiné de n’avoir été salué en arrivant à la gare que par l’employé d’une agence de voyages qui lui prit 5 francs pour ce geste, il se dit que, en raison même de son obscurité dans la grande ville, il se devait d’habiter le boulevard Pasteur ou l’avenue Victor-Hugo dont les noms illustres lui convenaient tout à fait. Il se décida pour cette avenue, d’autant qu’il eut la chance extraordinaire de pouvoir se loger en face du square Lamartine, ce qui aurait doublé sa joie, si le voisinage de la charcuterie Victor-Hugo et de la crémerie Lamartine ne l’avait coupée en petits morceaux. Comment le Président Millerand autorisait-il de tels sacrilèges ? Et si le Consul de la République d’Ipatahi protestait au nom des peuples latins ? – Pourquoi n’ai-je pas encore une maîtresse dans cette baignoire, se disait un jour Guanamiru qui venait de découvrir une seconde salle de bain dans son grand appartement. Je m’occuperai ensuite de Futur. Ses pensées voluptueuses depuis son arrivée à Paris ne couraient-elles pas sans vergogne les rues et les boulevards, où elles avaient déjà attiré l’attention de divers agents des mœurs et de la circulation ? Il dit à son chauffeur de le conduire dans le quartier de l’Europe qu’on lui avait recommandé. Rue de Londres, une jeune femme passait dont les yeux bleus d’eau courante et ensoleillée débitaient en tous sens des milliers de regards. Guanamiru en reçut un double choc dans son cœur et dans sa mémoire. Elle ressemblait à la sirène. L’homme sauta de sa voiture et tout de suite se décida : – 52 – « Mademoiselle, voulez-vous permettre à un Américain du Sud de passage à Paris de vous faire remarquer qu’il ne pleut plus ? » Seul, le parapluie parut avoir entendu qui se referma immédiatement dans une rosée de larmes. Guanamiru en conclut que les objets marquent parfois plus de sensibilité que les femmes et il se disposait à ne pas poursuivre sa tentative, quand l’inconnue, ayant traversé la place de l’Europe, s’engagea dans la rue d’Édimbourg qu’un faible éclairage transformait en longue alcôve. Comme il se reprenait à espérer les joies lourdes qu’il fallait à son cœur orageux, la femme entra rapidement au numéro 49 dont elle referma la porte vitrée sans se retourner. S’ouvrit une fenêtre au second étage, alors qu’il hésitait sur ses deux pieds dont l’un pointait vers les Antilles et l’autre vers la mélancolie. Une ombre habillée de gris laissa tomber un rouleau de papier et fit signe à Guanamiru de s’éloigner. Cet objet que n’accompagnait aucun message renfermait une carte de l’Amérique du Sud revue et embellie avec le plus grand soin : toutes les rides, les verrues et les moindres défauts de la côte avaient disparu. Ainsi rajeunie, l’Amérique se présentait fort bien sur un fond d’azur maritime et paraissait tout au plus dix-huit ans. De retour chez lui, Guanamiru examina la carte de près et de loin et découvrit que l’Océan Atlantique y portait le nom d’Océan Indien. Un géographe connu, dont la science ne pouvait être mise en doute, ayant apposé sa griffe au bas de la carte, convainquit sans peine le Sud-Américain que c’était lui qui s’était trompé jusqu’alors. Le lendemain, l’étranger se rendit à nouveau rue d’Édimbourg. Au bout de quelques instants, la même fenêtre que la veille laissa choir un nouveau papier. C’était une carte d’Europe, peu ressemblante dans l’ensemble, mais l’air crâne et – 53 – respirant la bataille. On y voyait des îles, des chaînes de montagnes absolument nouvelles. Dans l’ensemble un très intéressant souci d’originalité. Les difficultés présentées par les découpures de la Bretagne et les pointes du Cotentin avaient été résolues dans deux larges courbes harmonieuses qui donnaient à la France 300.000 nouveaux habitants pris sur la mer, 52.000 hectares de bonnes terres, une dizaine de villes (dont un évêché) et 50 kilomètres d’un ciel absolument neuf mais si bien joint à l’ancien qu’on ne voyait pas le raccord. La Seine n’était plus qu’une rivière et se jetait modestement dans la Loire. Elle avait été remplacée par la Marne, qui depuis la guerre passait à Paris au milieu des acclamations et se terminait superbement dans la mer du Nord, entre Dunkerque et Calais. Comme la veille, on avait fait signe à Guanamiru de s’éloigner rapidement. Rentré chez lui, l’étranger regarda de près le papier, le plaça devant une lampe électrique et lut dans le filigrane : « À demain, 5 heures, devant la station du métro Châtelet. » Guanamiru se trouvait le lendemain au rendez-vous. La femme, qu’il n’eut pas de peine à reconnaître, portait un costume très heureusement illustré de 89 taches de couleur comme en montre la République quand elle a passé sa robe des départements. Un réticule qu’elle tenait à la main gauche avait un peu la forme de la Corse. Elle l’entraîna dans un bar où Guanamiru put l’examiner à loisir. Ce n’était pas la sirène, mais elle lui ressemblait par moments avec une sorte d’ostentation où l’Américain croyait voir des promesses encore mal définies. – Il y a longtemps que je vous connais, M. Juan Fernandez y Guanamiru. – Vous savez donc mon nom ? – 54 – – Vous venez de Las Delicias qui montre toute l’année, tendu sur ses six plages, un ciel bleu soulevé par le vent. Après une pause où Guanamiru distingua fort bien une violette double finement dessinée dans chacune des pupilles de Line : – Vous n’avez pas besoin de me conter votre histoire, reprit-elle. On ne parle que de vous dans les maisons de thé et les ascenseurs, mais les Parisiens feignent de vous ignorer pour vous laisser préparer en repos ce que vous savez. – N’est-ce pas ? dit Guanamiru, heureux jusqu’aux os. Et plaçant la Corse près de son eggnog, la jeune femme ajouta à voix basse : – On vend votre photographie sous le manteau. On la vend trois francs. – Je m’en doutais, dit Guanamiru que l’orgueil congestionnait. Mais pourrais-je savoir à qui j’ai le bonheur de parler ? – Line du Petit Jour. Je viens de rentrer d’un double voyage autour du monde, de l’Est à l’Ouest dans les bras d’un poète haïtien, puis, en sens inverse, sur les genoux d’un peintre scandinave. Ce qui m’a un peu brouillé les idées, comme vous l’allez voir. À force de regarder par la portière ou le hublot, j’ai longtemps cru que champs, moissons, forêts, montagnes, maisons, villes entières, tout cela avait perdu ses racines et ne les retrouverait plus jamais. Aussi quelle ne fut pas ma douleur le jour où l’on m’expliqua que tout ce mouvement n’était qu’illusion, qu’il fallait de nouveau croire sous ses mille formes à l’Immeuble, cette chose grossière et indécente en raison de son insistance et de sa présomptueuse stupidité. N’est-ce pas le mouvement ou tout au moins la possibilité de mouvement qui donne de l’esprit aux choses et de la politesse ? N’est-il pas horrible de penser que tout restera éternellement à la même – 55 – place depuis les montagnes jusqu’à la mer, cette énorme masse inutile, inachevée, bêtement salée partout, à qui on ne permet que les marées, fantaisie prévue, surveillée par la lune, laquelle ne tolère que les écarts de calendrier ? Durant cette sortie de la jolie femme, Guanamiru songeait : « Si ce n’est pas la sirène, pourquoi lui ressemble-t-elle à ce point ? Pourquoi sent-elle le varech et le large ? Le regard est le même, et aussi le nez, les lèvres, la gorge. Elle est parente de l’autre en mystère et féminité. Si loin de la mer va-t-elle tomber dans mes bras asphyxiée avec ses grands yeux où je viens de voir émigrer des dauphins ? Et qu’en penserait-on dans ce bar qui sent la sciure, le bout de cigare et les âmes confinées ? Elle vient d’avoir comme l’autre un geste menu de la main pour fixer derrière l’oreille une mèche échappée. Ressemblances des êtres, exquise solidarité des visages à travers les périls du temps et de l’espace, jusqu’où faut-il que vous soyez poussées pour que votre objet soit unique ? Et pourquoi ces deux vases identiques sur cette cheminée n’en formeront-ils jamais un seul ? – Si je pouvais du moins brouiller les pays comme des dominos ! reprit Line, qui, à l’aide d’une boussole et d’un crayon, venait de faire le point sur un coin de la table. Pousser un peu la Patagonie vers le Nord, le Groënland vers l’Est, donner aux pôles une allée de palmistes ! Est-il admissible qu’après mille siècles d’adorable persévérance les fleuves prennent tous leur source et se jettent dans la mer exactement au même point et que change seule l’eau qui les forme ? Composer de nouveaux paysages ! Que de fois me promenant dans la campagne ne me suis-je pas dit : Une nappe d’eau ferait bien ici. Il faudrait « le Lac » de Lamartine. – Pardon, Mademoiselle, savez-vous nager ? demanda tout d’un coup Guanamiru qui ne put se contenir plus longtemps. Cette interruption avait jeté la jeune femme dans de tels transports, qu’une petite vipère corail se dressa hors de son – 56 – corsage au décolleté jusqu’alors compatissant ; la langue ardente était à deux pointes fort soignées ; le venin prêt à servir. L’Américain ayant fait un écart de cheval : – Ce n’est rien, dit-elle. Une simple leçon de courtoisie. Vous n’avez plus rien à craindre. Le serpent a regagné les forêts brésiliennes. Mal remise de sa colère, elle mordillait son mouchoir. – Je serais bien malheureuse, dit-elle enfin, si nous n’avions le métro et le cinéma, qui eux du moins comprennent la fille du mouvement que je suis devenue. Comme Guanamiru avouait doucement ne pas connaître encore le chemin de fer souterrain, Line proposa de le lui révéler. Justement ils se trouvaient près de la station Hôtel-deVille où ils descendirent. Guanamiru en fut quitte pour dire à son chauffeur de les suivre. Les voici l’un près de l’autre dans le wagon. – Approchez-vous de la vitre. Appliquez dessus votre front. C’est cela même. Eh bien ? demanda-t-elle avec une curiosité frénétique. – Je ne vois qu’une forêt de murs, des vergers de ciment, un ciel d’ingénieurs, dur et voûté. Une angoissante impossibilité de soleil, d’immeubles, d’autobus ; au-dessus de nos têtes des milliers d’ampoules électriques et pas un avion. Pas le moindre petit eucalyptus devant nous, pas un sarment de vigne ni un brin d’herbe. Absence des vaches et des moutons, que vous devenez redoutable ! – Et dans les gares ? – Je vois une bascule qui pèse la lourdeur de l’atmosphère. Des lettres énormes qui finiront par nous dévorer. Toutes les couleurs se sont réfugiées sur les affiches où elles se défendent – 57 – avec fureur contre la monotonie agissante de dix mille petits pains de céramique. Des groupes de gens qui semblent mobilisés, hommes et femmes, en civil généralement, se réunissent pour commenter à voix basse et sans en avoir l’air la disparition de la lumière du jour. Des renforts humains accablés descendent les escaliers et se joignent aux groupes qui stationnent. Tous ces gens se mettent à l’alignement sur le quai comme s’ils allaient être passés en revue par le chef de gare, heureux de vivre à l’ombre d’une casquette blanche, qu’il finit par prendre pour un arbre tant elle lui donne de sérénité. – Et dans le train ? – Je ne vois que vous. – Regardez bien. – Je vois encore quelques jolies femmes qui en ont pris leur parti et semblent ne devoir plus jamais quitter le métro. Tout d’un coup l’une se lève, descend et l’on n’entend plus parler d’elle. – C’est tout ? – Des messieurs sont là assis ou debout qui attendent quelque chose comme un changement de régime. Je ne vois rien d’autre. – C’est pitié d’avoir le regard si court, dit Line du Petit Jour. Ne pouvez-vous donc l’allonger un peu ? Le mien va beaucoup plus avant, et ces voûtes souterraines, loin de l’arrêter, le stimulent merveilleusement. Elles me permettent de distinguer avec exactitude le complémentaire de ce paysage d’un si pauvre génie. Le nom de Palais-Royal donné à cette station n’est en réalité qu’un lapsus du Conseil Municipal ou plutôt une appellation incomplète. En réalité, mon bon ami, nous sommes à la frontière mexicaine et je vous le prouverai à la première occasion. – 58 – – Comment ça ? fit Guanamiru dont les cils prenaient feu autour des pupilles ardentes. – Ne voyez-vous pas que le chef de gare, quoi qu’il fasse, est un indien tout cru, que ses yeux ne sont pas français et qu’il a l’air contrarié des aztèques ? Il a caché ses chevaux et ses carabines. Penché sur le téléphone, ne demande-t-il pas du renfort dans un langage conventionnel ? Toutes ces flèches que vous prenez peut-être naïvement pour des signes permettant aux voyageurs du métro de se reconnaître dans ce labyrinthe sont de vraies flèches d’indien en plein vol ; elles finiront par tuer quelqu’un. Regardez cette chose maigre et hérissée qui semble nous regarder et que vous prenez sans doute, dans votre manie bien humaine de simplification, pour un homme qui attend sa rame de métro. Si vous vous en approchiez, vous verriez qu’il est couvert de longues épines et muni de dix bras. C’est un fragment de cactus géant des déserts américains. Il est là depuis cinquante ans à regarder sans comprendre de toute son épaisseur de plante grasse. Le pseudo perceur de billets n’est autre que le chef révolutionnaire Cuidado ! qui contrôle des laissez-passer. De temps à autre il arrache une plume à d’invisibles autruches qui passent et la fixe à son chapeau en signe de confiance. Tout ce monde, même végétal, compte sur une victoire prochaine et décisive. – Vous me parlez du Mexique, dit Guanamiru, comme si nous nous y trouvions toujours. Le train n’a pas cessé d’avancer depuis que vous m’avez montré le chef de gare aux yeux de làbas, trois stations se sont écoulées et nous avons changé une fois de ligne. – Qu’importe, ce sont là les hasards de la route dans un pays montagneux et encore mal exploité. – Je voudrais aller au Japon. – Le Japon ce n’est pas facile, il faudrait changer trentedeux fois de train et traverser douze fois la Seine. La compagnie – 59 – ne peut donner aucune indication sur l’heure d’arrivée et il y aurait vraiment trop de gares. Dès que nous aurons passé trois stations, quatre au plus, il me faudra descendre et rentrer chez moi au plus vite. J’ai aussi une mère. De la quatrième gare que le hasard voulut être celle des Couronnes, la jeune femme et Guanamiru remontèrent enfin au rez-de-chaussée parisien. L’auto de l’estanciero les attendait depuis un bon moment. Le soir même, Line et son compagnon se rendaient au cinéma. À peine furent-ils assis qu’elle s’écria : « Nous ne pouvions mieux tomber. C’est justement la suite de l’épisode que nous avons vu cet après-midi dans le métro. Je reconnais Cuidado ! et ses hommes. » Cependant les Mexicains ayant passé la frontière pour rafler du bétail, tournaient en hâte le dos à l’alerte qui venait d’être donnée. Ils s’enfuyaient poursuivis par le sheriff sur son alezan de nuit et cinquante hommes dans un nuage d’héroïsme ; mais la démente allure des Américains et l’épaisseur des ténèbres devaient bientôt les égarer. Au lieu de tourner à droite en sortant de la ville de San Diego, ils s’abattirent à toute volée, par-dessus l’orchestre symphonique, dans la salle du cinéma. De nombreux chevaux roulèrent à terre avec leurs cavaliers dans un vacarme de fer, fauteuils, gourmettes, freins et spectateurs. Le sheriff commanda : Rassemblement ! Précédée par lui, toute la troupe gagna le boulevard pour revenir vers l’écran par une porte secrète et ne devant servir qu’en pareil cas. Les applaudissements de Line et de Guanamiru se mêlaient à ceux des rares personnes qui n’avaient pas pris la fuite. La cavalerie, mieux dirigée cette fois, réussit à reprendre utilement la poursuite des Mexicains qui ne tardèrent pas à repasser la – 60 – frontière dans le plus grand désordre, en abandonnant leurs blessés. Il restait dans la salle, de tout ce passage cavalcadant, quarante et un fauteuils réduits à de petits tas de poussière, et çà et là quelques côtes brisées ainsi qu’une matière étrange qui à l’analyse fut reconnue être du crottin métaphysique. Devenu fou, le piano jouait tout seul les marches du répertoire. À minuit, ne pouvant mettre un terme à son délire mécanique, on décida de l’enfermer. Line et Guanamiru se trouvaient encore dans le cinéma. Ils avaient dîné d’une boîte de berlingots et d’une rose dont la femme ne portait plus que les épines et le parfum à son corsage. – 61 – VI AFFAIRES DE FAMILLE OU L’ENVERS D’UNE OMBRE Line ne se trouvait pas le lendemain au rendez-vous. Pour se calmer, le Sud-Américain alla faire un tour au Bois. Pourquoi s’était-il assis à gauche dans son auto, comme s’il avait réservé la droite pour quelqu’un ? Il se disposait à changer de place quand il vit qu’une señora était là contre lui et lui faisait un léger salut plein d’honneur et de tropicale distinction. De noir vêtue, elle tenait à la main un chapelet de « quinze mystères ». Sa peau fine et brune, d’origine espagnole, nullement ridée, disait un passé tout d’une pièce, sans coutures. Et pourtant elle marquait une cinquantaine d’années. L’âge lui venait de l’âme plus que du corps et se répandait paisiblement sur sa face comme l’eau d’un fleuve qui a déjà fait pas mal de chemin et n’est plus éloignée de son terme maritime. Ce voisinage gêna singulièrement Guanamiru qui d’abord ne sut que dire. – Pardon, Madame, je crains fort que vous ne vous soyez trompée de voiture. – Ne me reconnais-tu donc pas, petit frère ? dit-elle d’une voix un peu fanée. No me conoces, hermanito ? traduisit-elle en espagnol. – Pas du tout, Madame, fit Guanamiru, sèchement et en français ; il estimait que cette langue maintenait davantage – 62 – entre la Sud-Américaine et lui les distances que l’espagnol lui aurait permis de franchir rapidement. – Je suis celle que tu serais devenue si tu n’avais pas été un homme. Ta sœur impossible. Je t’ai suivi depuis le jour où notre médecin de famille a dit : « C’est un garçon ». Et pendant les quelques secondes qui précédèrent ce verdict, nos âmes se demandaient dans un coin lequel des deux devrait se résoudre à ne vivre qu’en fantôme. Il s’en est fallu de l’ombre d’une virgule que tu ne fusses moi… Et que fais-tu donc en France, cher ami, mon frère ? À chacun sa terre natale. Retourne à Las Delicias : notre nom de famille y est aussi répandu dans le langage courant que les mots laine, cuir, maïs, amour, petit pain, politique, tramway. Laisselà ces Françaises qui te mettent dans les veines un feu étranger et malsain. Sans sortir des rues centrales de Las Delicias, je connais trois cents jeunes filles très bien qui ne demanderaient qu’à t’adorer dans la fraîcheur des patios. Je me porte garante de leur pureté. Nous, fantômes, sommes toujours admirablement informés. Nous nous mêlons au silence et à la lumière aussi bien qu’aux paroles et aux ténèbres. Ne savonsnous pas devenir même la médaille de la Vierge sur une gorge naissante ? Elle reprit au bout d’un instant : – Pourquoi n’as-tu pas épousé Teresita Lopez y Faustina dont la mère avait loué à l’Opéra la loge à côté de la tienne ? Ou Soledad Valdès si méritante avec ses grands yeux d’orpheline ? – Laissez-moi tranquille, Madame et chère maquerelle. J’ai besoin de choisir moi-même une Parisienne pour ces bras sauvages où galope le sang de la pampa, d’une femme qui n’ait jamais vu la Croix du Sud et ne comprenne pas l’espagnol. Qu’elle ait l’accent et la malice circulaire de la Tour Eiffel ! Tant mieux si elle me couvre de cornes ! – 63 – – Il t’en cuira, petit frère. Et si grande sera ta souffrance, que tu regretteras de ne pas être comme moi un petit fantôme modelé par la lune. Le soir Guanamiru, couché, sentit, à côté du sien, le corps de Line du Petit Jour. Horreur ! Il s’était trompé. C’était Juana Fernandez y Guanamiru aux pieds glacés. – Tu n’as rien à craindre, lui dit-elle. Je suis ta sœur et pure comme l’air des cimes. – Que c’est donc désagréable ! Vas-tu me laisser tranquille, sœur invétérée ! Vas-tu t’en aller au diable avec tes sentiments familiaux ! Ne vois-tu pas qu’il n’y a pas place pour nous deux dans ce lit étroit ? – Mais je ne fais rien. Je ne dis rien. Je veillerai sur ton sommeil. Elle avait une toute petite pèlerine de laine rose sur la chemise de nuit haut-boutonnée. Ses bigoudis étaient d’azur étoilés d’argent comme si elle allait s’envoler. On pouvait lire sur son scapulaire : « Arrière, Satan, le cœur de Jésus et de Marie sont là ». – Va-t-en, va-t-en, va-t-en ! criait Guanamiru le browning au poing. – Tu ne peux plus rien contre moi, il y a beau temps que tu m’as assassinée. Elle se leva droite comme une ligne droite. – La porte n’est pas par là. – Et qu’ai-je besoin de portes, moi ? – 64 – Elle alla vers le mur, où hautaine, elle s’engouffra et disparut sans même déranger une miniature qui s’y trouvait accrochée. L’homme de la pampa ne pouvait se passer de la présence de Line qu’il trouvait allongée et s’éventant sous chacune de ses pensées. Cependant la jeune femme ne voulait pas entrer chez Guanamiru. Elle sonnait, attendait que la porte fût ouverte, puis refusait de franchir le seuil. « Je reviendrai demain, aujourd’hui j’ai peur, » disait-elle à l’estanciero appelé en toute hâte par Innombrable qui faisait maintenant fonctions de gaucho-de-chambre. À la pensée qu’il pouvait faire peur, les rides et les sourcils de Guanamiru, les lignes de son nez et de sa bouche se combinaient rapidement avec les signes de la volupté refoulée pour former un réseau d’épouvante. Muni d’un atroce sourire qui cheminait difficilement sur son visage, contournant force obstacles, il poursuivait Line dans l’escalier en lui promettant mille têtes de bétail et, pour plus tard, une rente annuelle de trois mille agneaux, si elle consentait à devenir sa maîtresse. Mais celle-ci avait pris assez d’avance pour mettre bientôt entre elle et l’Américain cinq mètres de trottoir et un bec de gaz derrière lequel sa voix apaisante disait : « Demain, mon ami. D’ailleurs, voici mon tramway. » Guanamiru rentrait chez lui soufflant comme un taureau éconduit et finissait par s’enfermer dans une chambre noire, « pour y développer à l’aise son chagrin, » disait-il. Un jour Line consentit enfin à pénétrer dans l’appartement de l’estanciero. Après mille supplications celui-ci obtint qu’elle s’assît sur son lit. Mais elle avait pris ses précautions et à peine – 65 – lui eût-il touché le bras que ce bras disparut. Alors il caressa le genou et aussitôt le genou ne fut plus que la mémoire de luimême. Cependant le bras était revenu à sa place mais non pour l’homme de la pampa qui ne put encore le saisir. Il voulut lui baiser les lèvres et n’en trouva plus sur du vide que le dessin au crayon rouge. Comme il la prenait à bras-le-corps, Line devint si pâle – et son âme si pâle dans la robe claire – qu’elle disparaissait insensiblement et ne fut plus bientôt que l’envers d’une ombre. Ne pouvant consentir à cette éclipse, il chercha la jeune femme dans la pièce et la trouva enfin sévèrement couchée sur la cheminée où elle s’était métamorphosée en un nu de bronze, la droite reposant sur une sphère terrestre qui servait de pendule. Le tout portait sur le socle la mention : « Line La Voyageuse », par Victor Le Blond, H. C. N’y tenant plus, l’homme du Sud voulut casser l’objet d’art et l’heure qui se moquaient de lui. Mais ses mains vacillèrent sur un gouffre sans fond comme on en voit dans les Andes à contre-jour. Un mélange de parfums finement composé envahit la pièce ; on y distinguait du jasmin de l’Espagne contemporaine, une odeur de Chine du XVe siècle (époque Ming) et divers petits parfums fripons et confidentiels qui s’en venaient à la dérive depuis les temps de Louis le Quinzième. Guanamiru s’annihila dans un fauteuil cerise-pourrie, puis brusquement se retourna. Le volcan était derrière lui. « Ne cherche plus cette femme », répétait-il à de courts intervalles. L’homme ferma les yeux, se laissa descendre dans le fond de son âme comme dans un puits de mine. Ses mains avec tous leurs doigts lui étaient d’une lourdeur et d’une inutilité insupportables. – 66 – Il y eut un long silence que le volcan orna de fleurs d’orangers, en guirlandes. – Ne cherche plus cette femme, et oublie-là. Ce n’était qu’un adorable simulacre. – Que dis-tu, vil escroc ? fit le Sud-Américain dont la tête tournait, et les yeux dans la tête, et l’horreur dans les yeux. – La vérité, soupira Futur. – Quelle vérité ? – … (silence sphérique du volcan). – Jamais je n’y consentirai… dit Guanamiru dans ses larmes. Tu appelles cela un simulacre, mais où sont les femmes alors, où toutes les femmes de Paris ? Je n’ai vu que celle-là, je suivais les mouvements de sa gorge, m’exerçant à respirer à l’unisson. – Des imaginations de ta cervelle ! La carte de l’Amérique du Sud où l’Océan Atlantique avait été remplacé par l’Océan Indien aurait dû éveiller ta suspicion. – C’était signé Schrader… – Raison de plus ! Tu aurais dû penser que c’était un faux… – Misère ! tu me dois la vie et en profites pour te moquer de moi. Que n’ai-je pas suivi la sirène jusqu’au fond de la mer ? – Mais cette sirène, mon ami, si je te disais… ? – Je te défends de plaisanter avec le plus cher de mes souvenirs, avec la pièce la plus rare de ma vitrine sentimentale. – Qui croit encore aux sirènes, aux assassins invraisemblables, aux sœurs impossibles, à tous ces enfants de fantômes que je t’offrais pour ne pas t’importuner par une même présence ? Tout cela venait de Futur, c’était l’œuvre de – 67 – ton ouvrage. Mais j’étais toujours là à attendre mon tour derrière le journal de Smith, au fond des yeux de la sirène et dans le réticule de Line, où tu n’as jamais eu la curiosité de regarder. – Tu n’as donc pas de cœur ? – Le cœur est un organe nuisible à la santé et qui fort heureusement s’atrophie de jour en jour, faute d’usage. On n’en trouvera bientôt plus trace dans les poitrines humaines. C’est à peine s’il a plus d’importance que le nombril. Comme lui, c’est un souvenir d’enfance. – Que t’ai-je donc fait ? Pourquoi me poursuivre ainsi ? Ne suis-je pas un brave homme, le brave homme qu’on rencontre au coin d’une rue et qu’on a envie de saluer tant on l’a trouvé brave homme ? Mais rien ne te suffira. Qui es-tu donc ? éclata-til. Qui t’a poussé, quel courant inconnu, à te jouer ainsi d’un rentier au tournant de son âge ? Tu me fais douter de tout. Je sens bouger mon cerveau dans le sens de la longueur. Ma langue va sortir de ma bouche comme celle des pendus. – Tous les pendus rient quand on les regarde sous un certain angle. Mais leur rire est en dedans. On ne l’entend que du côté des morts. – Où suis-je ? Ce que je vois par la fenêtre, est-ce bien la France en Europe, ou n’ai-je pas quitté mon pays ? Ce qui est là, près de la cheminée, est-ce vraiment mon pied droit comme on me l’a appris à l’école, ou le gauche, ou le diable, ou le bon Dieu ? – Laisse tes pieds tranquilles. Tu ne parles que de toi. Et que dirais-je, moi, si tu te plains ? Tu existes, toi ! Tu as un corps à ta disposition matin et soir, et même la nuit, quand tu n’en fais plus rien dans ton sommeil profond. Chaque matin, tu te réveilles avec tes deux mains à toi et tes reins à toi, et ton ventre égoïste au centre de toi-même. Et moi je ne dors jamais, – 68 – je ne me réveille jamais, je n’ai pas de centre, ni de cœur, comme tu le disais tout à l’heure, moi qui ne suis qu’une idée détachée de toi, et greffée sur l’inconnu. Ce que tu repousses me serait un délice. Oh ! mâcher un vieux croûton de pain ! Entendre la chanson de son cœur, allonger les bras, saisir, tordre, vivre ! Je te vois prendre des médicaments avec répugnance. Comme je les aimerais ! Ils me situeraient dans leur itinéraire à travers mon corps. – Mon pauvre vieux, dit Guanamiru. – Dans mon ennui, je ne puis même pas me tuer. Les balles et le poison ne m’atteignent pas. Je me suis inaccessible. – Comment te prouver mon amour, mon grand frère de l’autre côté des ténèbres ? J’ai beau tendre les bras, une nuit féroce nous sépare, peuplée de cent mille chiens qui ne laissent rien passer. La crainte d’avoir manqué d’égards à Futur taraudait l’homme du Sud. Trois semaines durant, il s’efforça de lui témoigner la plus minutieuse affection ; mais comment consoler le néant, un néant si susceptible ? Guanamiru faisait en ville de longues explorations dans le désert dont sa pensée l’entourait. Il avançait entre sa tristesse et sa mauvaise humeur qui marchaient à son pas. Parfois l’une d’elles s’attardait un peu en route, puis se hâtait de rejoindre. « Je ne sais plus que penser de mon volcan, songeait-il. J’ai hâte que son éruption ait lieu, cela le soulagera sans doute. Mais l’autorisation de la Préfecture de Police ne m’est pas plus parvenue que la réponse de l’Académie des Sciences. Ce sera peut-être pour ce soir, ou pour hier soir, ou pour demain. J’ai pourtant écrit à ces Messieurs par lettre recommandée, que j’avais rapporté un volcan de l’Amérique du Sud. Jusqu’ici on ne m’a répondu que par des sourires, des sourires de crocodile. – 69 – Ah ! sourire français, ennemi de l’homme libre de la Pampa ! Personne ne me prend au sérieux dans ce Paris, où je commence à regretter l’enfant de huit ans qui, un jour, à Las Delicias, lançait sur mon cheval pie de l’écorce de pastèque pour marquer qu’il m’avait reconnu. » Vieillissait-il, ce volcan, ou souffrait-il de quelque affection ? Quand Guanamiru rentrait le soir, Futur lui disait sur un ton de menace et de reproche : « À nous deux, maintenant ! » Sa curiosité devenait parfois si pressante et inattendue qu’elle réveillait son voisin au milieu de la nuit sous une tempête de questions saugrenues. « Qu’avait fait Guanamiru le 25 février de l’année précédente, et le 3 mars, et le 12 juillet ? Pourquoi était-il né un mardi ? Le volcan désirait le savoir immédiatement. Le courrier d’Amérique allait-il bientôt arriver ? Quelle était l’actuelle population de la Chine ? Faut-il un y à rythme ? Trajan ou Héliogabale ? Héliogabale ou Sardanapale ? As-tu bien fait de ne pas répondre à l’invitation, pourtant si aimable, de ce tailleur frais-installé qui te demandait d’aller voir ses nouvelles étoffes ? Te décideras-tu enfin à me dire toute ta gratitude ? » Quand Futur lui demandait : « Quel âge as-tu ? » Guanamiru, encore qu’il se portât bien, devait lui répondre humblement et très vite : « L’âge du cancer et de l’artériosclérose. » S’il avait l’audace de lui dire simplement : « J’ai cinquante ans », le mont se fâchait et se mettait à sentir la terre des morts fraîchement remuée. – Oh ! je sais que tu ne m’aimes plus, soupira un jour Futur, toi qui ne veux même pas me faire une petite place dans ton lit. – Allons, dors. – Est-ce que je sais dormir ? – 70 – – Fais l’immobilité dans ta pensée, le sommeil s’en suivra. – Qu’appelles-tu ma pensée ? Guanamiru ne répondit pas. Détestable lui sembla le jour où il avait conçu le projet de construire la montagne fumante. Dès le lendemain, sa résolution fut prise : il tenterait de noyer Futur dans la Seine. À la tombée du jour, effrayé par ce projet, Guanamiru proposa à son fils spirituel de le faire voyager, estimant qu’on pourrait ainsi remédier à la fixité et à la violence de ses odeurs. Mais le petit mont ne répondait point qui semblait pourtant écouter, puisqu’il avait cessé de se répandre dans l’air. – Nous pourrions partir pour Naples, dit timidement Guanamiru, où il te plairait peut-être de te mettre en rapport avec un de tes confrères illustre et sans doute de bon conseil. Tu te trouverais sans doute auprès de lui mieux qu’à Paris, où tu manques d’une ambiance favorable. Le volcan demanda brutalement à son interlocuteur s’il se foutait de lui. – Que veux-tu que je fasse ? Parle ! insista Guanamiru. – Je ne demande rien à qui tout à l’heure voulait me jeter à la Seine. – Moi, je n’ai jamais dit ça. – Tu l’as pensé. – Si mes pensées ne sont même plus à moi ! soupira Guanamiru. À l’aube, après une gerbe d’odeurs indéfinissables, qui évoquèrent dans l’esprit du Sud-Américain d’innombrables verticales et horizontales, auxquelles il put mettre enfin le feu – 71 – dans une grande flambée de son esprit, le propriétaire du volcan réussit péniblement à s’endormir. Mais son nez veilla toute la nuit. – 72 – VII LIBERTÉ Le lendemain, le volcan avait disparu, il n’avait laissé de lui dans la valise vide que diverses odeurs signifiant aussi bien : « Cherche à me retrouver » que « ne cherche pas à me retrouver ». Guanamiru ne pouvait en discerner le sens exact ; mais il n’eut pas de peine à se persuader que la seconde version était la bonne. « Vais-je enfin pouvoir vivre à ma guise, songeait-il, voir, dans le temps qui passe, un ami, un collègue souriant, ou plutôt un subalterne rasé de frais et non un détective polymorphe sachant tous mes gestes, même intellectuels, surveillant la formation de mes idées, dans le plus personnel de ma cervelle ? » Dans six cafés différents, il but six grogs, puis prit six verres de liqueur dans les mêmes cafés en commençant par celui où il avait bu son dernier grog et en finissant où il avait pris le quatrième, ou bien le second, ou le troisième, il n’aurait su le dire. Pour passer une nuit tranquille, il coucha chez une danseuse, Miss Piccadilly, célèbre depuis 1885, trente-quatre années avant la construction de son volcan, précaution qui ne lui semblait pas excessive et conférait à l’Américain des joies d’ordre divers. À eux deux ne formaient-ils pas, quand il la tenait dans ses bras, un seul être de cent dix ans, total qui permettait à Guanamiru d’entendre le canon de Waterloo, de fréquenter chez Victor Hugo et les libertadores Bolivar et San Martin, d’enlever en 1840 une jeune fille en robe Louis-Philippe – 73 – avec un très joli corps de l’époque, d’acheter à vil prix, vers 1820, la moitié de l’Amérique du Sud, terres d’avenir. Miss Piccadilly devint sa quotidienne compagne. Il ne la quittait plus désormais, même sur les planches où, comme machiniste, il s’engageait pour la durée de la soirée. Huit jours, quinze jours, trois semaines passèrent. Futur ne donnait plus signe de vie, si l’on peut ainsi parler d’un fantôme. Guanamiru, accompagné de la danseuse retourna enfin chez lui. Rien de suspect et le plus grand ordre dans les armoires ; dans l’air, aucun message. L’homme ne voulait plus se trouver seul dans son appartement. Il lui fallait du moins les jambes et le corps de la danseuse, s’il ne pouvait posséder son esprit qui s’en était allé au diable depuis l’enfance de cette femme, si bien que derrière son front étroit il n’y avait plus maintenant qu’un petit vide avec une petite croix, exposée au vent. Un jour enfin il essaya de rester seul cinq minutes, puis dix. Il alla ainsi jusqu’à la demi-journée, progressivement. Puis il supplia la danseuse de le tromper chez elle toute la nuit, alors qu’il veillerait dans son appartement de garçon. La nuit s’écoula paisible comme rivière de plaine. La danseuse ne reparut pas, le volcan non plus. Une grosse bonté mal équarrie s’empara de Guanamiru ; tout lui était prétexte à la témoigner. S’il lui arrivait de marcher au Bois sur l’ombre d’un passant, il s’excusait profondément et offrait aux dames un repentir bien tourné avec flot de rubans, aux hommes un portefeuille-souvenir-calendrier-surprise, aux enfants un cerceau en bois des îles dont il emportait une intelligente provision dans son auto. – 74 – Dans le désir de rendre service, il dit un jour à un promeneur : « Pardon, Monsieur, faites attention. Vous avez le nez un peu de travers. » Une nuit à son balcon de l’Avenue Victor-Hugo, il se surprit à donner aux astres des conseils de prudence. Mais on l’entendait mal là-haut à cause des tramways, et cela le désespérait. Tous les matins, sur les berges de la Seine, on le voyait arriver suivi d’un domestique portant un panier plein de poissons d’eau douce qui reposaient sans plaisir sur un lit de cresson. Dans un bocal, tenu par Innombrable, nageaient de petites truites. Le tout était remis aux pêcheurs sous les yeux mouillés de Guanamiru. Il arriva qu’un des hommes prit la parole : « Il ne faut pas vous donner tant de mal, Monsieur, pour nous apporter du poisson d’eau douce. Le poisson de mer ferait aussi bien l’affaire. » Le lendemain, Guanamiru s’en vint avec des soles, colins, barbues, du saumon en tranches, des restes de poulet et un jeu de loto. Le pêcheur qui avait une fois déjà dit sa pensée s’écria : « Tu as oublié le vin, mon vieux. Heureusement que je pense à tout. » Il était ivre. Guanamiru s’en voulait d’avoir montré tant de délicatesse à des ingrats. Il convint que la bonté n’était que le fruit gâté de sa faiblesse. « Seule la méchanceté est apéritive et reconstituante. Il faut savoir faire de la peine à ses semblables. » – 75 – Comme exercice préparatoire, l’homme de la pampa se penchant à la portière de sa 40 HP, tira la langue à un pauvre aveugle accoté à un réverbère. Enhardi par cette réussite, il occupa une partie du lendemain (c’était un mercredi) à briser à coups de talon, la glace du lac du Bois de Boulogne pour qu’on ne pût pas patiner le dimanche suivant. Mais il se lassa aussi vite de la méchanceté que de ses intentions charitables et se promenait maintenant à pied dans une lourde indifférence, vêtu d’un imperméable hermétique, et légèrement voûté sous la pluie fine de ses incertitudes. Pouvaitil encore monter dans son auto où il avait tiré un jour la langue à un aveugle, dans le métro où il avait aimé une femme qui n’en était pas une, en autobus où l’on n’était pas seul, dans les taxis dont aucun chauffeur ne lui avait été présenté ? Durant ses promenades à la campagne il prenait la nature pour une Exposition Végétale parfaitement inutile qu’on aurait dû fermer depuis longtemps. Les arbres en étaient les gardiens honteux, trop grands pour passer inaperçus, trop bêtes pour s’exprimer de façon intelligible, trop fiers pour demander des pourboires. Dans la rue ou à la Légation de son pays, il ne reconnaissait plus les gens d’emblée comme autrefois. Des points de repère lui étaient indispensables. « Ce monsieur a le menton long et fourni du bas, se disaitil devant son interlocuteur au lieu de l’écouter. Ne l’oublions pas ». Voyait-il un menton de ce modèle, il le saluait toujours sans s’inquiéter du reste. S’il lui arrivait de reconnaître un ami tout entier, ce n’étaient que gracieusetés et compliments où sa mémoire défaillante puisait des forces illusoires. – 76 – Quant à ses compatriotes les Pèrez Sanchez, cinq sœurs qui se ressemblaient jusque dans le parallélisme de leurs rêves, il lui en fallait au moins trois de face pour en reconnaître une seule. Pour jouer un mauvais tour à la solitude, il se plantait parfois devant la glace de son armoire, et s’y enlaidissait avec sadisme. Ayant fait remonter son épaisse moustache jusqu’à ses yeux, qui brillaient derrière et au loin, petites lanternes au fond d’une forêt, il frottait ses sourcils en tous sens jusqu’à y provoquer la panique et ramenait ses cheveux en arrière pour découvrir sa calvitie éperdue. Ainsi défiguré, il pénétrait dans son salon et pensait soudain se reconnaître dans une effroyable femme de ménage aux traits poilus et divergents, qui n’avait jamais eu une minute pour mettre un peu d’ordre sur sa figure à la débandade. – 77 – VIII AGRANDISSEMENTS. NOUVEAUX AGRANDISSEMENTS. Il décida d’acheter un chien qu’il appela Parana. « Du moins chez lui trouverai-je de l’ordre dans les idées. » C’était un King Charles capable de contenir dans son regard béant la tendresse inemployée du monde. Dans l’œil gauche de la bête Guanamiru mit en dépôt sa mélancolie et dans le droit son goût des aventures. Si bien que le chien en devint aveugle et force fut à l’Américain de le précéder dans le chemin de la vie. C’est lui qui deux fois par jour le menait au square Lamartine où Parana avait son pied de banc et ses petites habitudes. Il le savonnait lui-même, lavait ses yeux à l’eau boriquée et le brossait à n’en plus finir. Dans son exil, son amour pour le chien lui faisait peu à peu une petite patrie. L’ombre chaque jour plus sensible de Guanamiru devenait tour à tour la silhouette d’une petite palmeraie ou d’un éléphant jouant avec les volutes de sa trompe, d’une gazelle aux cornes exquises, d’un boa suspendant une moitié de lui-même à une branche de goyavier. Pour se faire oublier du malheur, il dormait beaucoup, dépensait peu, réduisait même le train de ses idées, évitait d’éternuer avec bruit. Dans la rue, on ne le voyait passer que sur des semelles de caoutchouc et avec du coton dans les oreilles. C’est à peine si on entendait son coup de sonnette. Et déjà il – 78 – pensait rentrer à Las Delicias dans une cabine ordinaire, loin des hautes trompettes du luxe. Cette vie sans inquiétude lui donna de l’embonpoint ; il se promit de ne pas tomber à l’avenir dans des excès de table. « Je me contenterai de légumes vert-pâle et de bouillons de poules faiblement nourries sous mes yeux. » Cette résolution prise, l’homme se dirigea vers son armoire à glace comme il faisait quand il avait une communication à s’adresser. Stupéfaction de voir qu’il avait aussi grandi. – Grandi ? Mais on ne grandit plus à cinquante ans. C’était là une fable que son corps se racontait à soi-même ou un souvenir de la bible, ou une légende lasse qui essayait de prendre corps après des siècles d’errance aérienne. Peut-être suffirait-il de penser à autre chose, de faire intervenir le phonographe pour que cette grotesque croissance disparût d’un seul coup. Il écouta d’abord une marche militaire de son pays, dont il avait à plusieurs reprises éprouvé le pouvoir d’aération mentale. Comme il se disposait à l’entendre une seconde fois, ses mains qui débordaient le disque en tous sens l’effrayèrent tellement que pour les oublier il songea à ses pieds. Était-il encore sur ses pieds habituels ? Il n’aurait su le dire, mais il voyait bien que les recouvrait une énorme paire de chaussures en tous points semblable à celle qu’il avait vue un jour à la devanture d’un bottier de son pays et qui portait cette mention : « La paire est offerte gratuitement à qui chaussera cette pointure. » Où donc allait ainsi Juan Fernandez y Guanamiru ? Ne voyait-il pas qu’il n’y avait rien de raisonnable à chercher dans la direction du plafond ? Et quand il l’aurait atteint, qu’est-ce que cela prouverait ? – 79 – « Patience et humilité, se disait le géant malgré lui. Qui sait si cette croissance subite ne me vient pas de mon immodestie ? Ne me suis-je pas toujours cru supérieur à tous les autres, plus grand que les autres ? » Il commençait à éprouver de la gêne entre les quatre murs de la chambre à coucher peints en camaïeux et qui, lentement, dans un silence Louis XVI, avaient pris l’offensive. « Je me trouverai mieux au grand salon avec les fenêtres ouvertes. » Il eut quelque mal à passer dans cette pièce, mais s’y sentit plus à l’aise, encore qu’il ne sût où s’asseoir : les meubles dans leur étroitesse et leur fragilité semblaient se méfier de lui comme d’un navire où l’on vient de hisser très haut le drapeau de la fièvre jaune. Tout d’un coup, l’homme de la prairie, voyant tous les fauteuils lui tourner simultanément le dos, lâcha de grands rires noirs dont le retentissement lui fit d’un coup avaler sa gaîté. « Ne suis-je pas resté toute la journée sans prendre l’air ? Pourquoi demeurer là, comme un mort, à compter mes os. » Mais chez lui, Guanamiru avait du moins des miroirs pour surveiller son grossissement ; dehors il ne saurait au juste où il en était. « Tant pis, ce n’est pas le moment, je pense, de faire de l’anatomie comparée. » Pour sortir, il ouvrit les deux battants de la porte donnant sur l’escalier, dont il descendit les marches trois à trois, comme en se jouant, si c’était là jouer. Parana le suivait : de temps à autre, il se frottait au pantalon de son maître pour s’assurer de son identité et flairer ses intentions. – 80 – L’Avenue n’était éclairée que par un soleil d’hiver évasif qui, derrière sa fourrure d’ouate, évitait de se mêler des affaires humaines. La largeur du trottoir rassura Guanamiru : une belle marge pour l’avenir, et des réserves d’espace qu’il se promit de ne dépenser qu’avec parcimonie. Sa taille n’était pas encore, d’ailleurs, celle d’un bec de gaz. « Encore ! d’ailleurs ! Pourquoi ai-je pensé ces mots-là ? N’est-ce pas ridicule de spéculer ainsi sur un malheur dont je serai le premier et le dernier à supporter les conséquences ? » Ah ! s’il avait pu poignarder l’avenir, voir « ce qu’il avait dans le ventre. » « Je me dirige maintenant vers l’Étoile en regardant droit devant moi, à la hauteur d’un entresol. » Arrivé devant l’Arc de Triomphe, il préféra ne pas s’aventurer dessous. Les Champs-Élysées l’attirèrent. En passant devant une glace, il remarqua qu’on y voyait à peu près un quart de sa personne (peut-être un cinquième), mais ce fragment emplissait si violemment toute la glace que, saisie, elle éclatait en morceaux. Il en était ainsi maintenant, sur son passage, des devantures, vitres des autos et même des verres de montres-bracelets. Il poursuivit sa promenade. « Je reconnais qu’il me serait facile, pour faire diversion, de m’emparer de quelques plantes sur ce balcon. Mais j’écarte cette idée comme inutilement délictueuse ; que pourraient pour moi ces faibles végétaux ? Comme j’ai bien fait de mettre un pardessus neuf, puisque je dois me donner en spectacle, et de prendre mon chapeau noir, ce qui est plus sérieux. » – 81 – À l’angle de la rue de Berri, quand sa tête se fut trouvée à la hauteur d’un cinquième et que déjà il appréhendait de distinguer, sans avoir à se mettre sur la pointe des pieds, ce qui se passait dans les chambres des bonnes, Guanamiru commença de souffrir d’une espèce de célestophobie aggravée d’un petit picotement stellaire qui exaspérait son cuir chevelu à travers son chapeau. Ses pieds se trouvaient maintenant si loin de son chef que les communications cérébrales ne leur parvenaient qu’avec de grands retards et que l’intéressé marchait toujours le front très en avant, fendant les événements quels qu’ils fussent. « Ce qui pourtant me rassure, c’est que je n’ai mal nulle part, mon appétit est exactement réglé par ma corpulence, et Parana a conservé son ancienne taille. Les différentes parties de mon individu semblent se développer suivant un plan d’ensemble qui ne me paraît pas essentiellement déraisonnable. Je suis très satisfait de mes nouveaux mollets, de mes cuisses présentes. Les échanges se font bien. Je verrais une femme avec plaisir. N’est-ce pas aussi un sujet de contentement que mes vêtements grandissent en même temps que moi, et s’acclimatent instantanément à mes nouvelles formes ? » Même son mouchoir de soie avait subi l’accroissement général ; c’était maintenant une très belle pièce d’étoffe valant plusieurs milliers de francs. Il avait fait là une très bonne affaire, la meilleure de sa vie. Ses initiales s’y trouvaient à leur place habituelle, que voulait-il de plus ? C’était donc toujours à Juan Fernandez y Guanamiru, fils de Sébastian et de Lucia, qu’il avait à faire. Il se rappelait son enfance, sa jeunesse, ses amours. Il eût souhaité communiquer avec la Légation de son pays pour y demander secours ou conseil. Entre compatriotes on se comprend mieux. Que douce lui eût été la voix un peu enrouée – 82 – du Ministre ou même celle du premier secrétaire, voire du troisième ! Mais il ne fut pas difficile à Guanamiru de reconnaître que tout en possédant la taille et presque le volume d’un immeuble moderne de cinq étages, il n’avait pas sur lui le téléphone. Voulant attirer l’attention d’un médecin de service quelque part, médecin municipal ou tout au moins médecin de quartier, il tirait en l’air de temps à autre un coup de revolver. Au surplus il était bien inutile d’appeler au secours. On le voyait bien assez sur toute la longueur de l’avenue. Jamais souverain n’avait attiré tant de monde aux balcons, ni dans les arbres, ni aux gouttières où des badauds montaient pour mieux suivre l’évolution guanamirienne. Au rond-point des Champs-Élysées, il s’aperçut soudain qu’il était à peine plus grand qu’un platane. Un arbre de la forêt parisienne ayant à peu près deux étages de hauteur, il avait donc gagné deux étages et demi, peutêtre trois et dans le bon sens. Heureux, il ne put s’empêcher de clamer un bulletin de santé d’une voix forte, qu’on entendit dans tout Paris et dont l’ampleur le tonifia : « État général excellent, cœur et jambes bonnes, pouls inconnu. Je semble me diriger vers mon ancienne taille. » Alors qu’il caressait d’un revers de main la cime d’un marronnier, il redevint comme dans une fluide descente d’ascenseur, le Fernandez y Guanamiru qu’il avait toujours connu jusque-là avec son mètre 76 centimètres à la toise. Dans la foule, qui le cherchait encore à la hauteur d’un second, il s’égara. Parana feignit, par délicatesse, de ne s’être aperçu de rien. Mais il lui était poussé au milieu du front un – 83 – troisième œil qui lui permettait, sans lever la tête, de voir exactement où en était son maître. Voilà que Guanamiru ne portait plus maintenant le même chapeau. (Il se rappelait fort bien être sorti avec un sombrero qu’il avait fait brosser devant lui par son valet de chambre.) C’était maintenant un chapeau de paille hors d’usage que l’estanciero avait donné cinq ans auparavant à un vieux gaucho de sa ferme de Curupatita ; il le reconnaissait bien aux raies horizontales de son ruban rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune, etc… jusqu’à dix et au nom du chapelier de Las Delicias. « Qu’est devenu mon chapeau mou, dont je ne vois pas la moindre trace ? » Cette substitution lui parut du plus mauvais augure ; elle couvait un avenir d’autant plus déraisonnable qu’on était en plein hiver. Dans une croissance désordonnée, son corps devenait maintenant la proie d’une véritable panique osseuse et cellulaire, avec brusques pudeurs et démentis, dont ses vêtements suivaient très mal le rythme, et parfois même à contretemps ; si bien que certaines parties de son individu, et non des moindres, étaient entièrement nues et d’autres couvertes par une cascade bruissante de vêtements qui traînaient à terre et sur lesquelles il ne pouvait s’empêcher de marcher. À chaque instant empirait son état qu’on était bien forcé de qualifier d’inactuel, puisque, dans le continuel devenir de Guanamiru, son actualité s’était séparée de lui et le suivait à quelques pas, invisible, mais haletante. Son organisme émettait aux jointures une plainte de crécelle et projetait sur les immeubles de l’avenue une ombre au graphique fiévreux dont Guanamiru ne pouvait détacher le regard. – 84 – « Que ferait à ma place un Parisien ? Ces gens-là ont plus de finesse : nous ne savons pas encore voyager et tout nous déroute dans notre simplicité. Vite, faisons affluer dans mon cœur les réserves de courage éparpillées un peu partout dans cet immense corps. » Mais un agaçant arrivage de papiers entre sa manchette et sa main droite montra à Guanamiru que ses malheurs n’étaient point finis. Involontaire mais acharné prestidigitateur, il s’était mis à engendrer des millions de prospectus qui tapissèrent toute l’Avenue et se jetèrent même dans les rues transversales. Cela s’intitulait : Un Monsieur de la Pampa. Guanamiru y racontait toute son histoire et demandait aux passants de ne pas lui en vouloir s’il se donnait ainsi en spectacle. « Je n’ai rien d’un exhibitionniste et ne demande qu’à vivre de mes rentes qui m’arrivent tous les mois d’Amérique, Messieurs les Passants. Il n’a jamais été dans mes intentions de gêner le trafic. Je ne suis pas un aventurier mais un ami de la France, avec tous ses papiers en règle, Cher Monsieur le Préfet de Police. Bien que n’ayant rien à me reprocher, je suis prêt à recueillir dans mes diverses estancias cent petits Français dans le besoin et en faire des gauchos honorables, Monsieur le Président de la République. Ils ne manqueront de rien chez moi, j’ai du bon lait, et une pharmacie de campagne, Messieurs les Docteurs. P.-S. – Ne faites pas attention à ce chapeau de paille. Je n’y suis pour rien. Il m’est imposé par la Fatalité. » La source des prospectus enfin tarie fut remplacée par une grande affiche comme en promènent les hommes-sandwich, et qui venait de pousser avec son cadre sur le dos de l’étranger. Elle reproduisait intégralement les commentaires des – 85 – prospectus. Guanamiru la portait dignement, la tête haute, dans une attitude aussi militaire que possible. Un pinceau lumineux issu de son œil gauche se mit à projeter sur les nuages la pensée de l’Américain. Il disait : – Qu’avez-vous tous à me regarder ainsi ? Je n’ai pas toujours été géant. ciel : D’autres réflexions s’imprimèrent successivement dans le – Ayez pitié d’un frère latin d’Amérique descendant l’Avenue des Champs-Élysées. – Je n’ai rien à déclarer. – Qui m’aidera à porter mon bagage de chair humaine ? – Pourquoi aurais-je peur de la mort ? Il n’y a qu’à se laisser aller, à se laisser aller. Elle se charge de tout. – Un million de piastres-or à qui me rapatriera. Et c’était Guanamiru. » toujours signé : « Juan Fernandez y « Quel besoin de signer ! Pourquoi projeter ainsi en plein ciel un certificat de mon malheur ! Je vais être la risée du monde entier. Ce soir mon indisposition sera connue jusque chez les Guaranis. Du calme ! Je m’en supplie ! » Et en plein ciel il lut : « Du calme ! je m’en supplie ! » Puis : « Heureux ceux qui ont un lit de mort. L’âme aime bien avoir ses aises au moment de s’envoler. Mourir en marchant est très désagréable. On meurt mal et de travers. » – 86 – Parfois il pensait être écrasé par le poids de sa tête ou n’en plus garder qu’un souvenir translucide, tel un décapité ambulant échappé à des bourreaux ivres. On voyait tour à tour à découvert, comme sur les planches anatomiques ou des annonces de droguistes, le cerveau, les poumons ou le cœur, l’estomac, le foie ou les reins de Guanamiru. Blanc électrique, dans une splendide unité, son squelette escorté de fumeroles fit une totale apparition ; il s’avançait dans sa noblesse hautaine avec l’assurance de l’Éternité et l’appui de celle-ci. Sous la marée des chairs enfin revenues, Guanamiru reprit courage et respira fortement, un bien-être suspect s’empara de lui : la terre et les étoiles lui appartenaient, il les dépensait sans compter. Ses idées se mirent à grandir à proportion de son cerveau. Ses vertus exagérées devenaient des vices ; ceux-ci poussés à l’extrême dépassaient parfois leurs frontières pour aller faire des ravages et des enlèvements dans le domaine des vertus. Des idées particulières se faisaient générales. Certains concepts qui dormaient depuis des années sans espoir de réveil, retrouvaient soudain une vie falote et violente ; d’autres partaient pour des courses rapides et s’arrêtaient essoufflés, si l’on peut dire, au bout d’un trajet mental qui, sur le plan d’une piste de course à pied aurait à peu près équivalu à un cent dix mètres haies ; il y avait des obstacles. Le sentiment d’une chasteté fort mal informée maintenant donna à Guanamiru la honte de montrer son visage nu : il le recouvrit tout à fait avec un pan de sa chemise rapidement soulevée. Il ne se rappelait pas seulement son enfance, mais celle de son père et même de ses arrière-grands-parents qu’il n’avait jamais connus jusqu’alors. Et il ressentit les affres d’une – 87 – mémoire où il s’enlisait indéfiniment sans parvenir à en toucher le fond. Le secouant de la tête aux pieds, son bon sens lui arrivait par courtes rafales. Il alternait avec une folie devenue brusquement plusieurs fois millénaire et qui se manifestait par toutes les exclamations de la douleur humaine. Les Pheu ! les Opopoi ! des Grecs, les Heu ! des Latins, les ay de mi ! les alas ! les hélas ! les ha ! les ho ! les lamentations des Chinois, des Nègres et des Guaranis affluaient sur ses lèvres ardentes du fond des âges et des langues humaines. Il entendit en lui, sauvages, mille et mille cris d’oiseaux ; des vols inconnus lui traversaient le corps, il était comme une volière en feu qui les empêchait de sortir. Soudain, s’échappa de son gilet un teru-tero blanc et noir qui sentait le roussi et alla se poser sur un platane de l’avenue des Champs-Élysées. D’autres oiseaux brûlants s’élancèrent : condors, faucons, toucans, papegais, ramphocèles. Ils lui jaillissaient des épaules, des mains, de la tête, de la bouche, des yeux et même de ses chaussures. Puis ce fut le tour d’un troupeau de vaches effarées et de taureaux, bourses ballantes, qui bondissant du corps de Guanamiru, galopèrent vers la rue Royale. Ses bâtards montés sur des chevaux de la pampa se mêlaient aux gardes municipaux en fureur pour pousser l’exotique bétail du côté de la rue de Rivoli. Des femmes se trouvaient mal au milieu de la chaussée ; deux fillettes à plat ventre sur le trottoir vomissaient dans un égout. Impuissant à rétablir l’ordre, un agent de police se suicida d’une balle au cœur. Sur le point de traverser la place de la Concorde, Guanamiru s’assura qu’aucune auto ne le menaçait, évita soigneusement une voiture à bras traînée par un vieillard, et ne sachant plus comment on s’arrête, lança sur l’obélisque un lasso dont il se vit muni. La pierre d’Égypte se transforma aussitôt en un ombu du mois d’octobre alors qu’il commence à fleurir. Un azur très vif se mêlait aux branches et de grosses racines – 88 – apparaissaient. Mais à peine eut-il cessé d’avancer, que, gonflé à bloc jusqu’aux nuages, Guanamiru mourut par éclatement, de mégalomanie éruptive, parmi des nuages de cendre, de soufre volcanique et une horrible lave, au moment où, sortant d’une paillote voisine, Innombrable s’en venait sans surprise à sa rencontre, un fin sourire aux lèvres et le maté à la main, fidèle. Du crâne de l’étranger, avaient jailli de longues fusées ; vertes, les idées générales, rouges, les désirs, jaunes, les regrets, orangées, les habitudes (bonnes et mauvaises). Toutes ces pièces d’artifice s’harmonisaient fort bien dans le ciel de Paris. Des baguettes furent trouvées très loin du lieu de l’explosion. On découvrit, sur les bords du Zambèze, la trace d’une habitude qu’avait Guanamiru de changer souvent de trottoir, chez un vieil indigène d’un village où il n’y avait pourtant pas de trottoirs, ni de probabilité qu’il y en eût jamais. Chez des milliers de gens, on retrouva son amour des cigares de luxe, des femmes jeunes et jolies, d’une nappe propre, d’un roastbeef saignant et du rocking-chair après les repas. Le capitaine d’un trois-mâts norvégien naviguant dans le Pacifique, non loin de Bornéo, vit à faible hauteur, juste audessus de son voilier, deux mains se serrer avec émotion. C’étaient celles de Guanamiru qui se retrouvaient après un bon voyage en sens opposé, tout autour de la terre. Ces mains ne devaient pas survivre à leurs effusions ; elles tombèrent aussitôt merveilleusement unies, au fond de l’Océan qui leur fut fraternel. – 89 – À propos de cette édition électronique Texte libre de droits. Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe : Ebooks libres et gratuits http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits Adresse du site web du groupe : http://www.ebooksgratuits.com/ — Septembre 2014 — – Élaboration de ce livre électronique : Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : YvetteT, PatriceC, HélèneP, Coolmicro. – Dispositions : Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu… – Qualité : Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens. Votre aide est la bienvenue ! VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.