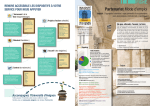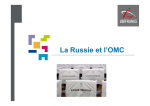Download CRINI - Aeres
Transcript
Section des Unités de recherche Rapport de l’AERES sur l’unité : EA 1162 : CRINI Centre de Recherche sur les Identités Nationales et l’Interculturalité sous tutelle des établissements et organismes : Université de Nantes Janvier 2011 Section des Unités de recherche Rapport de l’AERES sur l’unité : EA 1162 : CRINI Centre de Recherche sur les Identités Nationales et l’Interculturalité sous tutelle des établissements et organismes : Université de Nantes Janvier 2011 Unité Nom de l'unité : CRINI Label demandé : EA N° si renouvellement : EA 1162 Nom du directeur : M. Pierre CARBONI. Membres du comité d'experts Président : M. Alexis TADIÉ, Université Paris-Sorbonne Paris 4 Experts : Mme Norah DEI CAS-GIRALDI, Université Charles de Gaulle-Lille 3 Mme Cliona DE BHALDRAITHE MARSH, University College Dublin Mme Aliyah MORGENSTERN, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 Expert(s) proposés par des comités d’évaluation des personnels (CNU, CoNRS, CSS INSERM, représentant INRA, INRIA, IRD…..) : Mme Catherine RESCHE, Université Panthéon Assas-Paris 2, représentant du CNU Représentants présents lors de la visite Délégué scientifique représentant de l'AERES : M. Carle BONAFOUS-MURAT Représentant(s) des établissements et organismes tutelles du CRILA : M. Jacques GIRARDEAU, Vice-président du Conseil Scientifique de l’université de Nantes 3 Rapport 1 Introduction Date et déroulement de la visite : La visite a eu lieu le 20 janvier 2011, dans les locaux du département de langues de l’université de Nantes, et la réunion plénière s’est tenue dans la salle du conseil. Après une réunion à huis clos débutée à 9h45, qui a permis aux membres du comité de consulter les publications de l’unité, en particulier la collection du CRINI, éditée localement, la rencontre avec les membres du CRINI, dont la majorité était présents, s’est déroulée de 10h15 à 11h 45 dans une atmosphère cordiale et franche. Dans un premier temps, pendant 30 minutes, le directeur a présenté le bilan d’une unité organisée autour de trois grands pôles disciplinaires (civilisation, littérature, didactique des langues) et a esquissé en cinq points les perspectives offertes à l’équipe, tout en cédant régulièrement la parole aux différents responsables des aires culturelles. Une longue discussion a suivi cette présentation, qui a permis de faire apparaître des points importants du dossier. La rencontre avec le Vice-président du Conseil Scientifique, qui a eu lieu dans la continuité, à partir de 11h50, a permis de comprendre le soutien qu’apporte l’université à ses équipes et les attentes suscitées par l’évaluation du CRINI par l’AERES afin de décider de la marche à suivre. Tout en affirmant un soutien sans faille aux SHS, qui se traduira notamment par la construction, dans le cadre du plan Campus, d’un bâtiment leur étant spécifiquement dédié, le Vice-président a mis l’accent sur la politique d’internationalisation des publications menée par le Conseil scientifique, ce qui implique de ne pas subventionner les « publications de laboratoire ». La visite s’est achevée, de 12h25 à 12h55, par une rencontre avec une dizaine de doctorants, qui avaient tous effectué leur master à Nantes. Le comité s’est ensuite réuni de nouveau à huis clos pour préparer le rapport. Historique et localisation géographique de l’unité et description synthétique de son domaine et de ses activités : Installée dans l’UFR de langues de l’université de Nantes, l’unité a été créée en 1992. Elle présente trois axes de recherche (civilisation de l’Europe et des Amériques ; littératures étrangères ; didactique des langues et cultures étrangères) centrés sur quatre aires culturelles principales (anglophone, germanophone, russophone, hispanophone et italophone). Les locaux de l’unité sont situés dans l’UFR de langues, et sont pour l’heure constitués d’une salle de travail. Equipe de Direction : Le directeur du CRINI est assisté par une directrice-adjointe, et par un bureau composé des responsables des axes (6 personnes), d’un responsable du budget, d’une responsable des publications, d’un représentant de l’unité auprès de l’ED, et de deux personnels administratifs (dont une doctorante) dont la quotité de travail cumulée représente 0,75 ETPT. 4 Effectifs de l’unité : (sur la base du dossier déposé à l’AERES) : N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du dossier de l’unité) N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du dossier de l’unité) N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs y compris chercheurs post-doctorants (cf. Formulaire 2.2, 2.4 et 2.7 du dossier de l’unité) N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de l’unité) N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier de l’unité) N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées Dans le bilan Dans le projet 42 39 _ _ 1 1 1 (25%) 1 (25%) 1 (50%) 43 13 12 2 Appréciation sur l’unité Avis global sur l’unité: Le CRINI est une grosse équipe, pluridisciplinaire, qui rassemble des spécialistes de langues de diverses aires culturelles (anglophone, hispanophone, russophone, germanophone en particulier), et qui compte des littéraires, des civilisationnistes et des linguistes spécialistes de didactique (les autres linguistes ayant rejoint une équipe de Sciences du langage). Elle affiche une petite quarantaine de chercheurs à temps plein, dont les experts comprennent qu’ils représentent les publiants selon les calculs de l’équipe de direction (pour le comité ce chiffre serait plutôt de 30), les non-publiants ayant été considérés comme membres associés. Les axes de travail sont au nombre de trois, et correspondent aux disciplines, ce qui leur confère une cohérence en interne, mais rend plus difficile, inévitablement, le travail transversal. On a pu noter, en particulier dans l’axe 1, une bonne dynamique de recherche, avec des liens forts et suivis avec la collectivité, ce qui marque un souci d’interaction avec la communauté : l’environnement local et régional semble en retour porteur. Le bilan est tout à fait convenable avec un nombre important de soutenances de thèses et de HDR, de publications, tant individuelles (même si on aimerait parfois une plus grande diversité, en particulier internationale, dans les débouchés) que collectives, avec une collection d’ouvrages publiée localement, et qui trouve un débouché heureux sur revues.org. Les difficultés liées à la transversalité ont amené l’équipe à proposer une nouvelle organisation de la gouvernance et à mettre l’accent sur le travail en commun : reste cependant que ce travail ne peut pas se borner à des journées d’études auxquelles tous seraient conviés. En l’état, le projet scientifique se borne à décliner quelques thèmes, livrés sans aucune analyse ni état de la question (bibliographique ou autre), ce qui rend difficile d’estimer la pertinence du travail proposé (même si l’on peut faire confiance à des chercheurs de qualité pour le mener à bien). La recherche de financement auprès des grands opérateurs nationaux devrait être plus poussée, ainsi que la structuration des relations internationales (hors co-tutelles), en particulier dans le monde anglophone. 5 Points forts et opportunités : - équipe riche en chercheurs en langues avec des disciplines variées et complémentaires - bonne cohésion des axes de recherche - politique de diffusion active - chercheurs publiants relativement nombreux et publications de qualité - environnement local et régional porteur ; très bonnes relations avec la collectivité - conscience de la nécessité de se saisir de la politique de valorisation. Points à améliorer et risques : - une transversalité qui demande à être renforcée - un projet scientifique qui n’est pas décliné de façon claire - un risque de dispersion des énergies dans une équipe structurée selon des lignes disciplinaires (civilisation, littérature, didactique) - des relations internationales à structurer davantage - une visibilité et une valorisation qui demandent à être améliorées : site internet, accessiblité des publications, etc. Recommandations: - rechercher des financements par les grands opérateurs - s’interroger sans délai sur les concepts et la terminologie. Données de production : A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants chercheurs référencés en N1 et N2 dans la colonne projet A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels référencés en N3, N4 et N5 dans la colonne projet A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)] A4 : Nombre d’HDR soutenues (cf. Formulaire 2.10 du dossier de l’unité) A5 : Nombre de thèses soutenues (cf. Formulaire 2.9 du dossier de l’unité) 30 1 77% 5 19 6 3 Appréciations détaillées : Appréciation sur la qualité scientifique et la production : Cette équipe couvre un large champ disciplinaire puisqu’on y trouve des littéraires, des civilisationnistes, et des linguistes (didactique et acquisition pour l’essentiel). Elle s’étend sur plusieurs aires culturelles : anglophone, hispanophone, russophone, germanophone, et italophone. La difficulté et la richesse de cette équipe tiennent là : parvenir à construire une identité qui préserve les spécificités de chacun en développant une transversalité dynamique. Les recherches menées sont variées, et regroupées en trois axes, qui correspondent aux spécialités disciplinaires. Le premier axe, essentiellement civilisationniste, travaille sur des problématiques liées à l’identité, à la mémoire, à la nation. Ces travaux se traduisent par un certain nombre de publications collectives. Le deuxième axe concerne des thématiques proches (identités, frontières, genres) à partir de corpus littéraires pour l’essentiel modernistes (Joyce, Lorca, futurisme, etc.) ou plus contemporains (littérature canadienne, écossaise) sans négliger la période moderne (Thomson, Darwin). Ces deux axes font aussi une part à une réflexion sur le cinéma. Le troisième axe porte avant tout sur le concept de réseau, souvent en partenariat avec des équipes d’autres universités. Il s’appuie sur des échanges avec des universités européennes et d’Afrique du Nord. Les publications sont nombreuses et de qualité. Beaucoup de volumes collectifs sont publiés dans la collection du CRINI, de fort bonne tenue (35 volumes publiés à ce jour). Cela représente à la fois une richesse et un inconvénient. Une richesse car la production du laboratoire peut être clairement identifiée, à condition d’opérer un travail considérable de diffusion (le passage sur revues.org est en ce moment à l’étude, ce qui est une bonne chose). L’inconvénient est que la diffusion des résultats ne s’inscrit pas dans les réseaux nationaux et internationaux de la recherche (au demeurant certains chercheurs publient dans des revues internationales). Les thèses soutenues sont nombreuses (19) au cours du dernier quadriennal, montrant à la fois une véritable politique de formation et d’attractivité régionale (tous les doctorants avec qui nous avons pu nous entretenir avaient soutenu leur M2 à Nantes). De même, avec 5 HDR soutenues depuis 2007 (dont 1 au sein même de l’unité, et 4 dans des universités autres), le CRINI a largement renouvelé son potentiel d’encadrement, notamment dans le domaine anglophone, ce qui ne devrait pas tarder à porter ses fruits. Enfin, des liens internationaux se développent avec différentes universités, en particulier à l’occasion de cotutelles (Sidney, Saragosse, etc.). Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de l’unité de recherche dans son environnement : L’unité est composée d’un nombre important de chercheurs actifs, dont certains ont une présence internationale (publications, conférences). L’attractivité du laboratoire est indéniable, si l’on en juge par le nombre important de thèses inscrites au 1er janvier 2011 (42), et parmi celles-ci le nombre significatif de cotutelles et étudiants étrangers (13). Si certaines aires culturelles (russophone en particulier) semblent souffrir d’un manque d’enseignants-chercheurs, dans l’ensemble l’encadrement est riche et varié. On notera un véritable dynamisme collectif de l’axe 1, en particulier sur le monde hispanique, avec un certain nombre d’expériences et d’opérations louables autour du cinéma par exemple, et avec un effort pour sortir de l’université (actions en direction de la formation continue, de la ville, etc.). Si l’unité a répondu présent à des appels d’offres locaux (actions financées dans le cadre du CPER, ou au sein de l’université), on notera une certaine timidité face aux appels d’offres des grands opérateurs nationaux et internationaux (ANR, etc.). C’est dans cette direction que devraient porter les efforts (il a été fait mention dans la discussion d’un projet de programme ANR, en préparation depuis peu). De manière générale, il serait souhaitable que l’unité développe des projets en ce sens, de façon à structurer et financer une partie de ses recherches. La valorisation des recherches est intéressante, avec un projet de « newsletter » électronique (e-CRINI), mais dont il est trop tôt pour estimer la qualité et l’impact (le n°1 est paru en juin 2008 ; le second doit paraître en février 2011) : si cette périodicité est maintenue elle est évidemment trop faible pour une publication de ce type. C’est aussi par des coopérations internationales suivies et structurées, qui vont au-delà de la mise en place de co-tutelles, que l’unité pourra se développer et renforcer ses axes de recherche tout en démontrant plus clairement son attractivité. 7 On a noté que, quoique les anglicistes soient en majorité dans cette équipe, peu d’échanges suivis existent avec les pays anglophones. Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité: Si la gouvernance de l’unité paraît un peu compliquée avec un bureau exécutif et un conseil de laboratoire en plus de l’assemblée générale, il est possible qu’elle soit nécessaire à l’équipe pour fonctionner. La communication interne semble fonctionner convenablement, avec quelques moments de rassemblement de l’équipe, et une information sur l’activité des différents axes (journées d’étude, soutenances de thèses) bien suivie. La communication externe repose sur un site internet bien fait mais qui pourrait être mieux alimenté. La catégorie proposée de chercheur associé n’est pas pertinente, cette appellation désignant à l’ordinaire les chercheurs qui ont un rattachement principal à un autre laboratoire. L’équipe fonctionne beaucoup par journées d’étude organisées au sein de chaque axe, et débouchant sur une publication dans la collection du CRINI. S’il y a là une activité indéniable, on peut s’interroger sur les modes de fonctionnement transversaux. Certes, des membres de certains axes participent aux travaux d’autres axes, mais on peut se demander si la transversalité est suffisamment explorée et exploitée par l’unité : il semble y avoir peu de travail de séminaire en particulier, prélude aux journées d’étude ou colloques, et qui permettrait de rassembler doctorants et chercheurs des différents axes. Les enseignants-chercheurs de l’unité sont en phase avec les préoccupations de la ville et de la région, qui les soutient à l’occasion : des initiatives heureuses ont été prises par les chercheurs, en particulier dans l’axe 1. Appréciation sur le projet : Le projet scientifique pour le prochain quadriennal s’inscrit dans la continuité des travaux entrepris et cherche à éviter la dispersion inévitable dans une grosse équipe : la structuration plus ferme des axes semble être la voie suivie par l’unité. Des thématiques sont évoquées pour les différents axes (axe 1 : mémoire et écriture de la nation, images et représentations des identités nationales, paroles de femmes ; axe 2 : écritures et identités : création, représentation, reconstructions, qui se décline en cinq catégories ; axe 3 : réseaux, interculturalité, et transversalité). L’ensemble présenté comporte à peine plus de quatre pages. Il est donc difficile de se faire une véritable idée des contenus scientifiques proposés, d’autant plus qu’aucun état des lieux de ces questions n’est proposé, aucun cadre bibliographique ni direction de travail. On peut faire confiance à des chercheurs renommés pour mener ces projets selon des directions scientifiques claires, et l’équipe a prouvé dans le précédent quadriennal sa capacité à le faire : mais un projet scientifique doit aussi afficher pour la communauté la façon dont il s’inscrit dans des courants de recherche nationaux et internationaux (d’autres équipes, d’autres disciplines ont travaillé sur la mémoire de la nation, sur les migrations, sur l’interculturalité, etc.). Les fondements théoriques (par exemple dans le cadre de l’axe 3) de l’interaction scientifique des différents chercheurs doivent être plus clairement perceptibles. La politique de gestion et d’affectation des moyens semble être bien menée et les doctorants, en particulier, sont soutenus dans leurs recherches. 8 4 Analyse équipe par équipe et/ou par projet Le CRINI propose trois axes de recherche qui correspondent, peu ou prou à des distinctions disciplinaires au sein des études de langues. Dans l’axe 1, sont regroupés les spécialistes de civilisation, sous l’intitulé : « Civilisation et imagologie : l’Europe en réseaux et les identités en question » ; dans l’axe 2, on trouve les spécialistes de littérature, avec l’appellation : « littératures étrangères : l’Europe en lignes : une identité littéraire et ses facettes » ; l’axe 3 rassemble les linguistes spécialistes plus particulièrement de didactique : « Didactique des langues et cultures étrangères : l’Europe des langues : mémoire(s), apprentissage et réseaux ». Les sous-titres des axes indiquent d’autre part la volonté des membres de l’équipe de travailler de façon transversale et transdisciplinaire. Toutefois, le travail envisagé pour le prochain contrat est énoncé de façon fragmentaire et trop générale pour être utile : c’est le cas pour tous les axes. A) Axe 1 : « Civilisation et imagologie : l’Europe en réseaux et les identités en question » L’axe 1 est apparu comme le plus dynamique d’un point de vue collectif. Appréciation sur la qualité scientifique et la production : La difficulté du travail en commun de chercheurs spécialistes d’aires culturelles différentes et inégalement représentées au sein de l’équipe (dominance des hispanisants et des anglicistes, faible présence des russophones) apparaît clairement, mais on saura gré aux chercheurs de tenter d’y remédier, par l’organisation de travaux prenant des objets de recherche permettant de croiser leur expertise. S’il y a un risque à remettre sur le métier la question des « identités » par exemple, il est certain que l’équipe doit perpétuellement s’inventer de nouveaux modes de fonctionnement qui traversent les aires culturelles. Un travail sur les frontières dans les Amériques permet aux américanistes du CRINI de se retrouver autour d’une thématique qui associe l’étude des anciens et des nouveaux empires américains. Un certain nombre de publications dans la collection du laboratoire témoignent de cette recherche d’un socle commun (par exemple, en 2007, Myths and Symbols of the Nation, et plus encore en 2008 Nationalismes et régionalismes. Amériques mode d’emploi). La réflexion autour de la mémoire (« Paroles de vainqueurs, paroles de vaincus ») montre également ce désir d’associer toutes les aires culturelles dans un travail de recherche commun. Le travail sur le cinéma, quant à lui, concerne au premier chef les hispanistes, mais il n’est certainement pas exclu de penser que d’autres spécialistes pourront se retrouver dans ce travail dynamique mené par les chercheurs de cette spécialité, qui trouvent des modes originaux de valorisation. Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de l’unité de recherche dans son environnement : Les collaborations internes à l’équipe, bien sûr, mais aussi les échanges avec d’autres équipes de recherche témoignent clairement de la vitalité de cet axe : au sein du PRES, avec des universités espagnoles, avec des universités canadiennes (un projet ANR est à l’étude dans le cadre de l’accord franco-québécois). Les liens avec les universités du monde anglophone existent aussi, mais davantage sur une base personnelle qu’institutionnalisée. Les rapports avec les collectivités territoriales sont également très suivis, et on notera un travail important autour du cinéma en particulier, en direction des enseignants des collèges et lycées, ce qui témoigne à la fois d’un dynamisme louable et d’une volonté de faire sortir la recherche de ses lieux privilégiés, ce dont on ne peut que se réjouir. Appréciation sur le projet : Le thème proposé pour le sous-axe 1, « migration et citoyenneté en Europe et dans les Amériques XVIIIe-XXIe siècles », est si vaste et si général qu’on voit mal comment une page et demie de généralités peuvent permettre aux évaluateurs de se faire une idée de la direction qu’envisage de développer l’équipe. L’absence de cadrage méthodologique, de bibliographie, ici comme pour les autres axes, rend ce projet très difficilement lisible. On est donc contraint de faire confiance aux chercheurs, qui ont montré leur dynamisme, pour augurer de recherches fécondes. 9 B) Axe 2 : « Littératures étrangères : l’Europe en lignes : une identité littéraire et ses facettes » Le rayonnement de cet axe est intéressant et prometteur, malgré un projet là encore relativement flou. Appréciation sur la qualité scientifique et la production : Le deuxième axe présente les mêmes spécificités que l’axe 1, avec des chercheurs spécialistes d’aires culturelles différentes et inégalement représentées. Le travail cherche à recouper certaines thématiques de l’axe 1, mais reste néanmoins clairement centré sur des problématiques plus littéraires, comme en témoigne par exemple le travail sur la notion de « canon ». Le travail dans cette direction semble fourni, même si on peut noter à l’occasion qu’une journée de travail sur les « Voix d’écrivaines au XIXe siècle » suit d’assez près le programme de l’agrégation d’anglais (Brontë et Dickinson). Des travaux individuels de premier plan doivent d’autre part être notés ici (Joyce, études écossaises) ainsi que des activités dépassant le simple cadre du laboratoire (organisation du colloque de la Société Française d’Etudes Irlandaises [SOFEIR] en 2010). Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de l’unité de recherche dans son environnement : Il semble que les liens entre la formation master et le travail à l’échelle de l’équipe de recherche et des doctorants soient bien articulés, mais l’une des conséquences en est que le recrutement reste pour l’essentiel régional : le fait que tous les doctorants rencontrés avaient effectué leur master à Nantes est à cet égard significatif. Appréciation sur le projet : Pour le quadriennal à venir, une esquisse d’argumentaire est proposée, autour de cinq thèmes très inégalement développés : seul le cinquième, « les poétiques de l’espace », est quelque peu élaboré, mais il reste à un niveau extrêmement général, qui ne permet pas de se faire une idée réelle de la pertinence ni de l’originalité des travaux envisagés. C’est davantage autour des questions de mise en réseau que l’on voit se dessiner un travail en commun prometteur (futurisme et surréalisme, dialogue entre les textes littéraires et d’autres genres comme le livret d’opéra). C) Axe 3 : « Didactique des langues et cultures étrangères : l’Europe des langues : mémoire(s), apprentissage et réseaux » Cet axe, de par sa nature disciplinaire, est peut-être plus autonome que les deux autres au sein de l’équipe, et comprend moins de chercheurs (huit, soit 1/5ème du total environ). Appréciation sur la qualité scientifique et la production : Les publications sont régulières, même si l’on peut regretter que, comme dans toute l’équipe, la tendance soit de trouver dans la collection du CRINI un débouché commode, dont la diffusion reste problématique, même si un effort est actuellement fait pour passer sur revues.org. Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de l’unité de recherche dans son environnement : L’ouverture de cet axe vers d’autres équipes de recherche travaillant sur les mêmes thématiques mérite d’être notée, à la fois dans l’université et ailleurs en France. Des liens existent avec l’international, mais il s’agit davantage de terrains d’étude ou de co-tutelles que d’accords de coopération solidement établis. Cet axe est d’autre part partie prenante dans un projet régional de recherche (PLURI-L). 10 Comme l’axe 2, l’axe 3 insiste sur la continuité entre la formation de master et la suite des opérations de recherche, ce qui ne peut que renforcer la dynamique de recherche et de travail de l’unité, mais limite le bassin de recrutement. Appréciation sur le projet : Les projets pour le prochain contrat sont déclinés sous forme d’une liste de journées d’études proposées, qui sont certainement utiles et importantes, mais l’absence de problématisation générale, et même de contenu donné à ces journées d’étude, rend difficile une évaluation véritable de la perspective proposée. On regrette que le rapport n’ait pas été l’occasion d’une réflexion sur les perspectives qui s’ouvraient — bibliographie, inscription dans les réseaux français et internationaux de la recherche, etc., à l’appui. Intitulé UR / équipe C1 C2 C3 C4 Note globale CENTRE DE RECHERCHE SUR LES IDENTITES NATIONALES ET L'INTERCULTURALITE (CRINI) B A A B B C1 Qualité scientifique et production C2 Rayonnement et attractivité, intégration dans l'environnement C3 Gouvernance et vie du laboratoire C4 Stratégie et projet scientifique 11 Statistiques de notes globales par domaines scientifiques (État au 06/05/2011) Sciences Humaines et Sociales Note globale A+ A B C Non noté Total A+ A B C Non noté Total SHS1 2 12 11 8 1 34 5,9% 35,3% 32,4% 23,5% 2,9% 100,0% SHS2 8 33 37 4 SHS3 2 12 6 2 SHS4 11 13 22 6 SHS5 5 32 19 1 SHS6 6 18 5 82 9,8% 40,2% 45,1% 4,9% 22 9,1% 54,5% 27,3% 9,1% 52 21,2% 25,0% 42,3% 11,5% 57 8,8% 56,1% 33,3% 1,8% 29 20,7% 62,1% 17,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Total 34 120 100 21 1 276 12,3% 43,5% 36,2% 7,6% 0,4% 100,0% Intitulés des domaines scientifiques Sciences Humaines et Sociales SHS1 Marchés et organisations SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux SHS3 Espace, environnement et sociétés SHS4 Esprit humain, langage, éducation SHS5 Langues, textes, arts et cultures SHS6 Mondes anciens et contemporains 12