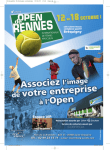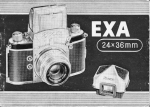Download Sanctionner, pour quoi faire ? - Autonome de solidarité Laïque
Transcript
N° 09 - Juin 2008 - 2 € Trimestriel Les risques du métier LE MAGAZINE DE L’AUTONOME DE SOLIDARITÉ LAÏQUE DOSSIER P. 07 Sanctionner, pour quoi faire ? Actualité de la FAS & USU L’Offre Métiers de l’Éducation pour mieux vous protéger P. 04 La bonne opération pour + de sérénité TRIBUNE DE L’AVOCAT Assister les victimes P. 12 www.autonome-solidarite.fr www.maif.fr/offreeducation Au cœur de l’éducation Le labo, lieu de l’éducation aux risques P. 18 Actualité de la FAS & USU P. 04 L’ Offre Métiers de l’Éducation pour mieux vous protéger Édito Dossier P. 07 Sanctionner, pour quoi faire ? Une force nouvelle Lorsque des enseignants, pionniers de l’école publique, se sont regroupés, il y a plus de cent ans pour apporter leur soutien solidaire à ceux d’entre eux qui se trouvaient confrontés aux risques de leur métier, ils inventaient les Autonomes de Solidarité, encore et toujours connues et reconnues, si longtemps après, par les personnels d’éducation et les institutions. Les temps étaient différents. La loi du 5 avril 1937 n’existait pas. L’État ne protégeait pas ses fonctionnaires. Trente ans plus tard, d’autres enseignants, pourquoi ne pas dire les « fils des premiers » créèrent la MAAIF (devenue plus tard la MAIF). Ce fut pour compléter une protection devenue nécessaire pour couvrir des biens personnels, dont principalement le véhicule, puis plus tard, la responsabilité civile des personnels. En complément des autres associations, mutuelles et organisations syndicales, chacune de ces deux organisations a traversé l’histoire du xxe siècle, s’adaptant aux évolutions de l’école et à son environnement, en élargissant leurs domaines de compétences pour être toujours au plus proche des besoins de leurs adhérents. Ainsi, les Autonomes se sont rapidement fédérées en une structure nationale, propre à assurer la cohérence de leurs actions, à garantir la présence sur l’ensemble du territoire français. Très rapidement aussi elles ont créé leur mutuelle d’assurance, l’Union Solidariste Universitaire, pour prendre en charge les conséquences de la mise en cause de la responsabilité des personnels ou celles des accidents professionnels. De même, la MAIF s’est positionnée, tout au long de son histoire, comme l’assureur des personnels d’éducation, en apportant, outre les couvertures matérielles, celles liées à la personne et à ses responsabilités. Maintes fois les chemins se sont croisés, maintes fois les militants se sont retrouvés sur les champs de la protection comme sur ceux de la prévention. De l’accord sur la prise en charge de certains risques professionnels dans les années 1960 au guichet unique en 2004, les Autonomes de Solidarité et la MAIF n’ont jamais cessé de développer leurs relations dans l’intérêt de leurs adhérents/sociétaires communs. L’école a changé, mais il n’est pas concevable pour autant de ne pas poursuivre l’histoire commencée il y a plus de LES RISQUES DU MÉTIER magazine édité par la Fédération des Autonomes de Solidarité et l’Union Solidariste Universitaire 7, rue Portalis, 75008 Paris. Tél. : 01 44 90 86 86. www.autonome-solidarite.fr P. 2 100 ans. C’est donc en innovant pour être au plus près des besoins et des attentes, que nos deux organisations franchissent une nouvelle étape pour la protection des personnels. Elle se traduira, dès la rentrée prochaine, par l’« Offre Métiers de l’Éducation » ; proposée à l’ensemble des personnels des établissements scolaires publics dès la rentrée prochaine. Grâce à ce rapprochement et à cette nouvelle offre commune, • les Autonomes et la MAIF offriront à la profession une protection unique, face à l’ensemble des risques générés par les métiers de l’éducation ; • les Autonomes et la MAIF offriront, outre une couverture assurantielle qui additionne ce que chacun avait de meilleur, une qualité professionnelle et une logistique militante, incomparables et certainement inimitables, parce qu’elles reposeront sur une expérience de 100 ans pour l’une et 75 ans pour l’autre, mais aussi parce qu’elles sont exercées par des professionnels de l’éducation, particulièrement aguerris au fonctionnement de l’école et du système scolaire en général ; • les Autonomes et la MAIF permettront aux personnels concernés par cette offre et particulièrement aux nouveaux entrants dans les métiers, d’identifier sans ambiguïté qu’elles s’associent pour leur apporter la meilleure protection possible face aux risques de leurs métiers. Combien de fois avons-nous entendu des adhérents expliquer qu’ils ne renouvelaient pas leur adhésion au motif qu’ils étaient déjà bien assurés ailleurs. Comment leur expliquer, mieux que par une offre commune aux contenus sans équivalent que la complémentarité de nos deux organisations est une force nouvelle au service de leur protection dans l’école d’aujourd’hui. Si la force militante qui porte cette nouvelle Offre Métiers de l’Éducation commune vise, certes, à protéger les adhérents/sociétaires lorsqu’ils sont confrontés à un risque professionnel, elle vise aussi à participer à la réflexion pour la recherche d’une école plus sereine et mieux respectée. • une école dans laquelle la relation entre les acteurs sera améliorée ; • une école dans laquelle le risque sera diminué. La tribune de l’avocat P. 12 Assister les victimes Questions-réponses P. 14 Bris de lunettes P. 16 Au cœur de l’éducation Le labo, lieu de l’éducation aux risques Initiatives Sept îles pour un collège P. 18 Roger Crucq Président de la FAS & USU Directeur de la publication : Roger Crucq. Rédactrice en chef : Betty Galy. Rédaction : Delphine Goater. Ont participé à la rédaction : Valérie Aimé, Delphine Fleury. Conception et réalisation : La Fabrique du Design. Crédits photo : Gettyimages, Jimmy Delpire, Alexandre Giraud/MAIF, Joël Bellec, Annick Le Galoudec. La photocopie des articles est libre. Impression : Presses du Louvre 19, rue Paul Bert, 75011 Paris. N° CPPAP 0408 S 08117. ISSN 1952-6369 Abonnement 4 numéros : 7 euros. Prix du numéro : 2 euros. P. 19 Sur les étagères Maîtriser la violence à l’école Juin 2008 - Les risques du métier - N°09 ACTUALITÉ DE LA FAS & USU Une offre commune pour mieux vous protéger Comment procéder en cas de litige ? Face à une agression physique ou morale, le titulaire de l’Offre Métiers de l’Éducation se retournera indifféremment vers le correspondant de l’Autonome de Solidarité Laïque de son établissement ou de sa délégation MAIF. Les Autonomes de Solidarité Laïques et la MAIF se rapprochent afin de proposer une nouvelle offre de protection professionnelle aux personnels de l’éducation. L’Offre Métiers de l’Éducation Cet engagement commun offrira aux adhérents d’aujourd’hui et de demain une protection complète contre les risques de leur métier. Parce qu’ensemble, les deux organismes spécialistes de la protection des personnels de l’éducation mettront tout en œuvre pour améliorer la sérénité des personnels et donc le climat au sein de l’école. Depuis plus de quarante ans, les Autonomes de Solidarité Laïques et la MAIF collaborent dans le domaine des risques professionnels des personnels de l’enseignement public. Forts de ce passé commun, qui leur a permis de prouver leur efficacité et leur légitimité à agir ensemble, les deux organismes ont noué un accord de partenariat le 12 mai 2004. Celui-ci les a amenés à renforcer davantage leurs échanges et les a conduits à partager la volonté commune d’aller encore plus loin, pour le bénéfice des personnels. C’est ainsi qu’ensemble ils ont conçu une offre commune destinée à renforcer la protection et l’accompagnement des personnels de l’éducation. Cette offre unique et sans précédent est proposée à tous les personnels de l’éducation à partir de la prochaine rentrée scolaire 2008-2009. Simple et efficace, cette offre regroupe en un seul contrat toutes les prestations dont a besoin un professionnel de l’éducation pour continuer à exercer son métier en toute sérénité. ACTUALITÉ DE LA FAS & USU Le bénéficiaire de cette offre disposera en cas de litige ou de différend, en cas d’agression ou en cas d’accident, des actions d’accompagnement des Autonomes de Solidarité Laïques en termes de médiation et de prévention des risques du métier. Lorsque cela sera nécessaire, il profitera des garanties assurantielles prévues au contrat de co-assurance USU/MAIF, notamment la prise en charge financière de la défense lorsque cela sera nécessaire. L’offre sera renouvelable par tacite reconduction, fonctionnera par année civile et pourra être présentée par le correspondants d’établissement, en se rendant à l’Autonome ou à la MAIF et en ligne sur les sites Internet de l’ASL et de la MAIF. Zoom sur la nouvelle offre L’offre Métiers de l’Éducation permettra une meilleure prise en charge du soutien moral et de l’accompagnement juridique des personnels victimes d’agression, d’insultes ou de menaces. Mais elle offrira également une meilleure couverture des risques professionnels des personnels de l’éducation. Protection juridique et accompagnement-conseil seront désormais couplés à la garantie Responsabilité civile et Défense professionnelle, suite à un accident hors circulation ou à un fait dommageable involontaire. De plus, toutes les conséquences corporelles des accidents, qu’il s’agisse d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle, seront prises en charge. La mission historique de conseil juridique et d’accompagnement des militants des Autonomes de Solidarité Laïques auprès de leurs adhérents est renforcée à travers une écoute active, la pratique d’un diagnostic militant et le choix d’un mode de défense adapté. Son recours à la médiation et ses actions de prévention des risques sont réaffirmées à travers ce nouveau contrat. Après une étude de la situation, les collègues militants de l’ASL mettront tout en œuvre pour lui apporter la réponse la mieux adaptée à sa situation et l’accompagner tout au long de la conduite de son dossier. Une écoute active Grâce à leur expérience de professionnels de l’Éducation nationale, les militants des Autonomes de Solidarité Laïques peuvent aider l’adhérent à analyser plus sereinement les faits qu’il a subis. Présents dans tous les départements et dans la plupart des établissements scolaires, les correspondants des Autonomes de Solidarité Laïques sont les plus proches de l’adhérent au moment où survient l’incident. Il ne faut donc pas hésiter à les solliciter. Un diagnostic militant Spécialistes des risques du métier, les militants des Autonomes de Solidarité Laïques peuvent compter sur l’appui de la commission juridique de la FAS et de son centre de documentation pour identifier les conséquences de ces risques. L’expérience centenaire des Autonomes de Solidarité Laïques a été reconnue par le ministère de l’Éducation nationale dans le cadre d’une convention qui réaffirme leur rôle fondamental dans la prise en charge des fonctionnaires adhérents victimes d’agression dans le cadre de leur fonction. Un mode de défense adapté Les militants de l’Autonome de Solidarité Laïque favorisent la conciliation et la médiation, à travers leur relation avec l’Éducation nationale, les organisations syndicales, l’encadrement des établissements scolaires, ainsi que les parents d’élèves et leurs fédérations. Ils œuvrent ainsi pour favoriser un meilleur climat au sein de l’école. Quand cela est nécessaire, ils rapprochent l’adhérent d’un avocat-conseil, sollicitent la protection juridique de l’État, et l’accompagnent pendant toute la durée de la procédure civile ou pénale. Le soutien et l’accompagnement psychologiques de l’adhérent ainsi que sa prise en charge financière, sont également assurés à travers un réseau de partenaires. « Pour la première fois, les deux organismes de la protection des personnels de l’éducation proposent une offre commune qui leur est destinée. Complémentaires, nos deux organismes seront présents sur le terrain de la protection et de la défense en démultipliant leurs actions militantes, au cœur même des établissements scolaires. » Roger Crucq, président de la FAS « Nous partageons avec les ASL les mêmes valeurs humanistes de solidarité et de respect de la personne. Cette offre commune va nous permettre de conjuguer nos talents pour construire une nouvelle et unique assurance multirisques professionnelle. En associant nos deux organismes, nous œuvrons pour nos sociétaires et adhérents communs. » Roger Belot, président de la MAIF Pour en savoir plus : P. 4 www.autonome-solidarité.fr www.maif.fr/offreeducation Juin 2008 - Les risques du métier - N° 09 DOSSIER La violence scolaire : des conférences pour en parler Fortes de leur mission commune pour la prévention des risques du métier, les ASL, en partenariat avec la MAIF, ont entamé en 2005 un tour de France de la violence scolaire. Échos de la réunion au Dôme de Saint-Avé, près de Vannes, le 13 mars dernier… La prévention, plus que la répression Depuis 2005, plus d’une trentaine de réunions ont eu lieu dans toute la France. Elles rassemblent chaque fois plus de 200 personnes, en grande majorité des enseignants, mais aussi des éducateurs, des élus ou des parents d’élèves. Ces réunions tentent de définir les causes de la violence en milieu scolaire, d’en préciser les diverses manifestations, et apportent des propositions de recours ou de prévention. Elles sont chaque fois introduites par le correspondant départemental MAIF et le président de l’Autonome de Solidarité Laïque du département. Ce dernier présente le CD-Rom « Prévenir la violence scolaire », réalisé par la FAS, la MGEN et l’ADOSEN, offert par la FAS à chaque participant, avant de céder la parole aux experts invités à éclairer l’assistance. Les enseignants, très souvent victimes de la violence en milieu scolaire, sont en forte demande de conseils sur cette thématique sensible. Me Bertrand Pour en savoir plus : P. 6 Labat, avocat de l’ASL du Finistère, a défini en droit ce qu’était la violence scolaire, avant de donner quelques exemples concrets et d’examiner les points de recours. « De la simple contravetion au crime, en passant par le délit, passible du tribunal correctionnel, la violence scolaire entraîne de nombreux manquements à la loi », a-t-il indiqué. Selon lui, les enseignants sont de plus en plus fréquemment victimes de diffamation, d’injure ou de dénonciation calomnieuse de la part de parents d’élèves, mais aussi de la publication sur des blogs ou des sites Internet de photographies prises à leur insu avec un téléphone portable. Après avoir donné quelques exemples de ces faits délictueux, Me Labat a conclu son propos par une liste des recours possibles, qui vont du courrier de mise en demeure au dépôt de plainte, tout en signalant l’existence de la médiation pénale. Les réunions-débats sur la violence scolaire font l’objet depuis 2007 d’un partenariat avec l’Observatoire international de la violence scolaire de l’université Bordeaux 2, dirigé par Éric Debarbieux. Ce partenariat prévoit l’intervention, aux côtés de l’avocat-conseil de l’Autonome départementale, d’un des quatre membres de l’Observatoire sur la définition et les causes de la violence à l’école, ainsi que sur les moyens de la prévenir. À Saint-Avé, Yves Montoya représentait l’Observatoire. Il abordé la question de la médiatisation du phénomène, avant de brosser à grands traits une histoire des violences scolaires. « Si la violence à l’école est de l’histoire ancienne, c’est le rapport de la société à cette violence qui a changé », a t-il estimé. Il a défendu la pratique des enquêtes de victimation face à des statistiques officielles qui se révèlent insuffisantes pour quantifier le phénomène. Il s’est enfin attaché à définir les principaux indicateurs de la violence à l’école avant de donner quelques directions pour l’action et la prévention. C’est en effet dans ce domaine que l’assistance était la plus demandeuse de pistes de réflexion. Témoignant du sentiment de « désacralisation » des enseignants, Yves Montoya a cependant convenu dans sa conclusion qu’il n’existait pas de fatalité à la violence scolaire et que les stratégies mises en place par les établissements scolaires DOSSIER : NOTRE ENQUÊTE ACTUALITÉ DE LA FAS & USU Sanctionner, pour quoi faire ? La sanction est-elle un échec de l’éducation ou un nécessaire rappel à l’ordre ? Ne permet-elle pas de faire prendre conscience à l’élève de sa responsabilité s’il transgresse un règlement intérieur accepté par tous ? Les situations sont cependant différentes entre le 1er et le 2nd degré. Dans le 1er degré, le règlement type départemental s’applique aux établissements scolaires, précisant un cadre restreint et cohérent des sanctions applicables. Dans le 2nd degré, des circulaires définissent un large arsenal de sanctions. Il s’agit de les graduer avant d’en arriver à la dernière extrémité, la convocation du conseil de discipline, source croissante de contestation de la part des familles. CD-Rom « Prévenir la violence scolaire », partenariat ASL, ADOSEN, MGEN Juin 2008 - Les risques du métier - N° 09 DOSSIER La sanction, pour quoi faire ? Nécessaire rappel au règlement intérieur élaboré par l’ensemble de la communauté scolaire, la sanction peut être constructive pour l’élève. À condition qu’elle ne soit ni excessive, ni humiliante. Quelques conseils de spécialistes pour sanctionner à bon escient. À quoi sert une sanction dans un lieu d’éducation ? Pour Eirick Prairat, philosophe, chercheur en sciences de l’éducation à l’IUFM de Nancy, « elle a trois fonctions : réaffirmer une règle et rappeler la loi, responsabiliser un jeune en lui faisant prendre conscience des conséquences de son acte et lui signifier une limite. Pour se construire, l’élève a besoin de repères. Pour atteindre sa liberté, il doit parfois rencontrer des interdits. C’est une thèse qui fait débat. » La sanction est-elle, en effet, un échec de l’éducation ? Philippe Daviaud, CPE et responsable de la formation des CPE à l’IUFM de Paris, a de plus en plus tendance à penser que non. « Punir ou sanctionner n’est pas un échec, c’est probablement une nécessité. Il ne faut pas qu’un enseignant se sente déstabilisé parce qu’il a rencontré une classe qui l’oblige à punir. Les élèves ont vu dans cet adulte quelqu’un qui est capable de réagir, qui offre une résistance. Ils ont confiance dans cet enseignant qui montre sa capacité à sanctionner, à s’opposer à eux. Pour en savoir plus : P. 8 C’est dans cette résistance que l’adolescent va se construire. » Il estime que la sanction sert à rétablir de l’ordre dans sa classe et à rappeler les règles que les élèves sont censés respecter. « La punition, prononcée par l’enseignant ou par le CPE, châtie les petits manquements aux règles, à la différence de la sanction, qui réprime les manquements plus graves et est prononcée par le chef d’établissement ou par le conseil de discipline. Punitions et sanctions sont clairement définies et listées dans le règlement intérieur de l’établissement, auquel tous, élèves, parents et équipe éducative, doivent se référer. Élément structurant et organisateur de la vie scolaire, il doit être mis à jour régulièrement et respecté à la lettre. Il doit enfin prévoir les punitions et les sanctions. Pour Guy Barbier, secrétaire fédéral Unsa, « il faut que le règlement intérieur soit formalisé, connu et accepté de tous, afin qu’il devienne la règle commune ». Selon lui, le climat scolaire est facilité dès lors que les règles sont explicites, ont été acceptées et comprises. http//eduscol.education.fr S’interdire les sanctions illégales… Quelles sanctions possibles dans le 1er degré ? Cependant, la sanction n’est pas l’unique manière de se faire respecter en classe. De l’avis d’Eirick Prairat, la sanction doit être un dernier recours et non un moyen permanent, systématique, de gérer la vie de la classe. Pour clarifier le contrat moral qui s’écrit entre les élèves et leur professeur, il conseille en début d’année scolaire de délivrer un « mode d’emploi du professeur ». « Celui-ci doit dire aux élèves ce qu’il attend d’eux et ce qu’eux peuvent attendre de lui. Quand les moments “chauds” arrivent et que l’on est obligé de sanctionner, il suffit alors de respecter les textes. Respecter les textes en vigueur, c’est donner à la sanction sa dimension considérante ». Eirick Prairat déplore que l’école française ait encore trop souvent recours aux sanctions illégales. Il constate une grande disparité des pratiques punitives, d’un établissement à l’autre, et même à l’intérieur d’un même établissement. De son côté, Philippe Daviaud rappelle que « dans le respect des principes généraux du droit, dont certains datent de 1880, il faut s’interdire les punitions comme les sanctions collectives ». De la même façon, il faut s’interdire les brimades, les humiliations, le recours à la violence (gifle, piquet, règle, lignes…). En effet, Eirick Prairat considère qu’une sanction n’est pas éducative quand elle est excessive ou transgressive, quand elle est humiliante ou quand elle est imprévisible et silencieuse. Dans le primaire, les textes relatifs à la sanction manquent de précision et les enseignants sont assez démunis en la matière. Pour les écoles maternelles et élémentaires, le texte de référence est la circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991, qui permet à chaque inspecteur d’académie d’établir un règlement départemental. Bruno Robbes a analysé ce document (voir le site Internet de l’inspection académique du Val d’Oise). Pour lui, ce texte affirme tout d’abord le principe de l’interdit de violence - quelle qu’en soit la forme - de l’enseignant envers l’élève ou sa famille, et inversement. Il recommande de prévoir dans le règlement intérieur « des mesures d’encouragement au travail et des récompenses ». Par extension et par analogie avec les établissements du 2nd degré, il est souhaitable que les sanctions figurent par écrit dans le règlement intérieur, après discussion en conseil des maîtres et dans le respect de la circulaire. Le règlement intérieur est ensuite approuvé par le conseil d’école. Ainsi, les sanctions prises en fonction des infractions commises sont-elles clairement énoncées et non soumises à l’arbitraire de l’adulte. Si, à l’école maternelle, « aucune sanction ne peut être infligée », l’isolement sous surveillance ou la privation partielle de récréation est envisageable. Dans les cas les plus graves, « une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par le directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec l’inspecteur de l’Éducation nationale ». Même, s’il indique des pistes d’action possibles ce texte peut sembler relativement limité en comparaison des textes dans les établissements du 2nd degré, estime Bruno Robbes. « Ce serait utile qu’il existe un texte cadre pour le 1er degré, s’inspirant de la philosophie et des grands principes de justice qui régissent les textes existants dans le 2nd degré (individualisation, contradictoire, proportionnalité entre l’infraction commise et la sanction prononcée, gradation des sanctions…). » …et les « violences institutionnelles » Pour Bruno Robbes, conseiller au CAAEE* de Versailles, chargé de la prévention dans le 1er degré et chercheur en sciences de l’éducation à l’université Paris X, la sanction doit toujours avoir une portée éducative. « L’objectif de la sanction est que l’élève ne réitère pas son comportement. C’est la raison pour laquelle je fais réfléchir les enseignants qui sanctionnent sur le sens de cette sanction est qu’un enseignant à l’autorité reconnue est quelqu’un qui sanctionne à bon escient. Il faut penser la sanction comme une compétence professionnelle. L’enseignant doit poser un acte, être capable de l’expliquer, et cet acte doit apparaître juste (au double sens de la justice et de la justesse) au destinataire de la sanction. » Dans les établissements où le CAAEE intervient, il existe deux extrêmes. « Nous rencontrons soit des professionnels qui ont des difficultés pour sanctionner, faisant preuve de laxisme et ne prenant pas forcément la mesure de la gravité des faits commis Textes de référence : par les élèves ; soit des professionnels qui demandent des sanctions exemplaires, par exemple de nombreuses exclusions de cours. » En revanche, la grande majorité des enseignants sont au fait des sanctions qu’ils ont le droit de prendre et n’hésitent pas à réfléchir à plusieurs, dans le cadre d’un échange de bonnes pratiques professionnelles. « La problématique des sanctions est une question majeure que l’on travaille avec nos collègues depuis une vingtaine d’années. Mais il existe une culture professionnelle ancienne, qui se traduit parfois par la pratique de violences institutionnelles. » Quand des collègues en sont réduits à pratiquer ce type de sanction, c’est qu’ils n’ont pas de solution. Ils se réfugient parfois dans la reproduction de schémas autoritaristes, parce que cela les rassure. Mais attention, si des enseignants sont amenés à commettre des « violences institutionnelles » d’une certaine gravité, la réponse à ces violences peut être pénale. *CAAEE* : Centre académique d’aide aux écoles et aux établissements. Articles L. 511-1 et L. 511-2 du Code de l’éducation Décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié Décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié Circulaires n° 91-052 du 6 mars 1991 et n° 91-124 du 6 juin 1991 Juin 2008 - Les risques du métier - N° 08 DOSSIER Les procédures disciplinaires Témoins de l’incursion du droit dans l’école, les conseils de discipline font l’objet d’une judiciarisation croissante. Le recours à un avocat pour défendre un élève convoqué est fréquent, tandis que les annulations pour vice de procédure sont de moins en moins rares. Comment faire pour éviter d’en arriver là ? Pour Daniel Vergely, adjoint au chef du bureau de la réglementation et de la vie des écoles et des établissements à la DGESCO*, « la judiciarisation des conseils de discipline s’inscrit dans un mouvement de fond » qui traverse toute la société et qui impacte notamment l’Éducation nationale. Selon lui, elle est due à une meilleure information du citoyen, et à une plus grande perméabilité des familles à cette évolution générale – voir, notamment, la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dite loi « DRCA », qui marque une évolution significative : de la notion de simples « administrés », on est passé à celle d’« usagers » puis à celle de « citoyens » qui entend faire valoir ses droits auprès de l’administration. L’ouverture du site Légifrance, placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement, participe d’une même logique de démocratisation du droit. S’agissant, spécifiquement, de l’Éducation nationale, la circulaire du 11 juillet 2000 relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté a sans doute contribué à cette judiciarisation ; elle rappelle les principes généraux du droit applicables en matière disciplinaire, principes dont les avocats s’emparent « au bénéfice des élèves dont ils assurent la défense ». Le décret du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires reconnaît expressément à l’élève appelé à comparaître devant le conseil de discipline Textes de référence : P. 10 la possibilité de « se faire assister par une personne de son choix ». Ce décret définit en effet avec précision les conditions dans lesquelles doit se tenir un conseil de discipline, de la définition des faits reprochés aux conditions de convocation et à la notification de la décision. Autant de pièges juridiques tendus à des chefs d’établissement dont ce n’est pas la seule tâche ! « Un chef d’établissement, profane en matière juridique, ne peut pas maîtriser l’ensemble des pièges face à un avocat qui va éplucher la procédure et y détecter des failles ou des vices de forme », reconnaît Laurent Hazan, avocat-conseil de l’ASL de Paris et du Val-de-Marne. « Le législateur a renforcé, notamment avec les décrets de 2000, les droits de la défense de manière importante. Il a voulu aligner la procédure des conseils de discipline avec la procédure pénale ou correctionnelle en érigeant le conseil en juge pénal. Cela affaiblit le chef d’établissement et les protagonistes, qui ne connaissent pas ces règles, de plus en plus compliquées. » Une vocation pédagogique Comment éviter de voir les décisions des conseils de discipline annulées pour vice de procédure par le tribunal administratif ? Il faut tout d’abord rappeler l’objectif principal d’un conseil de discipline, qui doit conserver un caractère exceptionnel. « Le conseil de discipline n’est pas un procès pénal, rappelle Laurent Hazan. Il a une vocation pédagogique : évoquer des faits commis dans l’établissement qui sont non conformes au règlement intérieur. Il permet de faire le point sur des faits Un conseil juridique pour le chef d’établissement ? et de trouver la meilleure des solutions à l’aide d’un collège d’intervenants. » On ne réunit pas le conseil de discipline tous les jours, parce que cela implique la convocation en bonne et due forme d’un grand nombre de personnes. « Quand on passe en conseil de discipline, c’est toujours dans des cas extrêmement graves et qui déclenchent une procédure lourde. Généralement, il s’agit de statuer sur une exclusion définitive », estime Daniel Vergely. En effet, si la tenue d’un conseil de discipline s’impose en raison de la gravité des faits, le chef d’établissement doit faire preuve de la plus grande vigilance pour que la décision prise ne soit l’objet d’aucune contestation. « Le conseil de discipline doit être utilisé de manière exceptionnelle, mais systématiquement en cas de violence, et notamment de violence physique. », reconnaît Guy Barbier, secrétaire national Unsa. « Lorsque le chef d’établissement demande la tenue d’un conseil pour des faits de violence, il doit s’appuyer sur des preuves, des pièces tangibles », conseille Laurent Hazan. Même si les faits sont caractérisés et qu’il y a des témoins, lorsque le dossier n’est pas suffisamment probant, l’avocat jouera la carte de la carence des preuves. Le moindre vice de forme, comme la non-convocation des parents, le non-respect des délais de convocation, l’absence de communication de pièces ou le non respect du principe du contradictoire sont autant de pièges dans lesquels les chefs d’établissement peuvent tomber. « À chaque étape de la procédure, j’appelle à la plus grande vigilance du chef d’établissement », insiste Laurent Hazan. Malgré tout, le déséquilibre entre l’élève, qui bénéficie du conseil d’un avocat, et le chef d’établissement, qui ne bénéficie d’aucun conseil juridique, fragilise l’autorité de ce dernier. « La loi permet aux mineurs de se faire assister, mais face à lui, on n’a pas donné au chef d’établissement les moyens d’être à jour par rapport à la loi », déplore Laurent Hazan. « Il est important de s’entourer de précautions dans quelque chose qui peut avoir des conséquences importantes pour l’élève, estime de son côté Guy Barbier, mais les chefs d’établissement et les enseignants se trouvent placés dans une insécurité permanente, avec le risque de voir la décision du conseil contestée. » En effet, en cas d’annulation, l’élève revient dans l’établissement en position de force, ce qui touche le chef d’établissement dans son autorité. « On veut faire du chef d’établissement un juge, alors qu’il n’en a ni la formation initiale ni continue », poursuit Laurent Hazan. « Pourquoi ne pas permettre aux chefs d’établissement d’être assistés d’un conseil ? Pourquoi ne pas aussi leur fournir une formation juridique ? », plaide-t-il. Daniel Vergely, quant à lui, fait confiance aux chefs d’établissement. « Il est normal que l’élève soit bien défendu, y compris par un professionnel du droit. » Pour l’instant, outre le fait que les chefs d’établissement connaissent bien les textes, il estime que de nombreux outils sont en mesure de les aider : le guide juridique du chef d’établissement, le site Internet Eduscol, tout comme l’assistance des services juridiques des rectorats. Claudine Caux* Le conseil devient un vrai tribunal ! On observe une augmentation du recours à l’avocat ou à l’aide judiciaire gratuite des familles pour défendre leur enfant. Cela devient un vrai tribunal ! Je trouve dommageable que les parents aient recours à un avocat pour un oui ou pour un non. Certaines choses pourraient se régler en amont. Les représentants de parents nommés au conseil de discipline ont un rôle de médiateur. Ils sont là pour examiner avec le parent la situation. Normalement, le chef d’établissement devrait donner les coordonnées des parents qui siègent aux parents dont l’enfant passe en conseil de discipline, mais ce n’est pas systématiquement fait. * Vice-présidente de la PEEP TÉMOIGNAGE Le conseil de discipline, un tribunal ? TÉMOIGNAGE Pour Pascal Bolloré, proviseur du Lycée Frédéric-Mistral, à Fresnes, il faut être très attentif aux mesures prises tant sur le fond que sur la forme. « La rédaction d’un acte devra apporter la démonstration que la famille a bien été prévenue, que le principe de proportionnalité a bien été respecté et qu’un délai de recours a été prévu. » Faride Hamana* Les familles en profitent Nous constatons que de plus en plus de parents font appel à un avocat, ce que nous regrettons. Comme un certain nombre de conseils de discipline ne sont pas validés pour des raisons de procédure, les familles en profitent. Nous dissuadons le recours à un avocat, qui est coûteux, car nous estimons que cela n’est pas nécessaire. En effet, nous formons les parents délégués qui siègent dans les conseils de discipline ou dans les commissions de discipline aux questions de procédure, de recours, mais aussi aux mesures alternatives au conseil de discipline, comme les travaux d’intérêts généraux. * Ancien président de la FCPE *DGESCO : direction générale de l’enseignement scolaire Circulaire n°97-085 du 27 mars 1997 Circulaires n°2000-105 et n°2000-106 du 11 juillet 2000 Circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004 BŒN n° 39 du 28 octobre 2004 Juin 2008 - Les risques du métier - N° 09 Par le bâtonnier Francis Lec, avocat-conseil de la FAS & USU La Tribune de l’Avocat Un nouveau juge pour assister les victimes Avec la création du juge délégué aux victimes, le gouvernement témoigne de sa volonté de placer les victimes au cœur du procès pénal. Contesté par les magistrats et les avocats,ce nouveau dispositif se met progressivement en place depuis le 1er janvier 2008 au sein de chaque tribunal de grande instance. Un juge censé alléger le parcours du combattant de la victime… Partant du principe que la victime est désemparée face à l’institution judiciaire et qu’elle est soumise à un véritable parcours du combattant, la garde des Sceaux, en créant ce juge délégué aux victimes, poursuit plusieurs objectifs. Dans la pratique, ce juge doit : • marquer de façon lisible la prise en compte des victimes par l’institution judiciaire ; • permettre aux victimes d’être reçues par un magistrat et ses collaborateurs qui seront à leur écoute avec pour mission de remédier à la dispersion des actions et des responsabilités en guidant la victime dans les méandres de l’institution judiciaire ; • veiller à la qualité de la réponse judiciaire, qu’il s’agisse de la protection de la victime après libération du condamné ou de l’indemnisation de la victime par le condamné. Cette fonction est désormais assurée concrètement au sein des tribunaux de grande instance par le magistrat chargé de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Ce rôle de conseil de la victime dévolu à un magistrat n’a pas manqué de susciter la vive réaction des avocats qui ont vu dans sa création une atteinte à leur mission séculaire. Textes de référence : P. 12 … sans concurrencer les missions de l’avocat Renforcer les droits et l’indemnisation des victimes À peine élaborée, la création du juge chargé des victimes a rencontré l’hostilité du conseil national des barreaux. Dans un recours auprès du Conseil d’État, celui-ci s’oppose en effet à une telle innovation qui, selon lui, nie le travail effectué depuis des années par tous les professionnels attachés à la défense des victimes : avocats qui les assistent, associations qui les soutiennent, juridictions répressives qui leur allouent des indemnités et juges d’application des peines qui contrôlent l’indemnisation par les condamnés. Le Conseil national des barreaux a notamment réaffirmé que le juge ne pouvait être le conseil d’une partie. La mise en place de ce juge spécialisé n’aboutirait en réalité qu’à engendrer de nouvelles complications. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, Robert Badinter a fait part de ses doutes face à cette innovation : « Je ne vois pas son rôle. S’il s’agit de défendre les intérêts des victimes en justice, c’est aux avocats de le faire. Et toute victime peut obtenir au besoin l’assistance d’un avocat d’office. Veiller à l’exécution de la décision rendue ? Là aussi, c’est à l’avocat de le faire. Il y a quelques années, le gouvernement avait instauré un ministre délégué aux Droits des victimes. Ses mérites personnels n’étaient pas en cause, mais son domaine de compétence est toujours demeuré insaisissable ; et l’on n’a pas renouvelé l’expérience. » L’émergence de ce juge délégué aux victimes provoque un véritable débat sur la place de celles-ci dans le procès pénal et sur la nécessité de renforcer ses droits et son indemnisation. C’est ainsi que le Conseil national des barreaux, rejoignant certaines propositions de la Fédération des Autonomes de Solidarité Laïque élaborées lors de ses derniers colloques, propose des améliorations concrètes : 1 décider que la victime sera assistée au cours de l’enquête et à tout le moins qu’elle pourrait bénéficier si elle le souhaite d’une consultation avant son dépôt de plainte, et se voir assister lors de la confrontation au commissariat ou à la gendarmerie avec l’auteur suspecté des faits reprochés ; 2 prévoir que le ministère public mette lui-même en cause les organismes sociaux, les assureurs et les civilement responsables ; 3 étendre l’intervention du Fonds de garantie à l’indemnisation de tous les préjudices corporels et moraux, et pas seulement les plus graves, ainsique les frais de défense ; 4 obliger les autorités de police et de gendarmerie et le Parquet à donner aux victimes le numéro vert des barreaux qui ont tous, ou presque, une « permanence victimes » composée d’avocats compétents et formés ; Décret du 13 novembre 2007 instituant le juge délégué aux victimes 5 obliger le juge des enfants à solliciter des parents d’un enfant mineur le nom et les coordonnées de leur compagnie d’assurance, ainsi que leur numéro de contrat, afin de faciliter la mise en cause ; 6 élargir l’intervention du Fonds de garantie et de la CIVI à tous les préjudices, même si la victime n’a pas 30 jours d’ITT ; 7 prévoir aussi que le condamné se verra contraint à sa sortie, s’il n’a pas indemnisé les victimes ou s’il n’a pas remboursé le Fonds de garantie, de verser d’office par prélèvement direct un pourcentage de son salaire au profit soit de la victime, soit du Fonds de garantie, ce qui suppose que le juge de l’application des peines donne à la partie civile ou au Fonds de garantie toutes les coordonnées de l’employeur. Des victimes éloignées de leur procès Alors même que la création du juge des victimes suscite l’hostilité des avocats et d’une partie des syndicats de magistrats, les associations de victimes s’inquiètent dans le même temps de leur éloignement du procès pénal en raison de la suppression dès le 1er janvier 2010 de 23 tribunaux de grande instance (TGI). Ces associations de victimes craignent que la suppression de ces TGI n’entraîne la disparition de leurs permanences sur ces sites avec pour conséquence l’allongement des distances séparant les victimes du lieu où elles peuvent officiellement être prises en charge. Les suppressions annoncées de juridiction risquent de renforcer l’absence des victimes au procès pénal. L’INAVEM* rappelle que l’audience pénale est un moment crucial dans le parcours de la victime, car c’est à l’audience que celle-ci va pouvoir être reconnue judiciairement et socialement en tant que victime. En d’autres termes, certains estiment qu’il n’est pas cohérent de créer un juge chargé essentiellement de conseiller la victime pour obtenir réparation à la suite du jugement rendu, alors qu’elle n’a pas été présente dans la phase précédente, celle du procès. Conclusion Le Conseil d’État devrait prochainement se prononcer sur la légalité de ce juge délégué aux victimes qui, depuis quelques mois, se met discrètement en place dans les palais de Justice. La réussite de cette nouvelle institution dépendra surtout de la volonté des chefs de juridiction de lui donner une véritable consistance et surtout des moyens matériels suffisants. * INAVEM : Institut national d’aide aux victimes et de médiation « Le juge délégué aux victimes veille dans le respect de l’équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes. » (Code de procédure pénale, article D.47-6-1) Juin 2008 - Les risques du métier - N°09 Questions-Réponses présentées par le Service national de documentation de la FAS Bris de lunettes Effectifs Les lunettes d’une élève ont été cassées au cours d’une récréation. Il n’a pas été trouvé de tiers responsable et donc l’assurance a refusé de rembourser le dommage. Les parents se retournent contre l’enseignante. Que faire ? Le maire peut-il imposer l’effectif des élèves par classe ? Concernant le port des lunettes, il faut réclamer, en début d’année, une déclaration aux parents « précisant si l’enfant doit garder ses lunettes pendant les différentes activités de la journée, y compris les récréations et les séances d’éducation physique ». Ainsi, les enseignants doivent être mis au courant de la situation pour être vigilant pour les élèves porteurs de lunettes. En cas de dommage, le rapport d’accident peut servir à déterminer les responsabilités des uns et des autres. Lors d’une collision entre deux élèves, la reconnaissance de la responsabilité sera différente selon le cas de figure. Par exemple, lorsque deux élèves se bousculent mais que cela n’est pas dû à un acte volontaire de l’un des deux, il peut y avoir partage de responsabilité entre les parents qui ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité, sauf en cas de force majeure. Dès lors, la réparation du dommage se fera entre les assureurs. S’il n’y a pas de tiers responsable, il est fréquent que les parents recherchent la responsabilité de l’école. Cependant, pour se retourner contre l’enseignante, et par voie de substitution, contre l’État, il faut prouver que le dommage est consécutif d’une faute imputable à cette enseignante. Références : Circulaire n° 72-266 du 03 juillet 1972 relative à la responsabilité des chefs d’établissement en cas d’accidents imputables au port des lunettes. Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 sur le rôle et la place des parents à l’école. Note de service n° 88-043 du 15 février 1988 relative à la communication du rapport d’accident. D’autres questions-réponses et fiches à consulter en ligne sur www.autonome-solidarite.fr P. 14 Les effectifs par école relèvent de la carte scolaire. L’établissement de cette carte scolaire est du ressort de l’Éducation nationale et non des collectivités territoriales. Le maire n’a pas autorité pour imposer un effectif par classe. Seul le directeur de l’école, après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves en fonction de la réglementation en matière de sécurité des locaux. Les établissements scolaires sont classés parmi les ERP (établissements recevant du public) et doivent se soumettre à une réglementation stricte. « En l’absence de normes obligatoires sur les ratios, c’est-à-dire sur les rapports entre le nombre de personnes et les surfaces disponibles dans une classe, le nombre maximum d’élèves par classe doit s’apprécier en fonction du respect des conditions de sécurité. » Ainsi, pour mettre en adéquation la capacité d’une classe avec le nombre d’élèves inscrits, il faut que le directeur se réfère à la décision de l’organisme de contrôle. Cette décision, reproduite dans un procès-verbal, doit figurer en copie dans le registre de sécurité de l’école. En dernier ressort, c’est toutefois au maire, propriétaire des locaux, de vérifier qu’il n’y ait pas plus d’inscrits que de places disponibles. Références : Décret n° 89-122 du 24 février 1989 : article 2 Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique (approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié) : articles CO34 à CO38. Question écrite à l’Assemblée nationale n° 907 du 17 juillet 2007 Code de l’éducation : articles L. 212-1 à L. 212-9 ; article D. 211- Risque alimentaire Peut-on accepter à l’école maternelle des gâteaux faits à la maison par les parents ? La préparation des aliments consommés lors de la restauration scolaire est soumise à des normes très strictes. Cependant, en dehors du déjeuner pris à la cantine, les enfants peuvent avoir multiples occasions d’ingérer divers aliments. Les goûters d’anniversaire, les fêtes de Noël ou de fin d’année… sont des moments de convivialité auxquels les parents aiment à participer, notamment en élaborant des gâteaux et autres pâtisseries. S’il n’y a pas d’interdiction à consommer des gâteaux préparés par les parents, il faut cependant suivre un certain nombre de recommandations concernant les ingrédients utilisés et le stockage des denrées. Au moment de la fabrication des produits, il faut prendre les précautions d’usage en matière d’hygiène (lavage des mains, des ustensiles et du plan de travail). Après leur cuisson puis lors du transport, il faut s’assurer de la bonne conservation des produits (utilisation de film étirable, de boîte hermétique). Enfin, à l’école, il faut aussi veiller à respecter des règles de stockage au froid (conservation dans une glacière ou au réfrigérateur). En outre, la composition et la traçabilité des ingrédients utilisés ne pouvant pas être clairement définis, il faut être particulièrement vigilant à la sécurité des enfants allergiques et leur éviter toute ingestion de produits à risque. Références : Circulaire n° 2002-004 du 03 janvier 2002 relative aux règles à suivre pour les préparations alimentaires. Circulaire n° 2001-118 du 25 juin 2001 relative à la restauration scolaire. Rubrique 50 risques du métier et leurs solutions. Juin 2008 - Les risques du métier - N° 09 INITIATIVES Sept îles pour un collège Car les risques sont malgré tout très nombreux, même s’ils sont atypiques. Lorsqu’ un enseignant se retrouve seul en classe avec un ou deux élèves, il doit être vigilant et adopter une attitude irréprochable. Lorsqu’il accompagne un groupe d’élèves sur un bateau à deux étages doté d’un pont extérieur, sa responsabilité en matière de surveillance est importante. « Ils ont beau être Bretons et îliens, ils n’ont pas forcément le pied marin. Il faut toujours avoir l’œil sur eux quand ils éprouvent Les 88 élèves de sept îles bretonnes sont scolarisés tout au long de l’année au collège des îles du Ponant, de la 6e à la 3e. Répartis sur six sites, ils partagent un petit nombre de professeurs qui vivent au quotidien des risques du métier plutôt insolites. Reportage à l’île de Batz, au large de Roscoff, dans le Finistère. La vie sur les îles du Ponant* est rythmée par les marées et par les vedettes de passagers qui accostent au port. L’horaire des bateaux dans une main, celui des marées dans l’autre, Marie-Elise Réa, la nouvelle principale, s’est vite aperçue à sa prise de fonction, en septembre dernier, qu’établir les emplois du temps au collège des îles du Ponant relevait du casse-tête ! À Ouessant, en automne et en hiver, le bateau du lundi matin n’arrive qu’à 11 heures. « Soit c’est un enseignant ouessantin qui fait cours, soit les élèves ne commencent qu’à 11 heures » résume-t-elle. Pour les enseignants, prendre le bateau est souvent synonyme d’angoisse. « Il n’y a qu’un bateau par jour pour Ouessant, au départ du Conquet, et il ne faut pas le rater » s’exclame Karine Lahogue, professeur d’espagnol qui partage son temps entre Batz et Ouessant. « J’ai même dû prendre un pied-à-terre à Brest parce que les horaires de bateau ne correspondaient pas entre eux. » Mêmes inquiétudes pour Solène Bonnot, professeur d’his- Pour en savoir plus : P. 16 toire géographie sur les deux îles, quand elle a été nommée au collège à la rentrée de septembre 2007. Maintenant, pour elle, c’est devenu la routine ! « Nous prenons le bateau comme on prendrait le métro. Il nous arrive de nous endormir ou d’en profiter pour travailler, si la mer est calme. » Les problèmes sont tout autres entre Roscoff et l’île de Batz, très proche de la côte et accessible en quinze minutes. Dès le mois d’avril, il faut jouer des coudes avec les touristes pour grimper dans la vedette qui propose plusieurs rotations par jour. Julien Marzin en fait l’expérience le vendredi matin, quand il vient prendre les neuf élèves de l’île de Batz pour leurs trois heures d’EPS hebdomadaires. « J’ai été contraint de passer devant une dizaine de personnes pour monter sur le bateau, en leur disant que j’allais travailler », explique-t-il en arrivant. Polyvalence et autonomie La vie dans les îles est rude et sauvage, mais elle est parfois monotone, surtout l’hiver, quand la tempête fait rage. Le projet pédagogique de l’établissement prévoit donc des sorties théâtre au Quartz de Brest ou au théâtre de Lorient, afin de permettre aux élèves de bénéficier d’activités culturelles. « En cas de sorties sur le continent, les hébergements sont lourds à gérer », témoigne Marie-Elise Réa, qui avoue dans ce cas être sur le pont 24 heures sur 24. Elle a la chance d’être entourée d’une équipe très polyvalente basée à Brest, la gestionnaire n’hésitant pas à raccompagner un groupe d’élèves sur leur île, la documentaliste à assurer la logistique et la personne chargée de l’entretien à préparer leur petit-déjeuner avant le départ. « Chaque collègue exerce les tâches liées à son métier, mais offre une grande souplesse de fonctionnement liée à la spécificité du collège » se réjouit Marie-Elise Réa. Autre particularité du collège, la responsabilité des élèves est partagée entre tous les membres de l’équipe éducative. Le collège des îles du Ponant ne compte aucun CPE et une seule surveillante, présente sur le site de Groix, où les élèves sont les plus nombreux. Sur les autres îles, ce sont les enseignants eux-mêmes qui assurent l’étude et la surveillance des récréations. Et si un enseignant est momentanément absent, les autres membres de l’équipe doivent s’organiser pour assurer l’accueil des élèves. « Bien entendu, les enseignants peuvent me joindre à tout moment sur mon portable professionnel. » Maintenir un lien entre le siège du collège, à Brest, et les six sites sur lesquels il est présent, est un challenge quotidien. « Je travaille énormément par mail, par fax et par téléphone. Je me rends régulièrement sur les sites pour rencontrer les enseignants et les parents d’élèves. Sur chaque île, un des enseignants fait office de coordinateur et d’interface entre la direction et ses collègues. Mais en son absence, les enseignants doivent être autonomes. » C’est la raison pour laquelle Marie-Elise Réa insiste, à chaque rentrée, pour que ses collègues adhèrent à l’Autonome de Solidarité du Finistère. « Pour moi, c’est un réflexe depuis vingt-huit ans… » l’envie de prendre l’air », remarque Solène Bonnot. D’un autre côté, le travail de ces enseignants très motivés et presque tous bivalents est très différent de celui qu’ils auraient à effectuer dans un collège du continent. Une expérience et une aventure qu’ils ne regrettent jamais… * Les îles du Ponant sont au nombre de 15 : Chausey, Bréhat, Glénan, Belle-Île, Arz, Île-aux-Moines, Yeu , Aix, Ouessant, Sein, Molène, Houat, Hoëdic, Batz et Groix (le collège des Îles du Ponant ne scolarise que les sept dernières îles). 01 Marie-Elise Réa se rend régulièrement sur l’île de Batz pour rencontrer les enseignants et les élèves. Lors de ses fréquents déplacements, la journée est très dense. 02 Dernières recommandations pour les deux élèves de quatrième qui partent bientôt en voyage scolaire en Angleterre. Le ramassage des élèves en provenance de chaque île est minutieusement organisé. 03 Au programme de l’après-midi pour les élèves de Julien Marzin, enseignant en EPS, SVT et arts plastiques, une course d’orientation sur l’île, qui permet de compenser l’absence d’équipementssportifs à proximité. 04 Nathalie Barré, professeur d’anglais prend le bateau chaque jour, pour rentrer chez elle dans les Monts d’Arrée, en Centre Bretagne. Enseignante depuis 2003 au Collège des Iles du Ponant, elle reconnaît que les conditions d’enseignement ne sont pas les mêmes sur les îles et sur le continent. www.clg-ponant.net Juin 2008 - Les risques du métier - N° 09 Au cœur de l’éducation Le labo, lieu de l’éducation aux risques Maîtriser la violence à l’école Psychopédagogue, Lucien Piloz a longtemps été formateur en IUFM et forme aujourd’hui des enseignants de lycée professionnel. Dans cet ouvrage, il entend dénoncer la formation inachevée des maîtres, qui ignorent le plus souvent la conduite à tenir lorsqu’ils sont confrontés à la violence. En trois parties, il évoque les pistes qui permettront une En sciences de la vie et de la Terre, ou en biologie-biochimie, il peut y avoir des risques spécifiques ! Un bon réflexe pour les enseignants de ces disciplines est d’inculquer aux élèves les bonnes pratiques de laboratoire dès le début de l’année. Le second est de s’informer régulièrement et de s’assurer. Si les activités expérimentales sont encadrées par des règles et définies par des textes de référence, ces textes ne constituent pas l’unique réponse aux préoccupations quotidiennes des enseignants et des personnels de laboratoire. « Il existe des textes réglementaires clairement cadrés, qui définissent des interdits indique Guy Menant, inspecteur général en sciences et Vie et de la Terre. Mais ces textes ne légifèrent pas sur tout. C’est la raison pour laquelle nous avons constitué un référentiel progressif et évolutif de bonnes pratiques professionnelles, qui permettent d’informer et d’orienter la réflexion des enseignants. » Ces ressources sont disponibles sur Eduscol ou sur le site 3RB, mais aussi auprès de l’Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires ou de l’INRS. Elles mettent en avant les bonnes pratiques qui visent à garantir les conditions optimales de sécurité pour tous les utilisateurs. « Au-delà de l’application de ces règles, nous cherchons avant tout à Sur les étagères éduquer les jeunes à la responsabilité vis-à-vis d’eux-mêmes, d’autrui, des animaux et de l’environnement », poursuit Guy Menant. En enseignement général, cette mission éducative vise, entre autres, une prise de conscience de la nécessité de se protéger. Marie-Emmanuelle Vinit, professeur de SVT au lycée Frédéric-Mistral de Fresnes, demande en début d’année à ses élèves le port de la blouse, le respect du matériel et son bon usage et le respect des autres élèves de la classe. « Ensuite, les consignes dépendent de chaque manipulation », explique-t-elle. Dans l’enseignement professionnel et technologique, l’acquisition par les élèves de bonnes pratiques de laboratoire et l’application à l’occasion de chaque manipulation d’un protocole explicite font partie intégrante de l’enseignement. Isabelle Scher, professeur de génie biologique et d’hématologie au lycée technologique Stanislas de Villers-les-Nancy commence son année par des sensibilisations magistrales sur les précautions à prendre pour soi-même, l’environnement et le produit que l’on traite. « Lors des TP, nous essayons d’indiquer aux élèves quels sont les produits susceptibles d’être dangereux, puis petit à petit, de les amener à conduire cette réflexion d’eux-mêmes. » Face à la marge d’interprétation qu’offrent les textes réglementaires, Jean-Pierre Levistre, inspecteur pédagogique régional dans l’académie de Créteil, en appelle au bon sens et à la culture scientifique des enseignants. « Le plus important est de rechercher les informations officielles et de lire les textes réglementaires pour connaître les manipulations à faire ou à ne pas faire. » Isabelle Scher reconnaît qu’elle doit effectuer elle-même une veille scientifique sur les sites ressources : « De temps en temps, des directives nationales publiées au Journal Officiel interdisent la manipulation de certains produits ou molécules ou alertent sur le risque de transmission d’une épizootie. » Porter une blouse Avoir les cheveux attachés Se laver les mains régulièrement Ne pas boire, ne pas manger Utiliser des pipeteurs Utiliser des moyens de protection collective 7 8 9 10 Utiliser des équipements de protection individuelle Organiser le poste de travail et le maintenir rangé U tiliser la juste quantité de produit nécessaire à la manipulation Respecter les consignes d’élimination des déchets Maîtriser la violence à l’école, de Lucien Piloz. Éditions De Bœck&Belin, 2007. 50 ans d’école, et demain ? Élaboré chronologiquement, ce livre du sociologue Gabriel Langouët retrace les réformes scolaires et universitaires, l’évolution de la sociologie de l’éducation et celle de la démographie scolaire depuis un demi-siècle. Il dresse le bilan de chaque présidence en matière d’éducation. Cette synthèse des principaux événements qui ont émaillé les cinquante dernières années à l’école et à l’université montre l’influence de la volonté publique sur l’accompagnement de la réussite éducative. Mais elle n’oublie pas de dessiner des pistes pour lutter demain contre l’échec scolaire et favoriser l’insertion de tous les jeunes. 50 ans d’école, et demain ?, de Gabriel Langouët. Éditions Fabert, 2008, 22 €. De la responsabilité en éducation Dans la 3e édition de cet ouvrage publié en 1995, le philosophe Jean-Bernard Paturet réaffirme la nécessité de fonder l’éthique éducative pour l’inscrire dans l’histoire de chaque génération d’enseignants. Son exigeante réflexion sur le rapport entre éthique et éducation explore le champ éthymologique des deux concepts, avant d’étudier celui de responsabilité. 10 conseils pratiques 1 2 3 4 5 6 rencontre authentique entre l’adulte et l’adolescent. Au cœur du livre, et de la situation scolaire actuelle, la présence de violence implique par exemple de maîtriser son émotion et de gérer le conflit. Jean-Bernard Paturet précise notamment la notion de responsabilité en la définissant comme synonyme d’engagement à long terme, de prise de risque et de don de soi. De la responsabilité en éducation, de Jean-Bernard Paturet. Éditions érès, 2007, 18 €. Bulletin d’abonnement M. Mme Mlle Nom : _ _________________________________ Prénom :_______________________ Adresse : _______________________________________________________________ Code postal : Ville :_ ______________________________________ Numéro d’adhérent : Oui, je m’abonne au magazine “ Les risques du métier ” pour une durée de 1 an, Pour en savoir plus : P. 18 http://eduscol.education.fr/securiteSVT www.inrs.fr www.3rb-bgb.com http://ons.education.gouv.fr www.apbg.org soit 4 numéros pour 7 euros. Je règle par chèque bancaire à l’ordre de : la Fédération des Autonomes de Solidarité. À renvoyer à l’adresse suivante, sans oublier d’y joindre votre règlement : Fédération des Autonomes de Solidarité (Abonnement) - 7, rue Portalis - 75008 Paris ✁